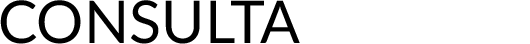Corte
europea dei diritti dell’uomo
(GRANDE CAMERA)
27 agosto 2015
AFFAIRE PARRILLO
c. ITALIE
(Requête
no 46470/11)
ARRÊT
STRASBOURG
Cet arrêt
est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Parrillo c. Italie,
La Cour
européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée
de :
Dean Spielmann, président,
Josep Casadevall,
Guido Raimondi,
Mark Villiger,
Isabelle Berro,
Ineta Ziemele,
George Nicolaou,
András Sajó,
Ann Power-Forde,
Nebojša Vučinić,
Ganna Yudkivska,
Vincent A. De Gaetano,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller,
Faris Vehabović,
Dmitry Dedov, juges,
et de Johan Callewaert, greffier adjoint
de la Grande Chambre,
Après en
avoir délibéré en chambre du conseil le 18 juin 2014 et 22 avril 2015,
Rend l’arrêt
que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. À
l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46470/11) dirigée
contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme Adelina
Parrillo (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 juillet 2011 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La
requérante a été représentée par Mes Nicolò Paoletti, Claudia
Sartori et Natalia Paoletti, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le
Gouvernement ») a été représenté par ses co-agents, Mme Paola
Accardo et M. Gianluca Mauro Pellegrini.
3. La
requérante alléguait en particulier que l’interdiction, édictée par l’article
13 de la loi no 40 du 19 février 2004, de donner à la recherche scientifique des
embryons conçus par procréation
médicalement assistée était incompatible avec son droit au respect de sa vie
privée et son droit au respect de ses biens, protégés respectivement par l’article
8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Elle se plaignait également d’une violation
de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention, dont la recherche
scientifique constitue à ses yeux un aspect fondamental.
4. La
requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement de la Cour).
5. Le
28 mai 2013, les griefs tirés de l’article 8 de la Convention et de l’article 1
du Protocole no 1 à la Convention ont été communiqués au
Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
6. Le
28 janvier 2014, une chambre de la deuxième section composée de Işıl
Karakaş, présidente, Guido Raimondi, Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović, András Sajó, Nebojša Vučinić et Paulo Pinto
de Albuquerque, juges, ainsi que de Stanley Naismith,
greffier de section, s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des
parties ne s’y étant opposée (article 30 de la Convention et article 72 du
règlement).
7. La
composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément à l’article 26 §§ 4
et 5 de la Convention et à l’article 24 du règlement.
8. Tant
la requérante que le Gouvernement ont déposé un mémoire sur la recevabilité et
sur le fond de l’affaire.
9. Le
Centre européen pour la justice et les droits de l’homme (l’« ECLJ »),
les associations « Movimento per la
vita », « Scienza e
vita », « Forum delle
associazioni familiari », « Luca
Coscioni », « Amica Cicogna
Onlus », « L’altra cicogna
Onlus », « Cerco bimbo »,
« VOX – Osservatorio italiano sui
Diritti », « SIFES –
Society of Fertility, Sterility and Reproductive Medicine » et « Cittadinanzattiva » ainsi que quarante-six membres du
Parlement italien se sont vu accorder l’autorisation d’intervenir dans la
procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 3 du
règlement).
10. Une
audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à
Strasbourg, le 18 juin 2014 (article 59 § 3 du règlement).
Ont
comparu :
– pour le Gouvernement
Mme P. Accardo co-agente,
M. G.
Mauro Pellegrini co-agent,
Mme A. Morresi,
membre du Comité national
pour la
bioéthique et professeur de chimie
physique
au Département de chimie,
biologie
et biotechnologie de l’université
de Pérouse
conseillère,
Mme D. Fehily, inspectrice
et conseillère technique
auprès du
Centre national de transplantation
de Rome conseillère ;
– pour
la requérante
M. N. Paoletti ;
Mme C. Sartori ;
Mme N. Paoletti, avocats, conseils,
M. M. De
Luca, professeur de biochimie et
directeur
du Centre pour la médecine
régénérative
« Stefano Ferrari » de
l’université
de Modène et Reggio Emilia, conseiller.
La Cour a
entendu en leurs déclarations Mme P. Accardo, Mme A. Morresi,
M. N. Paoletti, M. M. De Luca et Mme C. Sartori, ainsi que Mme P. Accardo,
M. G. Mauro Pellegrini, M. M. De Luca, Mme N. Paoletti et M. N.
Paoletti en leurs réponses aux questions posées par les juges.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11. La requérante est née en 1954 et
réside à Rome.
12. En 2002, elle eut recours aux
techniques de la procréation médicalement assistée, effectuant une fécondation in vitro avec son compagnon au Centre de
médecine reproductive du European
Hospital (« le centre ») de Rome. Les cinq embryons issus de
cette fécondation furent cryoconservés.
13. Avant qu’une implantation ne soit
effectuée, le compagnon de la requérante décéda le 12 novembre 2003 lors d’un
attentat à Nasiriya (Iraq), alors qu’il réalisait un reportage de guerre.
14. Ayant renoncé à
démarrer une grossesse, la requérante décida de donner ses embryons à la
recherche scientifique pour contribuer au progrès du traitement des maladies
difficilement curables.
15. D’après les
informations fournies lors de l’audience devant la Grande Chambre, la
requérante formula oralement plusieurs demandes de mise à disposition de ses
embryons auprès du centre dans lequel ceux-ci étaient conservés, en vain.
16. Par une lettre du
14 décembre 2011, la requérante demanda au directeur du centre de mettre à sa disposition les cinq embryons cryoconservés
afin que ceux-ci servent à la recherche sur les cellules souches. Le directeur
rejeta cette demande, indiquant que ce genre de recherches était interdit et
sanctionné pénalement en Italie, en application de l’article 13 de la loi no 40 du 19 février 2004
(« la loi no 40/2004 »).
17. Les embryons en question sont
actuellement conservés dans la banque cryogénique du centre où la fécondation in vitro a été effectuée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
A. La
loi no 40 du 19 février 2004, entrée en vigueur le 10 mars 2004
(« Normes en matière de fécondation médicalement assistée »)
Article 1 – Finalité
« 1. Afin
de remédier aux problèmes reproductifs découlant de la stérilité ou de l’infertilité
humaines, il est permis de recourir à la procréation médicalement assistée dans
les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi, qui garantit
les droits de toutes les personnes concernées, y compris ceux du sujet ainsi
conçu. »
Article 5 – Conditions d’accès
« (...) [seuls] des
couples [composés de personnes] majeur[e]s, de sexe différent, marié[e]s ou
menant une vie commune, en âge de procréer et vivantes peuvent recourir aux
techniques de la procréation médicalement assistée. »
Article 13 – Expérimentation sur l’embryon humain
« 1. Toute
expérimentation sur l’embryon humain est interdite.
2. La recherche clinique et expérimentale sur l’embryon
humain ne peut être autorisée que si elle poursuit exclusivement des finalités
thérapeutiques et diagnostiques tendant à la protection de la santé ainsi qu’au
développement de l’embryon et s’il n’existe pas d’autres méthodes.
(...)
4. La
violation de l’interdiction prévue à l’alinéa 1er est punie d’une
peine de deux à six ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 150 000
euros. (...)
5. Tout
professionnel de la santé condamné pour une infraction prévue au présent
article fera l’objet d’une suspension d’exercice professionnel pour une durée
de un à trois ans. »
Article 14 – Limites à l’application des techniques sur l’embryon
« 1. La
cryoconservation et la suppression d’embryons sont interdites, sans préjudice
des dispositions de la loi no 194 du 22 mai 1978 [normes sur la
protection sociale de la maternité et sur l’interruption volontaire de
grossesse].
2. Les techniques de production d’embryons ne
peuvent conduire à la création d’un nombre d’embryons supérieur à celui
strictement nécessaire à la réalisation d’une implantation unique et
simultanée, ce nombre ne pouvant en aucun cas être supérieur à trois.
3. Lorsque
le transfert des embryons dans l’utérus est impossible pour des causes de force
majeure grave et prouvée concernant l’état de santé de la femme qui n’étaient
pas prévisibles au moment de la fécondation, la cryoconservation des embryons
est autorisée jusqu’à la date du transfert, qui sera effectué aussitôt que
possible. »
18. Par
un arrêt no 151 du 1er avril 2009 (voir les paragraphes
29-31 ci-dessous), la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la
disposition du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi no 40/2004
selon laquelle les techniques de production d’embryons ne peuvent conduire à la
création d’un nombre d’embryons supérieur à celui strictement nécessaire
« à la réalisation d’une implantation unique et simultanée, ce nombre ne
pouvant en aucun cas être supérieur à trois ». Elle jugea
inconstitutionnel l’alinéa 3 du même article au motif qu’il ne prévoyait pas
que le transfert des embryons devait être effectué sans porter préjudice à la
santé de la femme.
B. L’avis du
Comité national pour la bioéthique concernant l’adoption pour la naissance
(« ADP ») (18 novembre 2005)
19. À
la suite de l’adoption de la loi no 40/2004, le Comité national pour
la bioéthique s’est penché sur la question du sort des embryons cryoconservés
en état d’abandon, la loi ne prévoyant aucune disposition spécifique à ce
sujet, se limitant à interdire implicitement l’utilisation des embryons
surnuméraires à des fins de recherche scientifique.
20. À
cet égard, le Comité a émis un avis favorable à l’« adoption pour la
naissance », pratique consistant pour un couple ou une femme à adopter des
embryons surnuméraires à des fins d’implantation et permettant d’utiliser les
embryons en question dans une perspective de vie et de réalisation d’un projet
familial.
C. Le
décret du ministère de la Santé du 11 avril 2008 (« Notes explicatives en
matière de procréation médicalement assistée »)
« (...)
Cryoconservation des embryons : Deux catégories d’embryons sont susceptibles de
faire l’objet d’une cryoconservation : la première est celle des embryons qui
sont en attente d’une implantation, y compris ceux ayant fait l’objet d’une cryoconservation
avant l’entrée en vigueur de la loi no 40 de 2004 ; la deuxième est
celle des embryons dont l’état d’abandon a été certifié (...). »
D. Le
rapport final de la « Commission d’étude sur les embryons » du
8 janvier 2010
21. Par
un décret du 25 juin 2009, le ministère de la Santé institua une Commission d’étude
sur les embryons cryoconservés dans les centres de procréation médicalement
assistée. Le rapport final de cette commission, adopté à la majorité le 8
janvier 2010, expose ce qui suit :
« L’interdiction légale
de supprimer les embryons doit être comprise comme signifiant que la
cryoconservation ne peut être interrompue que dans deux cas : lorsqu’on peut
implanter l’embryon décongelé dans l’utérus de la mère ou d’une femme disposée
à l’accueillir, ou lorsqu’il est possible d’en certifier scientifiquement la
mort naturelle ou la perte définitive de viabilité en tant qu’organisme. En l’état
actuel des connaissances [scientifiques], on ne peut s’assurer de la viabilité
d’un embryon qu’en le décongelant, situation paradoxale puisqu’un embryon
décongelé ne peut être recongelé et qu’il mourra inévitablement s’il n’est pas
immédiatement implanté in utero. D’où
la perspective tutioriste d’une possible conservation sans limite de temps des embryons congelés. Quoiqu’il en soit, il
y a lieu de noter que le progrès de la recherche scientifique permettra de
connaître les critères et les méthodologies pour
diagnostiquer la mort ou à tout le moins la perte de viabilité d’embryons cryoconservés
: il sera ainsi possible de surmonter le paradoxe actuel, inévitable du point
de vue légal, d’une cryoconservation qui pourrait ne jamais avoir de fin. Dans
l’attente de ces résultats, [il convient de réaffirmer] que l’on ne peut
ignorer que l’article 14 de la loi no 40 de 2004 interdit
expressément la suppression d’embryons, y compris ceux qui sont cryoconservés.
À cela s’ajoute que, pour ce qui est du sort des embryons surnuméraires, le
législateur de la loi no 40 a choisi leur conservation et non pas
leur destruction, faisait ainsi prévaloir l’objectif de leur maintien en vie,
même lorsque leur sort est incertain. »
E. La
Constitution de la République italienne
22. Les
articles pertinents de la Constitution se lisent ainsi :
Article 9
« La République promeut
le développement de la culture et de la recherche scientifique et technique. (...) »
Article 32
« La République protège
la santé en tant que droit fondamental de l’individu et intérêt de la
collectivité. (...) »
Article 117
« Le pouvoir législatif
est exercé par l’État et les Régions dans le respect de la Constitution, aussi
bien que des contraintes découlant de l’ordre juridique communautaire et des
obligations internationales. (...) »
F. Les
arrêts de la Cour constitutionnelle nos 348 et 349 du 24
octobre 2007
23. Ces
arrêts répondent à des questions que la Cour de cassation et une cour
territoriale avaient soulevées quant à la compatibilité du décret-loi no 333
du 11 juillet 1992 relatif aux critères de calcul des indemnités d’expropriation
avec la Constitution et avec l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention. Ils tiennent compte de l’arrêt Scordino c. Italie (no 1) ([GC],
no 36813/97, CEDH 2006‑V) rendu par la Grande Chambre de la Cour.
24. Dans
ces arrêts, après avoir rappelé l’obligation pour le législateur de respecter
les obligations internationales (article 117 de la Constitution), la Cour
constitutionnelle a défini la place accordée à la Convention des droits de l’homme
dans les sources du droit interne, considérant que celle-ci était une norme de
rang intermédiaire entre la loi ordinaire et la Constitution. En outre, elle a
précisé qu’il appartenait au juge du fond d’interpréter la norme interne de
manière conforme à la Convention des droits de l’homme et à la jurisprudence de
la Cour (voir l’arrêt no 349, paragraphe 26, point 6.2,
ci-dessous) et que, lorsqu’une telle interprétation se révélait impossible ou
que celui-ci avait des doutes quant à la compatibilité de la norme interne avec
la Convention, il était tenu de soulever une question de constitutionnalité
devant elle.
25. Les
passages pertinents de l’arrêt no 348 du 24 octobre 2007 se lisent
comme suit :
« 4.2. (...) Il est nécessaire de
définir le rang et le rôle des normes de la Convention européenne des droits de
l’homme afin de déterminer, à la lumière de [l’article 117 de la Constitution],
quelle est leur incidence sur l’ordre juridique italien. (...)
4.3. [En effet], si d’un côté
[ces normes] complètent la protection des droits fondamentaux et contribuent
ainsi à la mise en œuvre des valeurs et des principes fondamentaux protégés
aussi par la Constitution italienne, d’un autre côté, elles restent
formellement de simples sources de rang primaire. (...)
Aujourd’hui,
la Cour constitutionnelle est donc appelée à clarifier la question normative et
institutionnelle [posée ci-dessus], qui a d’importantes conséquences pratiques
pour le travail quotidien des opérateurs du droit. (...)
Le juge
ordinaire ne saurait décider d’écarter une disposition de la loi ordinaire
jugée par lui incompatible avec une norme de la Convention européenne des
droits de l’homme, car cette incompatibilité présumée soulève une question de
constitutionnalité portant sur la violation éventuelle du premier alinéa de l’article 117
de la Constitution et relevant [à ce titre] de la compétence exclusive du juge
des lois. (...)
4.5. (...) Le principe énoncé
au premier alinéa de l’article 117 de la Constitution ne peut devenir
concrètement opérationnel que si « les obligations internationales »
contraignantes pour les pouvoirs législatifs de l’État et des Régions sont
dûment définies. (...)
4.6. [Or] par rapport aux autres
traités internationaux, la Convention européenne des droits de l’homme présente
la particularité d’avoir institué un organe juridictionnel, la Cour européenne
des droits de l’homme, ayant compétence pour interpréter les normes de la
Convention. En effet, l’article 32 § 1 [de la Convention] prévoit que « la
compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation
et l’application de la Convention et de ses Protocoles qui lui seront soumises
dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47. ».
Dès lors
que les normes juridiques acquièrent leur sens (vivono) au travers de l’interprétation qui leur est donnée par les
opérateurs du droit, au premier chef les juges, il découle naturellement de l’article
32 § 1 de la Convention que, en signant la Convention européenne des droits de
l’homme et en la ratifiant, l’Italie s’est notamment engagée, au titre de ses
obligations internationales, à adapter sa législation aux normes de la
Convention selon la signification que leur attribue la Cour [européenne des
droits de l’homme], laquelle a été instituée dans le but de les interpréter et
de les appliquer. On ne saurait donc parler d’une compétence juridictionnelle
qui s’ajouterait à celle des organes judiciaires de l’État, mais plutôt d’une
fonction interprétative éminente que les États contractants ont reconnue à la
Cour européenne, contribuant ainsi à préciser leurs obligations internationales
en la matière.
4.7. Il ne faut pas en déduire
que les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, telles
qu’interprétées par la Cour de Strasbourg, ont valeur de normes
constitutionnelles et qu’elles échappent à ce titre au contrôle de
constitutionnalité exercé par la Cour constitutionnelle. Il est d’autant plus
nécessaire que les normes en question soient conformes à la Constitution qu’elles
complètent des principes constitutionnels tout en restant des normes de rang
infra-constitutionnel. (...)
Dès lors
que, comme indiqué ci-dessus, les dispositions de la Convention européenne des
droits de l’homme acquièrent leur sens au travers de l’interprétation qui leur
est donnée par la Cour européenne, le contrôle de constitutionnalité doit
porter sur les normes produites par cette interprétation, non sur ces
dispositions considérées en elles-mêmes. Par ailleurs, les décisions de la Cour
de Strasbourg ne sont pas inconditionnellement contraignantes aux fins du
contrôle de constitutionnalité des lois nationales. Ledit contrôle doit
toujours chercher à mettre en balance la contrainte découlant des obligations
internationales imposée par le premier alinéa de l’article 117 de la
Constitution d’une part, et la protection des intérêts bénéficiant d’une
garantie constitutionnelle reconnue par d’autres articles de la Constitution d’autre
part. (...)
5. Il ressort des principes
méthodologiques exposés ci-dessus que, pour procéder au contrôle de
constitutionnalité demandé par la cour de renvoi, il convient de rechercher a)
s’il y a une contradiction qui ne peut être surmontée par voie d’interprétation
entre la disposition nationale en cause et les normes de la Convention
européenne des droits de l’homme, telles qu’interprétées par la Cour européenne
et considérées comme des sources complémentaires du principe constitutionnel
énoncé au premier alinéa de l’article 117 de la Constitution, et b) si les
normes de la Convention européenne des droits de l’homme supposées intégrer ce
principe et comprises selon l’interprétation que leur attribue la Cour
[européenne] sont compatibles avec l’ordre constitutionnel italien. (...) »
26. Les
parties pertinentes de l’arrêt no 349 du 24 octobre 2007 sont
reproduites ci-après :
« 6.2 (...) [Le principe énoncé]
au premier alinéa de l’article 117 de la Constitution [n’implique pas] que les
normes issues d’accords internationaux doivent être considérées comme ayant valeur constitutionnelle car
celles-ci font l’objet d’une loi ordinaire d’incorporation, comme c’est le cas
pour les normes de la Convention européenne des droits de l’homme. Le principe
constitutionnel sous examen obligeant le législateur ordinaire à respecter ces
normes, une disposition nationale qui serait incompatible avec une norme de la
Convention européenne des droits de l’homme – et donc avec les
« obligations internationales » mentionnées au premier alinéa de l’article
117 de la Constitution – porterait en soi atteinte au principe constitutionnel
en question. En définitive, le premier alinéa de l’article 117 de la
Constitution opère un renvoi à la norme conventionnelle qui se trouve en cause
dans tel ou tel cas, laquelle confère un sens (dà vita) et un contenu aux obligations internationales évoquées de
manière générale ainsi qu’au principe [constitutionnel sous-jacent], au point d’être
généralement qualifiée de « norme interposée », et qui fait à son
tour l’objet d’un contrôle de compatibilité avec les normes de la Constitution,
comme nous le préciserons ci-dessous.
Il s’ensuit
qu’il appartient au juge ordinaire d’interpréter la norme interne conformément
à la disposition internationale (...). Lorsque pareille interprétation est
impossible ou que des doutes existent quant à la compatibilité de la norme
interne avec la disposition conventionnelle « interposée », le juge
est tenu de soulever devant la Cour constitutionnelle une question de
constitutionnalité au regard du premier alinéa de l’article 117 de la
Constitution (...).
Concernant
la Convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de tenir compte du
fait qu’elle présente une particularité par rapport aux autres accords
internationaux en ce qu’elle dépasse le cadre d’une simple liste de droits et
obligations réciproques des États contractants. Ces derniers ont institué un
système de protection uniforme des droits fondamentaux. L’application et l’interprétation
de ce système de normes incombent évidemment au premier chef aux juges des
États membres, qui sont les juges de droit commun de la Convention. Cela étant,
l’application uniforme des normes en question est garantie en dernier ressort
par l’interprétation centralisée de la Convention européenne, tâche attribuée à
la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, qui a le dernier mot et
dont la compétence « s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation
et l’application de la Convention et de ses Protocoles qui lui seront soumises
dans les conditions prévues par [celle-ci] » (article 32 § 1 de la
Convention). (...)
La Cour
constitutionnelle et la Cour de Strasbourg ont en définitive des rôles
différents, bien qu’elles visent l’une et l’autre à protéger au mieux les
droits fondamentaux. L’interprétation de la Convention de Rome et de ses
Protocoles relève de la compétence de la Cour de Strasbourg, ce qui garantit l’application
d’un niveau uniforme de protection dans l’ensemble des États membres.
En
revanche, lorsque la Cour constitutionnelle est saisie de la question de la
constitutionnalité d’une norme nationale au regard du premier alinéa de l’article
117 de la Constitution, [et que cette question] porte sur une incompatibilité
avec une ou plusieurs normes de la Convention européenne des droits de l’homme
qui ne peut être résolue par voie d’interprétation, il lui appartient de
rechercher si l’incompatibilité en question est avérée et, [dans l’affirmative],
de vérifier si les normes mêmes de la Convention européenne des droits de l’homme,
telles qu’interprétées par la Cour de Strasbourg, garantissent une protection
des droits fondamentaux à tout le moins équivalente à celle offerte par la
Constitution italienne.
Il ne s’agit
pas en fait de juger de l’interprétation que la Cour de Strasbourg donne à
telle ou telle norme de la Convention européenne des droits de l’homme (...)
mais de vérifier si cette norme, telle qu’interprétée par la juridiction à
laquelle les États membres ont expressément attribué cette compétence, est
compatible avec les normes pertinentes de la Constitution. Ainsi le devoir de
garantir le respect des obligations internationales imposé par la Constitution
est-il correctement mis en balance avec la nécessité d’éviter que ce devoir ne
porte atteinte à la Constitution elle-même. »
G. La
jurisprudence de la Cour constitutionnelle
1. L’ordonnance de la Cour constitutionnelle no 396 du
24 octobre 2006
27. Par
cette ordonnance, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable une question de
constitutionnalité soulevée par le tribunal de Cagliari relativement à l’article
13 de loi no 40/2004, qui interdit le recours au diagnostic
préimplantatoire.
28. Pour
se prononcer ainsi, la Cour constitutionnelle releva que le juge de renvoi s’était
limité à soulever la question de la constitutionnalité du seul article 13 de la
loi no 40/2004 alors que, selon le contenu du renvoi, l’interdiction
du diagnostic préimplantatoire découlait aussi d’autres dispositions de la même
loi, notamment de l’alinéa 3 de son article 14.
2. L’arrêt de la Cour constitutionnelle no 151 du 1er
avril 2009
29. Cet
arrêt porte sur la constitutionnalité des dispositions des
alinéas 2 et 3 de l’article 14 de la loi no 40/2004 qui
prévoient, d’une part, la création d’un nombre limité d’embryons (non supérieur
à trois) et l’obligation de les implanter simultanément et, d’autre part, l’interdiction
de cryoconserver les embryons surnuméraires.
30. La
Cour constitutionnelle jugea que les alinéas en question étaient
inconstitutionnels parce qu’ils portaient préjudice à la santé des femmes en
les obligeant, d’une part, à subir plusieurs cycles de stimulation ovarienne
et, de l’autre part, à s’exposer aux risques liés aux grossesses multiples du
fait de l’interdiction de l’interruption sélective de grossesse.
31. Dans
le texte de l’arrêt, aucune référence n’est faite à la Convention européenne
des droits de l’homme, laquelle n’avait pas non plus été citée par les
juridictions (tribunal administratif régional du Latium et tribunal de
Florence) qui avaient soulevé la question.
3. L’ordonnance de la Cour constitutionnelle no 97 du 8 mars 2010
32. Par
cette ordonnance, la Cour constitutionnelle déclara irrecevables les questions
de constitutionnalité que le tribunal de Milan avait soulevées devant elle,
celles-ci ayant déjà été traitées dans son arrêt no 151/2009.
4. L’ordonnance de la Cour constitutionnelle no 150 du 22 mai 2012
33. Par
cette ordonnance, qui se référait à l’arrêt S.H.
et autres c. Autriche ([GC], no 57813/00, CEDH 2011), la Cour
constitutionnelle renvoya devant le juge du fond l’affaire qui avait été portée
devant elle et qui concernait l’interdiction du recours à la fécondation
hétérologue édictée par la loi no 40/2004.
5. L’arrêt de la Cour constitutionnelle no 162 du 10 juin 2014
34. Cet
arrêt porte sur la constitutionnalité de l’interdiction absolue d’accéder à la
fécondation hétérologue en cas de stérilité ou d’infertilité médicalement
prouvée, telle que prévue par la loi no 40/2004.
35. Trois
juridictions de droit commun avaient saisi la Cour constitutionnelle de la
question de savoir si la loi litigieuse était compatible avec les articles 2
(droits inviolables), 3 (principe d’égalité), 29 (droit de la famille), 31
(obligations de l’État pour la protection du droit de la famille) et 32 (droit
à la santé) de la Constitution. L’une d’entre elles, le tribunal de Milan,
avait aussi demandé à la Cour de se prononcer sur la compatibilité de la loi en
question avec les articles 8 et 14 de la Convention.
36. La
Cour constitutionnelle jugea inconstitutionnelles les dispositions législatives
pertinentes.
37. Elle
considéra notamment que le choix des demandeurs à l’instance de devenir parents
et de fonder une famille avec des enfants relevait de leur liberté d’autodétermination
concernant la sphère de leur vie privée et familiale et protégée en tant que
telle par les articles 2, 3 et 31 de la Constitution. Elle précisa également
que ceux qui étaient atteints d’infertilité ou de stérilité totale étaient
titulaires d’un droit à la protection de leur santé (article 32 de la
Constitution).
38. Elle
estima que si les droits en question pouvaient faire l’objet de limitations
inspirées par des considérations d’ordre éthique, ces limitations ne pouvaient
se traduire en une interdiction absolue, sauf s’il s’avérait impossible de
protéger autrement d’autres libertés constitutionnellement garanties.
39. Pour
ce qui est de la compatibilité des dispositions législatives en cause avec les
articles 8 et 14 de la Convention, la Cour constitutionnelle se borna à
observer que les questions y relatives étaient couvertes par les conclusions
auxquelles elle était parvenue sur la constitutionnalité des dispositions en
question (voir ci-dessus).
H. Les
ordonnances des tribunaux nationaux en matière d’accès au diagnostic
préimplantatoire
1. L’ordonnance du tribunal de Cagliari du 22 septembre
2007
40. Dans
cette ordonnance, le tribunal de Cagliari rappela que les demandeurs avaient d’abord
introduit une procédure en urgence, dans le cadre de laquelle une question de
constitutionnalité avait été soulevée. Il ajouta que cette question avait
ensuite été déclarée irrecevable par une ordonnance no 396 de la
Cour constitutionnelle rendue le 24 octobre 2006 (voir les paragraphes
27-28 ci-dessus), et que cette ordonnance n’avait donc fourni aucune indication
quant à l’interprétation qu’il convenait de donner au droit interne à la
lumière de la Constitution.
41. Quant
à la procédure civile introduite devant lui, il releva qu’il n’existait pas, en
droit interne, d’interdiction expresse d’accès au diagnostic préimplantatoire,
et qu’une interprétation de la loi concluant à l’existence d’une telle
interdiction aurait été contraire au droit des demandeurs d’être dûment
informés du traitement médical qu’ils entendaient entreprendre.
42. En
outre, il nota que des interdictions de recourir au diagnostic préimplantatoire
avait été introduites ultérieurement par une norme de rang secondaire, à savoir
le décret du ministère de la Santé no 15165 du 21 juillet 2004
(notamment dans la partie où celui-ci dispose que « [les] examens de l’état
de santé d’embryons créés in vitro, au sens de l’article 14, alinéa 5 [de la
loi no 40 de 2004], ne peuvent viser qu’à l’observation de ceux-ci –
« dovrà essere di tipo
osservazionale » -). Il estima que cela était contraire au principe de
légalité ainsi qu’à la « Convention d’Oviedo » du Conseil de l’Europe.
43. Il
releva enfin qu’une interprétation de la loi no 40/2004 permettant l’accès
au diagnostic préimplantatoire était conforme au droit à la santé reconnu à la
mère. En conséquence, il autorisa les demandeurs à accéder au diagnostic
préimplantatoire.
2. L’ordonnance du tribunal de Florence du 17 décembre
2007
44. Dans
cette ordonnance, le tribunal de Florence se référa à l’ordonnance du tribunal
de Cagliari citée ci-dessus et déclara partager l’interprétation que celui-ci
avait donnée du droit interne. En conséquence, il autorisa les demandeurs à
accéder au diagnostic préimplantatoire.
3. L’ordonnance du tribunal de Bologne
du 29 juin 2009
45. Par
cette ordonnance, le tribunal de Bologne autorisa les demandeurs à accéder au
diagnostic préimplantatoire, indiquant que cette pratique se conciliait avec la
protection de la santé de la femme reconnue par l’interprétation que la Cour
constitutionnelle avait donnée du droit interne dans son arrêt no 151
du 1er avril 2009 (voir les paragraphes 29-31 ci-dessus).
4. L’ordonnance du tribunal de Salerne du 9 janvier 2010
46. Dans
cette ordonnance, rendue à l’issue d’une procédure en référé, le tribunal de
Salerne rappela les nouveautés introduites par le décret du ministère de la
Santé no 31639 du 11 avril 2008, à savoir le fait que les
examens de l’état de santé d’embryons créés in
vitro n’étaient plus limités à l’observation de ceux-ci et que l’accès à la
procréation assistée était autorisé pour les couples dont l’homme était porteur
de maladies virales sexuellement transmissibles.
47. Il
en déduisit que le diagnostic préimplantatoire ne pouvait être considéré que
comme l’une des techniques de surveillance prénatale visant à connaître l’état
de santé de l’embryon.
48. En
conséquence, il autorisa la réalisation d’un diagnostic préimplantatoire sur l’embryon
in vitro des demandeurs.
5. L’ordonnance du
tribunal de Cagliari du 9 novembre 2012
49. Dans
cette ordonnance, le tribunal de Cagliari renvoya aux considérations
développées dans les ordonnances citées ci-dessus. En outre, il indiqua qu’il
ressortait des arrêts nos 348 et 349 rendus par la Cour
constitutionnelle le 24 octobre 2007 qu’une interprétation de la loi
visant à garantir l’accès au diagnostic préimplantatoire se conciliait avec la
Convention européenne des droits de l’homme, compte tenu notamment de l’arrêt
rendu par la Cour de Strasbourg dans l’affaire Costa et Pavan c. Italie (no 54270/10,
28 août 2012).
6. L’ordonnance du tribunal de Rome du 15 janvier 2014
50. Par
cette ordonnance, le tribunal souleva la question de la constitutionnalité des
articles 1, alinéas 1 et 2, et 4, alinéa 1 de la loi no 40/2004,
dispositions interdisant aux couples non stériles et non infertiles d’avoir
recours aux techniques de la procréation médicalement assistée en vue de
réaliser un diagnostic préimplantatoire. Il se plaça aussi sur le terrain des
articles 8 et 14 de la Convention.
51. Tout
en tenant compte de l’arrêt Costa et
Pavan c. Italie (précité), il estima qu’on ne pouvait procéder à une
interprétation extensive de la loi, laquelle énonçait expressément que l’accès
aux techniques de procréation médicalement assistée était réservé aux couples
stériles ou infertiles.
I. La
question de la constitutionnalité de l’article 13 de la loi no 40/2004
soulevée par le tribunal de Florence
52. Par une
décision du 7 décembre 2012, le tribunal de Florence souleva la question de
la constitutionnalité de l’interdiction du don d’embryons surnuméraires à la
recherche scientifique découlant de l’article 13 de la loi no 40/2004
au regard des articles 9 et 32 de la Constitution, lesquels garantissent
respectivement la liberté de la recherche scientifique et le droit à la santé.
53. Le
19 mars 2014, le président de la Cour constitutionnelle a ajourné l’examen de
cette affaire dans l’attente de la décision que la Grande Chambre prendra sur
la requête Parrillo c. Italie no
46470/11.
III. DOCUMENTS DU CONSEIL DE L’EUROPE
A. Recommandation
1046 (1986) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à l’utilisation
d’embryons et fœtus humains à des fins diagnostiques, thérapeutiques,
scientifiques, industrielles et commerciales
« (...)
6. [L’Assemblée
parlementaire] Consciente de ce que [le] progrès [de la science et de la
technologie médicale]
a rendu particulièrement précaire la condition
juridique de l’embryon et du fœtus, et que leur statut juridique n’est
actuellement pas déterminé par la loi ;
7. Consciente
de ce qu’il n’existe pas de dispositions adéquates réglant l’utilisation d’embryons
et fœtus vivants ou morts ;
8. Convaincue
de ce que, face au progrès scientifique qui permet d’intervenir dès la
fécondation sur la vie humaine en développement, il est urgent de déterminer le
degré de sa protection juridique ;
9. Tenant
compte du pluralisme des opinions s’exprimant sur le plan éthique à propos de l’utilisation
d’embryons ou de fœtus, ou de leurs tissus, et des conflits de valeurs qu’il
provoque ;
10. Considérant
que l’embryon et le fœtus humains doivent bénéficier en toutes circonstances du
respect dû à la dignité humaine, et que l’utilisation de leurs produits et
tissus doit être limitée de manière stricte et réglementée (...) en vue de fins
purement thérapeutiques et ne pouvant être atteintes par d’autres moyens ; (...)
13. Soulignant
la nécessité d’une coopération européenne,
14. Recommande
au Comité des Ministres :
A. d’inviter
les gouvernements des États membres :
(...)
ii. à limiter l’utilisation
industrielle des embryons et de fœtus humains, ainsi que de leurs produits et
tissus, à des fins strictement thérapeutiques et ne pouvant être atteintes par
d’autres moyens, selon les principes mentionnés en annexe, et à conformer leur
droit à ceux-ci, ou à adopter des règles conformes, ces règles devant notamment
préciser les conditions dans lesquelles le prélèvement et l’utilisation dans un
but diagnostique ou thérapeutique peuvent être effectués ;
iii. à interdire
toute création d’embryons humains par fécondation in vitro à des fins de recherche de leur vivant ou après leur mort
;
iv. à interdire
tout ce qu’on pourrait définir comme des manipulations ou déviations non
désirables de ces techniques, entre autres :
(...)
- la
recherche sur des embryons humains viables ;
- l’expérimentation sur des
embryons vivants, viables ou non (...) »
B. Recommandation
1100 (1989) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’utilisation
des embryons et fœtus humains dans la recherche scientifique
« (...)
7. Considérant que l’embryon humain, bien qu’il se
développe en phases successives indiquées par diverses dénominations (...),
manifeste aussi une différenciation progressive de son organisme et maintient
néanmoins en continuité son identité biologique et génétique,
8. Rappelant
la nécessité d’une coopération européenne et d’une réglementation aussi large
que possible qui permettent de surmonter les contradictions, les risques et l’inefficacité
prévisible de normes exclusivement nationales dans les domaines concernés,
(...)
21. La création
et/ou le maintien en vie intentionnels d’embryons ou fœtus, in vitro ou in utero, dans un but de recherche scientifique, par exemple pour
en prélever du matériel génétique, des cellules, des tissus ou des organes,
doivent être interdits. (...) »
54. Les
passages pertinents de l’annexe à cette recommandation se lisent ainsi :
« B. Sur des
embryons préimplantatoires vivants : (...)
4. Conformément
aux Recommandations 934 (1982) et 1046 (1986), les recherches in vitro sur des embryons viables ne
doivent être autorisées que:
– s’il
s’agit de recherches appliquées de caractère diagnostique ou effectuées à des
fins préventives ou thérapeutiques;
– si
elles n’interviennent pas sur leur patrimoine génétique non pathologique.
5. (...) les
recherches sur les embryons vivants doivent être interdites, notamment:
– si
l’embryon est viable;
– s’il
y a la possibilité d’utiliser un modèle animal;
– si
ce n’est pas prévu dans le cadre de projets dûment présentés et autorisés par
les autorités sanitaires ou scientifiques compétentes ou, par délégation, par
la commission nationale multidisciplinaire concernée;
– si
elles ne respectent pas les délais prescrits par les autorités susdites.
(...)
H. Don
d’éléments du matériel embryonnaire humain : (...)
20. Le don d’éléments
du matériel embryonnaire humain doit être autorisé uniquement s’il a pour but
la recherche scientifique, à des fins diagnostiques, préventives ou
thérapeutiques. Sa vente sera interdite.
21. La création
et/ou le maintien en vie intentionnels d’embryons ou fœtus, in vitro ou in utero, dans un but de recherche scientifique, par exemple pour
en prélever du matériel génétique, des cellules, des tissus ou des organes,
doivent être interdits.
22. Le don et l’utilisation
d’éléments du matériel embryonnaire humain ne doivent être permis que si les
géniteurs ont donné librement et par écrit leur consentement préalable.
23. Le don d’organes
doit être dépourvu de tout caractère mercantile. L’achat et la vente d’embryons,
de fœtus ou de leurs composants par les géniteurs ou des tiers, de même que
leur importation ou leur exportation, doivent également être interdits.
24. Le don et l’emploi
de matériels embryonnaires humains dans la fabrication d’armes biologiques
dangereuses et exterminatrices doivent être interdits.
25. Pour l’ensemble
de la présente recommandation, par « viables » on entend les embryons
qui ne présentent pas de caractéristiques biologiques susceptibles d’empêcher
leur développement; d’autre part, la non-viabilité des embryons et des fœtus
humains devra être déterminée exclusivement par des critères biologiques
objectifs, fondés sur les défectuosités intrinsèques de l’embryon. »
C. La
Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine
(« Convention d’Oviedo ») du 4 avril 1997
Article 2 – Primauté de l’être
humain
« L’intérêt et le bien de l’être
humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. »
Article 18 – Recherche sur
les embryons in vitro
« 1. Lorsque la
recherche sur les embryons in vitro
est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l’embryon.
2. La
constitution d’embryons humains aux fins de recherche est interdite. »
Article 27 – Protection
plus étendue
« Aucune
des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant
ou portant atteinte à la faculté pour chaque Partie d’accorder une protection
plus étendue à l’égard des applications de la biologie et de la médecine que
celle prévue par la présente Convention. »
D. Protocole
additionnel à la Convention d’Oviedo, relatif à la recherche biomédicale du 25
janvier 2005
Article 2 – Champ d’application
« 1. Le présent
Protocole s’applique à l’ensemble des activités de recherche dans le domaine de
la santé impliquant une intervention sur l’être humain.
2. Le
Protocole ne s’applique pas à la recherche sur les embryons in vitro. Il s’applique à la recherche
sur les fœtus et les embryons in vivo.
(...) »
E. Le
rapport du groupe de travail sur la protection de l’embryon et du fœtus humains
du Comité directeur pour la bioéthique, rendu public le 19 juin 2003 –
Conclusion
« Ce
rapport a pour but de présenter une vue d’ensemble des positions actuelles en
Europe sur la protection de l’embryon humain in vitro et des arguments qui les sous-tendent.
Il montre
un large consensus sur la nécessité d’une protection de l’embryon in vitro. Néanmoins, la définition du
statut de l’embryon reste un domaine où l’on rencontre des différences
fondamentales reposant sur des arguments forts. Ces divergences sont, dans une
large mesure, à l’origine de celles rencontrées sur les questions ayant trait à
la protection de l’embryon in vitro.
Toutefois,
même en l’absence d’accord sur le statut de l’embryon, la possibilité de réexaminer
certaines questions à la lumière des récents développements dans le domaine
biomédical et des avancées thérapeutiques potentielles, pourrait être
envisagée. Dans ce contexte, tout en reconnaissant et respectant les choix
fondamentaux des différents pays, il semble possible et souhaitable – au regard
de la nécessité de protéger l’embryon in
vitro reconnue par tous les pays – d’identifier des approches communes afin
d’assurer des conditions adéquates d’application des procédures impliquant la
constitution et l’utilisation d’embryons in
vitro. Ce rapport se veut une aide à la réflexion vers cet objectif. »
F. Résolution
1352 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe concernant la
recherche sur les cellules souches humaines
« (...) 3. Les
cellules souches humaines peuvent provenir d’un nombre croissant de tissus et
de fluides présents dans le corps d’êtres humains de tous âges, et pas seulement
de sources embryonnaires.
(...)
5. Le
prélèvement de cellules souches embryonnaires implique pour le moment la destruction
d’embryons humains.
(...)
7. L’Assemblée
fait observer que nombre de lignées de cellules souches embryonnaires humaines
susceptibles de servir à la recherche scientifique sont déjà disponibles dans
le monde.
(...)
10. La
destruction d’êtres humains à des fins de recherche est contraire au droit de tout être humain à la vie
et à l’interdiction morale de toute instrumentalisation de l’être humain.
11. En
conséquence, l’Assemblée invite les États membres:
i. à favoriser la recherche
sur les cellules souches à condition qu’elle respecte la vie des êtres humains
à tous les stades de leur développement;
ii. à encourager les
techniques scientifiques qui ne sont pas controversées des points de vue social
et éthique afin de tirer un meilleur parti de la pluripotence cellulaire et de
mettre au point de nouvelles méthodes de médecine régénérative;
iii. à signer et à
ratifier la Convention d’Oviedo pour rendre effective l’interdiction de la
constitution d’embryons humains aux fins de recherche;
iv. à promouvoir des
programmes de recherche fondamentale européens communs portant sur les cellules
souches adultes;
v. à garantir que,
dans les pays où de telles recherches sont admises, toute recherche sur des
cellules souches impliquant la destruction d’embryons humains est dûment
autorisée et surveillée par les instances nationales appropriées;
vi. à respecter les
décisions des pays lorsque ceux-ci choisissent de ne pas participer à des
programmes internationaux de recherche contraires aux valeurs éthiques
consacrées par leur législation nationale et à ne pas escompter que ces pays
contribuent directement ou indirectement à ces recherches;
vii. à privilégier l’éthique
de la recherche plutôt que les aspects purement utilitaires et financiers;
viii. à promouvoir la
création de structures permettant à des scientifiques et à des représentants de
la société civile d’examiner différents types de projets de recherche sur les
cellules souches humaines, en vue d’augmenter la transparence et la responsabilité
démocratique. »
G. Recommandation
du Comité des Ministres aux États membres sur la recherche utilisant du
matériel biologique d’origine humaine (Rec (2006)4, adoptée par le Comité des
Ministres le 15 mars 2006)
55. Cette
recommandation, qui ne s’applique pas aux matériels biologiques embryonnaires
et fœtaux (article 2 § 3), a pour but de sauvegarder les droits fondamentaux
des personnes dont le matériel biologique pourrait être inclus dans un projet
de recherche après avoir été recueilli et stocké i) pour un projet de recherche
spécifique antérieur à l’adoption de la recommandation, ii) pour des recherches
futures non spécifiées ou iii) comme matériel résiduel initialement prélevé à
des fins cliniques ou médico-légales. Cette recommandation vise, entre autres,
à promouvoir la mise en place de codes de bonnes pratiques de la part des États
membres et à réduire au minimum les risques liés aux activités de recherche
concernant la vie privée des personnes. Elle fixe également des règles
régissant l’obtention et les collections de matériel biologique.
H. « L’éthique
dans la science et la technologie », Résolution 1934 (2013) de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
« 2. ...) l’Assemblée
estime qu’une réflexion éthique plus concertée devrait être menée aux niveaux
national, suprarégional et mondial sur les objectifs et les usages de la
science et de la technologie, sur les instruments et méthodes qu’elles
emploient, sur leurs possibles conséquences et effets indirects, et sur le
système global de règles et de comportements dans lequel elles s’inscrivent.
3. L’Assemblée
considère qu’une structure permanente de réflexion éthique au niveau mondial
permettrait de traiter les questions éthiques comme une « cible mouvante»,
au lieu de fixer un « code éthique », et de remettre à plat, de
manière périodique, les concepts en vigueur, même les plus fondamentaux, comme
la définition de l’« identité humaine » ou de la « dignité
humaine ».
4 L’Assemblée
salue l’initiative de l’UNESCO qui a créé la Commission mondiale d’éthique des
connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) en vue d’engager une
réflexion éthique permanente et d’étudier les possibilités de rédiger et de
réviser périodiquement un ensemble de principes éthiques fondamentaux fondés
sur la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle considère que le
Conseil de l’Europe devrait contribuer à ce processus.
5. À cet
égard, l’Assemblée recommande au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe d’envisager
la création d’une structure souple et informelle de réflexion éthique, par le
biais d’une coopération entre les commissions compétentes de l’Assemblée et les
membres des comités d’experts concernés, parmi lesquels le Comité de bioéthique
(DH-BIO), en vue d’identifier les nouveaux enjeux éthiques et les principes
éthiques fondamentaux susceptibles d’orienter l’action politique et juridique
en Europe.
6. Pour
renforcer le cadre européen commun d’éthique dans la science et la technologie,
l’Assemblée recommande aux États membres qui ne l’ont pas encore fait de signer
et de ratifier la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la
dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la
médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE no 164,
« Convention d’Oviedo ») et ses protocoles, et de participer
pleinement aux travaux du Comité de bioéthique.
(...)
10. L’Assemblée
invite l’Union européenne et l’UNESCO à coopérer avec le Conseil de l’Europe
pour renforcer le cadre européen commun d’éthique dans la science et la
technologie, et, à cette fin:
10.1. à créer des
plates-formes européennes et régionales permettant d’échanger régulièrement des
expériences et des bonnes pratiques couvrant tous les domaines de la science et
de la technologie, en utilisant l’expérience acquise dans le cadre de la
Conférence européenne des comités nationaux d’éthique (COMETH) lancée par le
Conseil de l’Europe et, plus récemment, du Forum des comités nationaux d’éthique
(Forum des CNE) financé par la Commission européenne, et des réunions du Comité
de bioéthique du Conseil de l’Europe;
10.2. à rédiger
et à réviser périodiquement un ensemble de principes éthiques fondamentaux à
appliquer dans tous les domaines de la science et de la technologie;
10.3. à proposer
des orientations supplémentaires pour aider les États membres à harmoniser les
règles éthiques et les procédures de suivi, en s’appuyant sur les effets
positifs des exigences éthiques énoncées dans le septième programme-cadre de la
Commission européenne pour des actions de recherche et de développement
technologique (2007-2013) (7e PC). »
IV. DROIT ET ÉLÉMENTS PERTINENTS DE L’UNION
EUROPÉENNE
A. Le
Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) auprès
de la Commission européenne
56. Mis
en place en 1991 par la Commission européenne, le GEE est un organisme
indépendant composé d’experts ayant pour mission de soumettre des avis à la
Commission européenne sur les questions éthiques liées à la science et aux
nouvelles technologies. Le GEE a rendu deux avis concernant l’utilisation d’embryons
in vitro à fins de recherche.
1. Avis no 12 : Les aspects éthiques de la
recherche impliquant l’utilisation d’embryons humains dans le contexte du Vème programme-cadre
de recherche, 14 novembre 1998
57. Cet
avis a été publié à la demande de la Commission européenne à la suite de la
proposition du Parlement européen d’exclure des financements européens les
projets de recherche impliquant la destruction d’embryons humains dans le cadre
du cinquième programme-cadre. Ses passages pertinents se lisent comme
suit :
« (...)
2.6. (...) Dans le cadre des programmes de recherche européens, la question de
la recherche sur l’embryon humain doit être envisagée tant du point de vue du
respect des principes éthiques fondamentaux communs à tous les États membres qu’en
tenant compte de la diversité des conceptions philosophiques et éthiques
exprimées à travers les différentes pratiques et réglementations nationales en
vigueur en ce domaine. (...)
2.8. à la lumière des principes et précisions
précédemment évoqués, le Groupe estime qu’il est conforme à la dimension
éthique du cinquième programme-cadre communautaire de ne pas exclure a priori des financements communautaires
les recherches sur l’embryon humain qui font l’objet de choix éthiques
divergents selon les pays. [...] »
2. Avis no 15 : Aspects éthiques de la
recherche sur les cellules souches humaines et leur utilisation, 14 novembre
2000
58. Les passages pertinents de cet avis
sont ainsi libellés :
« 2.3. Pluralisme
et éthique européenne
(...) Dans
le contexte du pluralisme européen, il appartient à chaque État membre d’interdire
ou d’autoriser les recherches sur l’embryon. Dans ce dernier cas, le respect de
la dignité humaine implique que l’on règlemente les recherches sur l’embryon et
que l’on prévoie des garanties contre le risque d’expérimentation arbitraire et
d’instrumentalisation de l’embryon humain.
2.5. Acceptabilité
éthique du domaine de recherche concerné
Le Groupe
note que, dans certains pays, la recherche sur l’embryon est interdite. En
revanche, dans les pays où elle est autorisée afin d’améliorer le traitement de
l’infertilité, on peut difficilement trouver un argument à invoquer pour une
extension du champ de ces recherches visant à mettre au point de nouveaux
traitements contre les maladies ou lésions graves. En effet, comme dans le cas
de la recherche sur l’infertilité, la recherche sur les cellules souches vise à
soulager la souffrance humaine. Dans tous les cas, les embryons qui ont servi
pour des travaux de recherche sont destinés à être détruits. Par conséquent, il
n’y a pas d’argument pour exclure le financement de ce type de recherches au
titre du programme-cadre de recherche de l’Union européenne si elles satisfont
aux exigences éthique et légales définies dans ce programme. »
B. Règlement
no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du
13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et
modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no
726/2004
« (7) Il
importe que la réglementation des médicaments de thérapie innovante au niveau
communautaire ne porte pas atteinte aux décisions prises par les États membres
concernant l’opportunité d’autoriser l’utilisation de tel ou tel type de
cellules humaines, par exemple les cellules souches embryonnaires, ou de
cellules animales. Il convient qu’elle n’influence pas non plus l’application
des législations nationales interdisant ou limitant la vente, la distribution
ou l’utilisation de médicaments contenant de telles cellules, consistant dans
de telles cellules ou issus de celles-ci. »
C. L’arrêt
de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 octobre 2011 (C-34/10 Oliver Brüstle c. Greenpeace eV)
59. Par
cet arrêt, rendu sur renvoi préjudiciel de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) allemande, la Cour de
justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation à donner à
la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet
1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
60. La
partie de la directive en cause était celle qui, tempérant le principe selon
lequel l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou
commerciales n’est pas brevetable, précise que cette exclusion ne concerne pas
« les inventions ayant un objectif thérapeutique ou diagnostique qui s’appliquent
à l’embryon humain et lui sont utiles ».
61. La
Cour de justice a précisé que la directive litigieuse ne vise pas à réglementer
l’utilisation d’embryons humains dans le cadre de recherches scientifiques :
son objet se limite à la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Elle a
ensuite estimé que les inventions qui impliquent l’utilisation d’embryons
humains restent exclues de toute brevetabilité même lorsqu’elles peuvent se
revendiquer d’une finalité de recherche scientifique (une telle finalité ne
pouvant pas, en matière de brevets, être distinguée des autres fins
industrielles et commerciales). La Cour de justice a indiqué en même temps que
les inventions impliquant une utilisation à des fins thérapeutiques ou de
diagnostic applicable à l’embryon humain et utile à celui-ci ne sont pas
concernées par cette exclusion.
D. Les
financements de l’Union européenne en matière de recherche et de développement
technologique
62. Depuis
1984, l’Union européenne déploie des fonds pour la recherche scientifique à
travers des programmes-cadres couvrant des périodes qui s’étalent sur plusieurs
années.
63. Les
parties pertinentes de la décision no 1982/2006/CE relative au septième programme-cadre de la Communauté
européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de
démonstration (2007-2013) se lisent comme suit :
Article 6 – Principes éthiques
« 1. Toutes
les actions de recherche menées au titre du septième programme-cadre sont
réalisées dans le respect des principes éthiques fondamentaux.
2. Les activités de recherche suivantes ne font pas l’objet
d’un financement au titre du septième programme-cadre:
|
- les
activités de recherche visant au clonage humain à des fins reproductives; |
|
|
- les
activités de recherche visant à modifier le patrimoine génétique d’êtres
humains, qui pourraient rendre cette altération héréditaire, |
|
|
- les
activités de recherche visant à créer des embryons humains uniquement à des
fins de recherche ou pour l’approvisionnement en cellules souches, y compris
par transfert de noyau de cellules somatiques. |
3. Les
activités de recherche sur les cellules souches humaines, adultes ou
embryonnaires, peuvent être financées en fonction à la fois du contenu de la
proposition scientifique et du cadre juridique de(s) l’État(s) membre(s)
intéressé(s). (...) »
64. Les
parties pertinentes du Règlement no 1291/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour
la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) se lisent
ainsi :
Article 19 – Principes
éthiques
« 1. Toutes les
activités de recherche et d’innovation menées au titre d’Horizon 2020
respectent les principes éthiques et les législations nationales, européennes
et internationales pertinentes, y compris la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme et
ses protocoles additionnels (...).
(...)
3. Sont exclus
de tout financement les domaines de recherche suivants:
a) les
activités de recherche en vue du clonage humain à des fins de reproduction;
b) les
activités de recherche visant à modifier le patrimoine génétique d’êtres
humains, qui pourraient rendre cette altération héréditaire ;
c) les
activités de recherche visant à créer des embryons humains uniquement à des
fins de recherche ou pour l’approvisionnement en cellules souches, notamment
par transfert nucléaire de cellules somatiques.
4. Les
activités de recherche sur les cellules souches humaines, adultes et
embryonnaires, peuvent être financées en fonction à la fois du contenu de la
proposition scientifique et du cadre juridique des États membres intéressés.
Aucun financement n’est accordé aux activités de recherche interdites dans l’ensemble
des États membres. Aucune activité n’est financée dans un État membre où ce
type d’activités est interdit.
(...) »
E. La
Communication de la Commission européenne relative à l’initiative citoyenne
européenne « Un de nous » COM(2014) 355 final (Bruxelles, 28 mai
2014)
65. Le
10 avril 2014, l’initiative citoyenne « Un de nous » avait proposé
des modifications législatives tendant à exclure des financements européens les
projets scientifiques impliquant la destruction d’embryons humains.
66. Dans
sa communication du 28 mai 2014, la Commission européenne a considéré
qu’elle ne pouvait pas faire droit à cette demande au motif que sa proposition
de financement des projets en question tenait compte de considérations
éthiques, des avantages potentiels pour la santé et du soutien de l’Union à la
recherche sur les cellules souches.
V. ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL
PERTINENTS
A. Le
rapport du Comité international de bioéthique de l’UNESCO (CIB) sur les aspects
éthiques des recherches sur les cellules embryonnaires (6 avril 2001)
67. Les
parties pertinentes des conclusions de ce rapport se lisent comme suit:
« A. Le CIB
reconnaît que les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines
sont une question sur laquelle il est souhaitable qu’un débat s’engage au
niveau national pour déterminer quelle position doit être adoptée au sujet de
ces recherches, même si cette position vise à ce qu’elles ne soient pas menées.
Il préconise que des débats s’engagent dans les instances nationales
appropriées, permettant l’expression d’une pluralité d’opinions, en vue, dans
toute la mesure du possible, de parvenir à un consensus fixant les limites de
ce qui est acceptable dans ce champ nouveau et important de la recherche
thérapeutique.
Un
processus permanent d’éducation et d’information dans ce domaine devrait s’instaurer.
Les États devraient prendre les mesures appropriées pour amorcer un dialogue
continu au sein de la société sur les questions éthiques soulevées par ces
recherches, associant tous les acteurs concernés.
B. Quel que
soit le type de recherches autorisé concernant l’embryon, des mesures devraient
être prises pour garantir que ces recherches sont menées dans un cadre législatif
ou réglementaire qui accorderait le poids nécessaire aux considérations
éthiques et fixerait des principes directeurs adéquats. Si l’on envisage d’autoriser
que des dons d’embryons surnuméraires au stade préimplantatoire, provenant de
traitements de FIV, soient consentis pour des recherches sur les cellules
souches embryonnaires à des fins thérapeutiques, une attention particulière
sera accordée à la dignité et aux droits des deux parents donneurs. Il est donc
essentiel que le don n’ait lieu qu’après que les donneurs ont été pleinement
informés des implications de ces recherches et ont donné leur consentement
préalable, libre et éclairé. Les finalités de ce type de recherches et la
manière dont elles sont conduites devraient faire l’objet d’une évaluation par
les comités d’éthique appropriés, qui devraient être indépendants des
chercheurs concernés. Dans ce processus, il faudrait prévoir une évaluation a
posteriori de ces recherches. (...) »
B. L’arrêt
Murillo et autres c. Costa Rica de la
Cour interaméricaine des droits de l’homme (28 novembre 2012)
68. Dans cette affaire, la Cour
interaméricaine s’est prononcée sur l’interdiction d’effectuer des fécondations
in vitro au Costa Rica. Elle a
estimé, entre autres, que l’embryon ne pouvait pas être considéré comme une
« personne » au sens de l’article 4 § 1 de la Convention américaine
relative aux droits de l’homme (qui protège le droit à la vie), la
« conception » n’ayant lieu qu’à partir du moment où l’embryon est
implanté dans l’utérus.
VI. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
69. D’après
les informations dont la Cour dispose sur la législation de quarante États
membres[1] en
matière d’utilisation d’embryons humains à des fins de recherche scientifique,
trois pays
(la Belgique,
la Suède et le Royaume-Uni) autorisent la recherche scientifique sur des
embryons humains aussi bien que la création de tels embryons à des fins de
recherche.
70. La
création d’embryons pour la recherche scientifique est interdite dans quatorze
pays[2].
Toutefois, la recherche sur les embryons surnuméraires y est généralement
permise, sous certaines conditions.
71. À
l’instar de l’Italie, trois États membres (la Slovaquie, l’Allemagne et l’Autriche)
interdisent en principe les recherches scientifiques sur les embryons, ne les
autorisant que dans des cas très restreints, notamment lorsqu’elles visent à la
protection de la santé de l’embryon ou lorsqu’elles sont menées sur des lignées
cellulaires provenant de l’étranger.
72. En
Slovaquie, les recherches sur des embryons sont strictement interdites, sauf
celles à caractère thérapeutique qui visent à apporter un bénéfice en termes de
santé aux personnes qui y participent directement.
73. En
Allemagne, l’importation et l’utilisation de cellules embryonnaires à des fins
de recherche sont en principe interdites par la loi. Elles ne sont autorisées
qu’à titre exceptionnel, sous de strictes conditions.
74. Quant
à l’Autriche, la loi dispose que les « cellules viables » ne peuvent
être utilisées pour des fins autres que la fertilisation in vitro. Toutefois, la notion de « cellules viables » n’y
est pas définie. D’après la pratique et la doctrine, l’interdiction prévue par
la loi ne concernerait que les cellules embryonnaires dites
« totipotentes »[3].
75. Dans
quatre pays (Andorre, Lettonie, Croatie et Malte), la loi interdit expressément
toute recherche sur les cellules souches embryonnaires.
76. Seize
pays ne prévoient pas de réglementation en la matière. Il s’agit de l’Arménie,
de l’Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, de l’Irlande,
du Liechtenstein, de la Lituanie, du Luxembourg, de la République de Moldova, de Monaco, de la Pologne, de la Roumanie, de
la Russie, de Saint-Marin, de la Turquie et de l’Ukraine. Parmi ces États,
certains ont une pratique plutôt restrictive (par exemple, la Turquie et l’Ukraine),
d’autres une pratique plutôt permissive (par exemple, la Russie).
EN DROIT
77. La
Cour relève d’emblée que le Gouvernement oppose plusieurs exceptions à la
recevabilité de la présente requête. Il avance notamment que la requérante n’a
pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne, qu’elle
n’a pas introduit sa requête dans le délai de six mois prévu par l’article 35 §
1 de la Convention, et qu’elle n’a pas la qualité de victime. La Cour examinera
ces exceptions ci-dessous avant d’analyser les autres aspects de la requête.
I. SUR LE NON-ÉPUISEMENT DES VOIES DE
RECOURS INTERNES
A. Position du
Gouvernement
78. Le Gouvernement avance qu’il était
loisible à la requérante de se plaindre de l’interdiction de donner ses
embryons à la recherche scientifique devant le juge du fond en soutenant que l’interdiction
en cause était contraire tant à la Constitution italienne qu’à la Convention
européenne des droits de l’homme. à
cet égard, il cite plusieurs décisions internes dans lesquelles les tribunaux
nationaux ont interprété la loi no 40/2004 à la lumière de la
Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme, en
particulier en ce qui concerne l’accès au diagnostic préimplantatoire (les
ordonnances rendues par le tribunal de Cagliari le 22 septembre 2007 et le
9 novembre 2012, ainsi que celles adoptées par les tribunaux de Florence, de
Bologne et de Salerne le 17 décembre 2007, le 29 juin 2009 et le 9
janvier 2010 respectivement, voir les paragraphes 40-49 ci-dessus).
79. Selon lui, le juge du fond aurait
alors été tenu d’interpréter la loi dont découle l’interdiction litigieuse à la
lumière de la Convention, comme l’exigent les arrêts de la Cour
constitutionnelle nos 348 et 349 du 24 octobre 2007.
80. Si le juge du fond avait constaté l’existence
d’un conflit insurmontable entre son interprétation de la loi et les droits
invoqués par la partie demanderesse, il aurait eu l’obligation de soulever une
question de constitutionnalité. La Cour constitutionnelle aurait alors examiné
au fond la compatibilité des faits litigieux avec les droits de l’homme, et
elle aurait pu annuler les dispositions nationales avec effet rétroactif et erga omnes.
81. D’ailleurs, la Cour constitutionnelle
aurait déjà été saisie de plusieurs affaires concernant la constitutionnalité
de la loi no 40/2004. Un certain nombre de décisions auraient été
rendues à cet égard, notamment les ordonnances de la Cour constitutionnelle nos 369,
97 et 150 (prononcées le 24 octobre 2006, le 8 mars 2010 et le 22 mai 2012
respectivement), l’arrêt no 151 adopté par celle-ci le 1er
avril 2009, ainsi que les ordonnances des tribunaux de Florence et de Rome prononcées
le 7 décembre 2012 et le 15 janvier 2014 respectivement (voir les paragraphes
27-33 et 50-53 ci‑dessus).
82. Par ailleurs, la requérante aurait
aussi méconnu le principe de subsidiarité posé par le Protocole no
15 du 24 juin 2013 en se dispensant d’utiliser les voies de recours
internes avant de soulever ses griefs devant la Cour.
83. Enfin, une question de
constitutionalité concernant une affaire identique à la présente affaire aurait
été soulevée par le tribunal de Florence devant la Cour constitutionnelle (voir
les paragraphes 52-53 ci-dessus). Pour le cas où la haute juridiction prendrait
une décision défavorable à la partie demanderesse, il serait toujours loisible
à celle-ci d’introduire une requête devant la Cour.
B. Position de
la requérante
84. La requérante soutient que toute
action devant le juge ordinaire aurait été vouée à l’échec, le droit interne
interdisant de manière absolue le don d’embryons à des fins de recherche
scientifique.
85. En outre, elle avance que la voie
constitutionnelle ne peut être considérée comme étant un recours à épuiser au
sens de l’article 35 § 1 de la Convention, le système juridique italien n’ouvrant
pas de recours direct devant la Cour constitutionnelle.
86. Enfin, elle indique que, le 19 mars
2014, le président de la Cour constitutionnelle a ajourné l’examen de la
question soulevée par le tribunal de Florence à laquelle le Gouvernement se
réfère dans l’attente de la décision que la Grande Chambre prendra sur la
présente requête.
C. Appréciation
de la Cour
87. La
Cour rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention,
elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes.
Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette
disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à
savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se
fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la
violation alléguée. Les dispositions de l’article 35 § 1 ne
prescrivent toutefois l’épuisement que des seuls recours à la fois relatifs aux
violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré
suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans
quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État
défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi
beaucoup d’autres, McFarlane c. Irlande [GC],
no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15,
CEDH 2002‑VIII, Leandro Da Silva c.
Luxembourg, no 30273/07, §§ 40 et 42, 11 février 2010 et Vučković et autres c. Serbie [GC],
no 17153/11,
§§ 69-77, 25 mars 2014).
88. Dans la présente
affaire, s’appuyant sur le système de contrôle de constitutionnalité institué par les arrêts de la Cour constitutionnelle nos
348 et 349 du 24 octobre 2007, le Gouvernement soutient que les
voies de recours qui étaient ouvertes à la requérante en droit interne n’ont
pas été épuisées. À cet égard, il cite des exemples de décisions statuant au
fond et des décisions de la Cour constitutionnelle concernant la loi no
40/2004.
89. La Cour observe d’emblée que, par les arrêts nos
348 et 349 susmentionnés, la Cour constitutionnelle a défini la place de la
Convention des droits de l’homme dans les sources du droit interne, considérant
que celle-ci était une norme de rang intermédiaire entre la loi ordinaire et la
Constitution. En outre, elle a estimé qu’il incombait au juge du fond d’interpréter
la norme interne de manière conforme à la Convention des droits de l’homme et à
la jurisprudence de la Cour. Elle a précisé que, lorsqu’une telle
interprétation se révélait impossible ou que le juge du fond avait des doutes
quant à la compatibilité de la norme interne avec la Convention, celui-ci était
tenu de soulever une question de constitutionnalité devant elle.
90. La Cour rappelle
aussi qu’en l’absence d’un recours interne spécifique à la violation alléguée,
il appartient au Gouvernement de justifier, en s’appuyant sur la jurisprudence
interne, de l’évolution, de la disponibilité, de la portée et du champ d’application
du recours qu’il invoque (voir, mutatis
mutandis, Melnītis c. Lettonie,
no 30779/05, § 50, 28 février
2012, McFarlane précité,
§§ 115-127, Costa et Pavan c. Italie,
no 54270/10, § 37, 28 août 2012 et Vallianatos et
autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, §§ 52-58, CEDH 2013 (extraits)).
91. En l’espèce, la Cour constate que
le Gouvernement s’est référé à plusieurs affaires portant sur la loi no 40/2004
mais qu’il n’a fourni aucun exemple de décision interne ayant tranché la
question du don d’embryons surnuméraires à la recherche. La Cour ne saurait d’ailleurs
reprocher valablement à la requérante de ne pas avoir introduit de demande
visant à l’obtention d’une mesure interdite par la loi.
92. Quant à l’argument
du Gouvernement selon lequel, depuis l’adoption
des arrêts nos 348 et 349, le juge du fond a l’obligation d’interpréter
la loi dont découle l’interdiction litigieuse à la lumière de la Convention et
de la jurisprudence de Strasbourg alors qu’il n’y était pas tenu auparavant,
plusieurs considérations conduisent la Cour à conclure que cette assertion n’est
pas suivie, dans les faits, par une pratique juridictionnelle établie,
notamment dans le domaine de la procréation médicalement assistée.
93. La Cour relève, premièrement, que
dans une affaire similaire à celle de l’espèce et qui portait sur l’interdiction
de donner des embryons surnuméraires à la recherche scientifique, le tribunal
de Florence a
décidé, le 7 décembre 2012, de soulever devant la Cour constitutionnelle
la question de la constitutionnalité de l’article 13 de la loi no
40/2004 au regard des articles 9 et 32 de la Constitution, qui garantissent
respectivement la liberté de la recherche scientifique et le droit à la santé
(voir paragraphe 22 ci-dessus). La Cour constate toutefois qu’aucune question
tenant à la compatibilité de l’interdiction en cause avec les droits garantis
par la Convention n’a été soulevée par le juge du fond.
94. Elle note, deuxièmement, que, à
quelques exceptions près, les décisions des juges du
fond et de la Cour constitutionnelle relatives à la loi no 40/2004
citées par le Gouvernement (voir les paragraphes
78 et 81 ci‑dessus) ne se réfèrent pas à la Convention des droits
de l’homme. Tel est le cas des ordonnances nos 396/2006 et 97/2010 de la Cour constitutionnelle
ainsi que de son arrêt no 151/2009, des ordonnances des
tribunaux de Cagliari, de Florence, de Bologne et de Salerne adoptées le 22 septembre 2007,
le 17 décembre 2007, le 29 juin 2009 et le 9 janvier 2010
respectivement, ainsi que de la décision du tribunal de Florence du
7 décembre 2012.
95. Il est vrai que, dans l’ordonnance
no 150 du 22 mai 2012 par laquelle elle a renvoyé au juge du
fond une affaire qui portait sur l’interdiction de la fécondation hétérologue,
la Cour constitutionnelle s’est référée, entre autres, aux articles 8 et 14 de
la Convention. Force est de constater toutefois que, dans son arrêt no 162
du 10 juin 2014 concernant cette même affaire, la
Cour constitutionnelle n’a analysé l’interdiction litigieuse qu’à la lumière
des articles de la Constitution qui étaient en cause (à savoir les articles 2,
31 et 32). Quant aux articles 8 et 14 de la Convention, invoqués uniquement par
un des trois tribunaux du fond (voir le paragraphe 35 ci-dessus), elle s’est
bornée à observer que les questions soulevées sous l’angle de ces dispositions
étaient couvertes par les conclusions auxquelles elle était parvenue sur le
terrain de la Constitution (voir le paragraphe 39 ci-dessus).
96. Dans ces
conditions, les deux seules exceptions à l’absence de prise en compte de la
Convention et de sa jurisprudence sont constituées par les ordonnances des
tribunaux de Cagliari (du 9 novembre 2012) et de Rome (du 15 janvier 2014)
qui, eu égard aux conclusions de la Cour dans l’affaire Costa et Pavan (précité), ont respectivement garanti l’accès des
demandeurs au diagnostic préimplantatoire et soulevé une question de
constitutionnalité sur ce point devant la Cour constitutionnelle. Il n’en
demeure pas moins qu’il ne s’agit que de deux cas isolés sur les onze invoqués
par le Gouvernement, qui concernent un domaine différent de celui ici en cause
et sur lequel la Cour avait déjà statué.
97. De surcroit, la compatibilité de l’article
13 de la loi no 40/2004 avec les droits garantis par la Convention
étant une question nouvelle, la Cour n’est guère convaincue que la possibilité
offerte à la requérante de porter ses griefs devant un juge ordinaire constitue
un remède efficace.
98. Les arrêts nos 348 et 349
eux-mêmes apportent des précisions sur la différence des rôles respectifs de la
Cour de Strasbourg et de la Cour constitutionnelle en indiquant qu’il
appartient à la première d’interpréter la Convention et qu’il revient à la seconde
de rechercher s’il existe un conflit entre telle ou telle norme nationale et
les droits garantis par la Convention, à la lumière notamment de l’interprétation
fournie par la Cour européenne des droits de l’homme (voir le paragraphe 26
ci-dessus).
99. D’ailleurs,
la décision prise le 19 mars 2014 par le président de la Cour constitutionnelle
d’ajourner l’examen de la question posée le 7 décembre 2012 par le
tribunal de Florence en attendant que la Cour se prononce en l’espèce (voir le paragraphe
53 ci-dessus) s’inscrit dans cette logique.
100. Dans
ce contexte, la Cour relève que, dans un arrêt récent (no 49, déposé
le 26 mars 2015) où elle a analysé entre autres la place de la Convention
européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour dans l’ordre
juridique interne, la Cour constitutionnelle a indiqué que le juge du fond n’était
tenu de se conformer à la jurisprudence de la Cour que dans le cas où celle-ci
était « bien établie » ou était énoncée dans un « arrêt
pilote ».
101. En tout état de cause, la Cour a rappelé à maintes reprises que, dans l’ordre
juridique italien, le justiciable ne jouit pas d’un accès direct à la Cour
constitutionnelle : en effet, seule une juridiction qui connaît du fond d’une
affaire a la faculté de la saisir, à la requête d’un plaideur ou d’office. Dès
lors, pareille requête ne saurait s’analyser en un recours dont la Convention
exige l’épuisement (voir, entre autres, Brozicek
c. Italie no 10964/84, 19 décembre 1989, § 34, série A
no 167, Immobiliare Saffi
c. Italie [GC], no 22774/93, § 42, CEDH 1999‑V, C.G.I.L. et Cofferati c. Italie,
no 46967/07, § 48, 24 février 2009, Scoppola
c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 75, 17
septembre 2009 et M.C. et autres
c. Italie, no 5376/11, § 47, 3 septembre 2013). En
revanche, la Commission et la Cour ont jugé, en ce qui concerne d’autres États
membres, que le recours direct devant la Cour constitutionnelle constituait une
voie de recours interne à épuiser (voir, par exemple, W. c. Allemagne, no
10785/84, 18 juillet 1986, Décisions et rapports (DR) 48, p. 104, Union Alimentaria Sanders SA c. Espagne, no 11681/85,
11 décembre 1987 DR 54, pp. 101, 104, S.B. et autres c. Belgique (déc.), no 63403/00, 6
avril 2004 et Grišankova
et Grišankovs c. Lettonie (déc.), no 36117/02, CEDH 2003‑II
(extraits)).
102. Au vu de ce qui précède, la Cour ne
saurait considérer que le système d’interprétation obligatoire de la norme interne
à la lumière de la Convention établi par les arrêts nos 348 et 349
constitue un tournant de nature à réfuter une telle conclusion (voir, a contrario, les récentes décisions de
la Cour reconnaissant l’efficacité du recours devant la Cour constitutionnelle
turque à la suite de la mise en place d’un recours individuel direct devant
celle-ci : Hasan Uzun
c. Turquie
(déc.), no 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013 et Ali Koçintar c. Turquie (déc.), no 77429/12, 1er
juillet 2014).
103. Il convient
de saluer les principes dégagés par les
arrêts nos 348
et 349 du 24 octobre 2007, notamment quant à la place revenant à la Convention dans les
sources du droit et à l’invitation
faite aux autorités judiciaires nationales d’interpréter les normes internes et
la Constitution à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme
et de la jurisprudence de la Cour. La
Cour note aussi que, dans des matières autres que la procréation médicalement
assistée, nombreuses ont été les décisions dans lesquelles la Cour
constitutionnelle a conclu à l’inconstitutionnalité d’une
norme interne sur la base, entre autres, de l’incompatibilité de celle-ci avec
les droits garantis par la Convention et la jurisprudence de la Cour (tel est
notamment le cas de l’arrêt no 39 du 5 mars 2008 relatif aux
incapacités attachées à la faillite, de l’arrêt no 93 du 17 mars
2010 portant sur la publicité des audiences dans les procédures d’application
des mesures provisoires, et de l’arrêt no 210 du 3 juillet 2013
ayant trait à la rétroactivité de la loi pénale).
104. Toutefois, il y a lieu de relever tout d’abord
que le système italien ne prévoit pour les particuliers qu’un recours indirect
devant la Cour constitutionnelle. En outre, le Gouvernement n’a pas démontré,
en s’appuyant sur une jurisprudence et une pratique établies, qu’en matière de
donation d’embryons à la recherche, l’exercice par la requérante d’une action
devant le juge du fond, combiné avec le devoir de ce dernier de soulever devant
la Cour constitutionnelle une question de constitutionnalité à la lumière de la
Convention, constituait, en l’espèce, une voie de recours effective que l’intéressée
aurait dû épuiser.
105. Eu égard à ce qui précède et au fait que
la Cour constitutionnelle a décidé de suspendre l’examen d’une affaire
similaire pendante devant elle en attendant que la Cour statue dans la présente
affaire, il convient de rejeter l’exception soulevée par le gouvernement
défendeur.
II. SUR LE RESPECT DU DÉLAI DE SIX MOIS
A. Position du
Gouvernement
106. Lors de l’audience, le Gouvernement
a excipé de la tardivité de la requête, faisant valoir que la loi qui interdit
le don d’embryons à la recherche scientifique est entrée en vigueur le 10 mars
2004 et que la requérante n’a sollicité la mise à disposition de ses embryons
en vue d’un tel don que le 14 décembre 2011, par une lettre adressée à
cette date au centre de médecine de la reproduction où ceux-ci étaient
cryoconservés.
B. Position de
la requérante
107. La requérante a répliqué à cette
exception au cours de l’audience en indiquant que, si elle avait adressé une
demande écrite de mise à disposition de ses embryons au centre de médecine de la reproduction le 14 décembre 2011,
elle avait auparavant formulé oralement d’autres demandes ayant le même objet.
108. En tout état de cause, l’intéressée
soutient que toute demande adressée au centre
de médecine de la reproduction était vouée à l’échec, rappelant que la
loi applicable interdit catégoriquement le don d’embryons à la recherche
scientifique.
C. Appréciation
de la Cour
109. La
Cour rappelle avoir reconnu que, lorsqu’une ingérence dans le droit invoqué par
un requérant découle directement d’une loi, celle-ci, par son seul maintien en
vigueur, peut représenter une ingérence permanente dans l’exercice du droit concerné (voir, par exemple, les affaires
Dudgeon c. Royaume-Uni, 22
octobre 1981, § 41, série A no 45, et Norris c. Irlande,
26 octobre 1988, § 38, série A no 142, dans lesquelles les
requérants, homosexuels, se plaignaient de ce que des lois réprimant les actes
homosexuels par des sanctions pénales portaient atteinte à leur droit au
respect de leur vie privée).
110. La
Cour s’est fondée sur cette approche dans l’affaire Vallianatos et
autres c. Grèce ([GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 54, CEDH 2013 (extraits)), dans
laquelle les requérants se plaignaient d’une violation continue des articles 14
et 8 de la Convention du fait de l’impossibilité pour eux, en tant que couples
de même sexe, de conclure des « pactes de vie commune », tandis que cette
possibilité était reconnue par la loi aux couples de sexe opposé. En outre,
dans l’affaire S.A.S. c. France ([GC], no 43835/11, § 110, CEDH 2014 (extraits)), qui
concernait l’interdiction légale de porter une tenue destinée à dissimuler le
visage dans l’espace public, la Cour a relevé que la situation de la requérante
était similaire à celle des requérants dans les affaires Dudgeon et Norris, où
elle avait constaté une ingérence continue dans l’exercice des droits protégés
par l’article 8 de la Convention.
111. La
Cour admet que, dans les affaires précitées, l’impact des mesures législatives
incriminées sur la vie quotidienne des requérants était plus important et plus
direct qu’en l’espèce. Néanmoins, on ne saurait nier que l’interdiction légale
du don d’embryons à la recherche scientifique en cause dans la présente affaire
a une incidence sur la vie privée de la requérante. Cette incidence, qui
résulte du lien biologique existant entre l’intéressée et ses embryons ainsi
que de l’objectif de réalisation d’un projet familial à l’origine de leur
création, découle directement de l’entrée en vigueur de la loi no 40/2004
et s’analyse en une situation continue en ce qu’elle affecte la requérante de
manière permanente depuis lors (voir le rapport final de la Commission d’étude
sur les embryons du 8 janvier 2010, qui émet l’hypothèse d’une
conservation sans limite de durée des embryons congelés, paragraphe 21
ci-dessus).
112. En
pareil cas, selon la jurisprudence de la Cour, le délai de six mois ne commence
à courir qu’à partir du moment où la situation en cause a pris fin (voir parmi
d’autres, Çınar c. Turquie, no 17864/91, décision
de la Commission du 5 septembre 1994). En conséquence, la Cour ne souscrit pas
à la thèse du Gouvernement selon laquelle ce délai court à partir du jour de l’entrée
en vigueur de la loi litigieuse.
113. Par
ailleurs, la thèse du Gouvernement équivaut à considérer que la requérante
désirait donner ses embryons dès l’entrée en vigueur de la loi litigieuse,
circonstance sur laquelle la Cour ne saurait spéculer.
114. L’exception
de tardivité de la requête soulevée par le Gouvernement au titre de l’article
35 § 1 de la Convention ne saurait donc être retenue.
III. SUR LA QUALITÉ DE VICTIME DE LA
REQUÉRANTE
A. Position du
Gouvernement
115. Le
Gouvernement excipe également de l’absence de qualité de victime de la
requérante, indiquant que, au cours de la période allant du 12 novembre 2003 – date du
décès du compagnon de l’intéressée – au 10 mars 2004, date de l’entrée en
vigueur de la loi no 40/2004, la requérante aurait pu donner
ses embryons à la recherche puisqu’il n’existait alors aucune réglementation en
la matière et qu’un tel don n’était donc pas interdit.
B. Position de
la requérante
116. La
requérante a souligné au cours de l’audience que le délai qui s’était écoulé
entre la date du décès de son compagnon et l’entrée en vigueur de la loi
litigieuse avait été très court – quatre mois environ – et qu’elle n’avait pu
prendre dans ce laps de temps de décision précise quant au sort qu’elle voulait
réserver aux embryons issus de la fécondation in vitro qu’elle avait effectuée.
C. Appréciation
de la Cour
117. La
Cour rappelle que, lorsqu’une ingérence dans la vie privée d’un requérant
découle directement d’une loi, celle-ci, par son maintien en vigueur,
représente une ingérence permanente dans l’exercice du droit en question. Dans
la situation personnelle de l’intéressé, elle se répercute de manière constante
et directe, par sa seule existence, sur la vie privée de celui-ci (Dudgeon, § 41, et Norris, § 34, précités).
118. En
l’espèce, la requérante se trouve dans l’impossibilité de donner ses embryons à
la recherche depuis l’entrée en vigueur de la loi no 40/2004
(voir également le paragraphe 113 ci-dessus). La situation litigieuse étant
restée inchangée depuis ce moment-là, le
fait que la requérante souhaitait donner ses embryons à la recherche au
moment de l’introduction de sa requête suffit à la Cour pour lui reconnaître la
qualité de victime. En outre, quant à l’argument du Gouvernement selon lequel
la requérante aurait pu donner ses embryons à la recherche scientifique dans la
période qui s’est écoulée entre le décès de son compagnon et l’entrée en
vigueur de la loi, la Cour prend acte des informations fournies par la
requérante dont il ressort que, dans le court laps de temps indiqué ci-dessus,
elle n’avait pas pu prendre une décision précise quant au sort de ses embryons.
119. Il
y a donc lieu de rejeter l’exception du gouvernement défendeur tirée de l’absence
de qualité de victime de la requérante.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
120. Invoquant
l’article 8 de la Convention, la requérante allègue que l’interdiction du don d’embryons
à des fins de recherche scientifique découlant de l’article 13 de la loi no
40/2004 emporte violation de son droit au respect de sa vie privée. L’article 8
est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute
personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2. Il
ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Arguments
des parties
1. Arguments du Gouvernement
121. Le
Gouvernement soutient d’emblée que la question de savoir si des embryons
humains peuvent être donnés à la recherche scientifique ne relève pas de la
notion de « droit au respect de la vie privée ».
122. Lors
de l’audience, il a avancé que l’article 8 de la Convention n’aurait pu s’appliquer
que « de manière indirecte » en l’espèce, c’est-à-dire seulement si
la requérante avait souhaité réaliser un projet familial grâce à l’implantation
de ses embryons et si elle en avait été empêchée en raison de l’application de
la loi no 40/2004.
123. En
tout état de cause, il plaide que l’ingérence alléguée dans la vie privée de la
requérante est prévue par la loi et qu’elle poursuit un but légitime consistant
à protéger la potentialité de vie dont l’embryon est porteur.
124. Quant
à la proportionnalité de la mesure litigieuse, le Gouvernement s’est limité
dans ses observations écrites à renvoyer aux considérations développées sur le
terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. En
revanche, lors de l’audience, le Gouvernement a soutenu que la législation
italienne n’était pas contradictoire, arguant que la requérante affirmait à
tort que des embryons cryoconservés ne pouvaient aboutir à une vie humaine. À
cet égard, il a avancé que, correctement réalisée, la cryoconservation n’était
pas limitée dans le temps et qu’il n’existait encore aucun critère scientifique
permettant de vérifier la viabilité d’un embryon cryoconservé sans procéder à
sa décongélation.
125. Par
ailleurs, le Gouvernement estime que la loi italienne qui autorise l’avortement
n’est pas incompatible avec l’interdiction de donner des embryons à la
recherche, précisant qu’en cas d’interruption de grossesse, la protection de la
vie du fœtus doit de toute évidence être mise en balance avec la situation et
les intérêts de la mère.
126. Au
cours de l’audience, il a aussi souligné que l’embryon faisait assurément l’objet
d’une protection en droit européen. À cet égard, il a avancé que la Convention du Conseil
de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine (« Convention d’Oviedo »)
du 4 avril 1997 n’imposait certainement pas aux États d’autoriser
la recherche scientifique destructive sur les embryons, le choix de mettre en
place une telle recherche relevant selon lui de l’ample marge d’appréciation
accordée aux États dans ce domaine.
127. En
outre, il indique que les travaux préparatoires de la loi no 40/2004
montrent que celle-ci est le fruit d’un travail important qui a tenu compte de
différentes opinions et des questions scientifiques et éthiques qui se posent
en la matière. De plus, il précise que la loi en question a fait l’objet de
plusieurs référendums, notamment en ce qui concerne le maintien de son article
13, lesquels ont échoué parce que le quorum de votants n’avait pas été atteint.
128. De
surcroît, s’il reconnaît que la recherche scientifique italienne utilise des
lignées cellulaires embryonnaires importées de l’étranger et résultant de la
destruction des embryons originaires, il précise que la production de ces
lignées n’est pas effectuée à la demande des laboratoires italiens, indiquant
qu’il existe dans le monde environ trois cent lignées cellulaires embryonnaires
mises à la disposition de toute la communauté scientifique. À cet égard, il
souligne que la destruction volontaire d’un embryon humain ne saurait être
comparée à l’utilisation de lignées cellulaires issues d’embryons humains
précédemment détruits.
129. En
ce qui concerne les financements que l’Union européenne accorde à la recherche
scientifique, le Gouvernement expose que le VIIème programme-cadre de recherche et
de développement technologiques et le programme-cadre pour la recherche et l’innovation
« Horizon 2020 » (voir le paragraphe 64 ci-dessus) ne
prévoient pas le financement de projets impliquant la destruction d’embryons,
que ceux-ci aient été créés en Europe ou importés de pays tiers.
130. Il
souligne enfin que, dans son avis du 18 novembre 2005 relatif à l’« adoption
pour la naissance – ADP » (voir les paragraphes 19-20 ci‑dessus),
le Comité national pour la bioéthique s’était déjà préoccupé du sort des
embryons surnuméraires afin de trouver des solutions qui respectent la vie de
ceux-ci.
131. Il
estime que cette perspective pourrait aujourd’hui se concrétiser compte tenu de
l’arrêt no 162 du 10 juin 2014 par lequel la Cour constitutionnelle
a déclaré inconstitutionnelle l’interdiction de la fécondation hétérologue,
permettant ainsi l’utilisation des embryons surnuméraires d’une fécondation in vitro à des fins non destructives,
conformément à l’objectif poursuivi par la législation italienne en cette
matière.
2. Arguments de la requérante
132. La
requérante affirme d’abord qu’au sens de la jurisprudence de la Cour, la notion de « vie privée » est large
(Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02,
§ 61, CEDH 2002‑III et Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 71, CEDH 2007‑I).
133. Elle
signale ensuite qu’elle a perdu son compagnon dans des circonstances tragiques,
raison pour laquelle elle n’a pu réaliser son projet familial. À l’audience,
elle a expliqué que quatre mois seulement s’étaient écoulés entre le décès de
son compagnon et l’entrée en vigueur de la loi, qu’elle n’avait donc pas eu le
temps nécessaire pour réfléchir à la mise en place d’un projet familial, et que
la loi interdisait en tout état de cause l’implantation d’embryons post mortem.
134. Dans
ce contexte, elle considère que l’État lui impose de surcroît d’assister à la
destruction de ses embryons sans lui permettre de les donner à la recherche
alors qu’un tel don, qui poursuivrait une noble cause, représenterait pour elle
une source de réconfort après les événements douloureux auxquels elle a été
confrontée. Dans ces conditions, elle estime que son droit à la vie privée se
trouve en cause.
135. Elle
considère en outre que l’interdiction litigieuse est dépourvue de toute
logique, la seule voie offerte par le système étant celle de la mort des
embryons. Au cours de l’audience, elle a notamment mis en exergue les
contradictions existant dans l’ordre juridique italien, avançant que le droit
de l’embryon à la vie invoqué par le Gouvernement ne se conciliait ni avec la
possibilité pour les femmes d’avorter jusqu’au troisième mois de grossesse ni
avec l’utilisation, par les laboratoires italiens, de lignées cellulaires
embryonnaires issues de la destruction d’embryons créés à l’étranger.
136. De
plus, elle estime que la possibilité de donner des embryons non destinés à une
implantation répondrait aussi à un intérêt public, car les recherches sur les
cellules souches pluripotentes induites n’ont pas encore remplacé les
recherches sur les cellules staminales, raison pour laquelle ces dernières
continuent à figurer parmi les voies de recherche les plus prometteuses,
notamment en ce qui concerne le traitement de certaines pathologies incurables.
137. Elle
soutient aussi que l’État ne dispose pas d’une large marge d’appréciation en l’espèce,
compte tenu notamment du consensus européen existant sur la possibilité de
donner à la recherche scientifique des embryons qui ne sont pas destinés à être
implantés.
138. Lors
de l’audience, elle s’est référée à l’arrêt rendu le 18 octobre 2011
par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Oliver Brüstle c. Greenpeace eV (voir les paragraphes 59 à 61 ci‑dessus).
Observant que cet arrêt se borne à interdire la brevetabilité des inventions
qui impliquent la
destruction d’embryons humains, elle en déduit que les
inventions elles-mêmes – et les recherches qui les précèdent – ne sont pas
interdites sur le plan européen.
139. Enfin,
elle estime que la Communication de la Commission européenne relative à l’initiative
citoyenne européenne « Un de nous » du 28 mai 2014 (voir les
paragraphes 65-66 ci-dessus) confirme que le financement des recherches sur les
cellules souches embryonnaires humaines est autorisé.
3. Observations des tiers intervenants
a) Le
Centre européen pour la justice et les droits de l’homme (l’« ECLJ »)
140. L’ECLJ
avance que, dans la présente affaire, les intérêts de la science – auxquels est
sensible la requérante – ne prévalent pas sur le respect dû à l’embryon, cela
en raison du principe de la « primauté de l’être humain » reconnu par
l’article 2 de la Convention d’Oviedo.
141. En
outre, il fait observer que, dans toutes les affaires soulevant des questions
liées à la procréation médicalement assistée portées devant la Cour, l’ingérence
dans la vie privée et familiale des requérants découlait d’une loi qui faisait
obstacle à la réalisation d’un projet parental du couple ou de la mère. Il
estime qu’il n’en va pas de même en l’espèce, la requérante ayant décidé de
renoncer à son projet familial, alors même qu’aucune loi n’interdisait la
gestation post mortem à l’époque de la réalisation de la fécondation in vitro.
142. Enfin,
il rappelle que la marge d’appréciation des États membres dans ce domaine est
ample, renvoyant à cet égard aux arrêts S.H.
et autres c. Autriche et Evans, précités.
b) Les associations « Movimento
per la vita », « Scienza e vita » et « Forum
delle associazioni familiari », représentées par Me Carlo
Casini
143. Ces
associations soutiennent que les expérimentations destructives sur des embryons
humains, qui ont la qualité de « sujet », sont interdites par la loi
et que la Convention d’Oviedo n’impose aucune obligation d’autoriser de telles
expérimentations.
144. Elles
rappellent en outre que les états
membres jouissent dans ce domaine d’une large marge d’appréciation.
c) Les
associations « Luca Coscioni », « Amica Cicogna Onlus »,
« L’altra cicogna Onlus » et « Cerco bimbo »
ainsi que quarante-six membres du Parlement italien, représentés par Me
Filomena Gallo
145. Ces
tiers intervenants avancent que la notion de « vie privée » est
évolutive, qu’elle ne se prête pas à une définition exhaustive, et que la
requérant revendique notamment le droit au respect de son choix de donner à la recherche
du matériel biologique qui lui appartient, à savoir des embryons qui ne sont
plus destinés à un projet parental et qui sont en tout état de cause voués à la
destruction.
146. Ils
ajoutent que l’ingérence en cause n’est pas justifiée par l’objectif invoqué,
la loi italienne n’accordant pas de protection absolue à la vie de l’embryon.
d) Les associations « VOX
– Osservatorio italiano sui Diritti », « SIFES – Society of
Fertility, Sterility and Reproductive Medicine » et « Cittadinanzattiva »,
représentées par Me Maria Elisa D’Amico, Mme Maria
Paola Costantini, M. Massimo Clara, Mme Chiara Ragni et Mme Benedetta
Liberali
147. Ces
associations soulignent que l’article 13 de la loi no 40/2004
entraîne une limitation de la liberté des individus de choisir le sort de leurs
propres embryons, dont la cryoconservation doit être assurée pour une durée
illimitée, ce qui entraîne des coûts importants.
148. Selon
elles, la cryoconservation ne présente aucune utilité pour des embryons
destinés à la mort, ni pour les couples, qui sont en général peu désireux d’utiliser
à des fins d’implantation des embryons cryoconservés depuis longtemps car la
« qualité » de ceux-ci s’amenuise avec le temps. Elle serait tout
aussi dénuée d’intérêt pour les centres médicaux où les embryons sont
conservés.
B. Appréciation
de la Cour
1. Sur l’applicabilité en l’espèce de l’article 8 de la
Convention et sur la recevabilité du grief soulevé par la requérante
149. Par
la présente affaire, la Cour est appelée pour la première fois à se prononcer
sur la question de savoir si le « droit au respect de la vie privée »
garanti par l’article 8 de la Convention peut englober le droit que la
requérante invoque devant elle, celui de disposer d’embryons issus d’une
fécondation in vitro dans le but d’en
faire don à la recherche scientifique.
150. Le
Gouvernement soutient que la disposition en cause n’aurait pu s’appliquer en l’espèce
que de manière indirecte et uniquement dans son volet « vie
familiale », c’est-à-dire seulement si la requérante avait souhaité
réaliser un projet familial grâce à la cryoconservation et à l’implantation
ultérieure de ses embryons, et qu’elle en avait été empêchée en raison de l’application
de la loi no 40/2004.
151. Toutefois,
la requérante a indiqué dans le formulaire de requête (voir le paragraphe 14
ci-dessus) et réitéré à l’audience (voir le paragraphe 116 ci-dessus) que,
depuis le décès de son compagnon, elle n’envisageait plus la réalisation d’un
projet familial. D’ailleurs, elle n’a à aucun moment allégué devant la Cour qu’il
avait été porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale au titre de
l’article 8 de la Convention.
152. En
réalité, l’objet du litige dont la Cour se trouve saisie porte sur la
limitation du droit revendiqué par la requérante de décider du sort de ses
embryons, droit qui relève tout au plus de la « vie privée ».
153. À
l’instar de la requérante, la Cour rappelle d’emblée que, selon sa
jurisprudence, la notion
de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention est une
notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive et qui englobe
notamment un droit à l’autodétermination (Pretty,
précité, § 61). En outre,
cette notion recouvre le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas
devenir parent (Evans, précité, § 71,
et A, B et C c. Irlande [GC], no
25579/05, § 212, CEDH 2010).
154. Dans
les affaires dont elle a eu à connaître où se posait la question particulière
du sort à réserver aux embryons issus d’une procréation médicalement assistée,
la Cour s’est référée à la liberté de choix des parties.
155. Dans
l’affaire Evans (précitée), en
analysant l’équilibre à ménager entre les droits conflictuels que les parties à
un traitement par fécondation in vitro
peuvent puiser dans l’article 8 de la Convention, la Grande Chambre a estimé
« qu’il n’y a[vait] pas lieu d’accorder davantage de poids au droit de la
requérante au respect de son choix de devenir parent au sens génétique du terme
qu’à celui de [son ex-compagnon] au respect de sa volonté de ne pas avoir un
enfant biologique avec elle » (Evans,
précité, § 90).
156. En
outre, dans l’affaire Knecht c. Roumanie
(no 10048/10, 2 octobre 2012), où la requérante se plaignait notamment
du refus des autorités nationales d’autoriser le transfert de ses embryons du
centre médical où ils étaient conservés vers une clinique spécialisée de son
choix, la Cour a jugé que l’article 8 n’était applicable que sous l’angle
du droit au respect de la vie privée de l’intéressée (Knecht, précité, § 55) bien que celle-ci eût invoqué également une
méconnaissance de son droit au respect de sa vie familiale (voir le paragraphe
51 de l’arrêt).
157. Sur
le plan du droit national, la Cour observe que, comme le Gouvernement l’a
souligné à l’audience, l’arrêt no 162 du 10 juin 2014 par
lequel la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle l’interdiction
de la fécondation hétérologue (voir les paragraphes 34 à 39 ci-dessus) devrait
permettre l’« adoption pour la naissance », pratique qui consiste pour un couple ou une femme à
adopter des embryons surnuméraires à des fins d’implantation et qui avait été envisagée
par le Comité national pour la
bioéthique en 2005. De plus, la Cour note que, dans l’arrêt en
question, la Cour constitutionnelle a considéré que le choix des demandeurs de
devenir parents et de fonder une famille avec des enfants relevait de
« leur liberté d’autodétermination concernant la sphère de leur vie privée
et familiale » (voir le paragraphe 37 ci-dessus). Il en résulte que l’ordre
juridique italien accorde aussi du poids à la liberté de choix des parties à un
traitement par fécondation in vitro
en ce qui concerne le sort des embryons non destinés à l’implantation.
158. En
l’espèce, la Cour doit aussi avoir égard au lien existant entre la personne qui
a eu recours à une fécondation in vitro
et les embryons ainsi conçus, et qui tient au fait que ceux-ci renferment le
patrimoine génétique de la personne en question et représentent à ce titre une
partie constitutive de celle-ci et de son identité biologique.
159. La
Cour en conclut que la possibilité pour la requérante d’exercer un choix
conscient et réfléchi quant au sort à réserver à ses embryons touche un aspect
intime de sa vie personnelle et relève à ce titre de son droit à l’autodétermination.
L’article 8 de la Convention, sous l’angle du droit au respect de la vie
privée, trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
160. La
Cour constate enfin que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond du grief soulevé par la requérante
a) Sur l’existence d’une
« ingérence » « prévue par la loi »
161. À l’instar des parties, la Cour
estime que l’interdiction faite par l’article 13 de la loi no 40/2004
de donner à la recherche scientifique des embryons issus d’une fécondation in vitro non destinés à l’implantation constitue
une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée. Elle
rappelle à cet égard que, à l’époque où la requérante a eu recours à une
fécondation in vitro, la question du
don des embryons non implantés issus de cette technique n’était pas
réglementée. Par conséquent, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi litigieuse,
il n’était nullement interdit à la requérante de donner ses embryons à la
recherche scientifique.
b) Sur la
légitimité du but poursuivi
162. Au cours de l’audience, le
Gouvernement a indiqué que l’objectif poursuivi par la mesure litigieuse
consistait à
protéger la « potentialité de vie dont l’embryon est porteur ».
163. La
Cour rappelle que l’énumération des exceptions au droit au respect de la vie
privée qui figure dans le second paragraphe de l’article 8 est exhaustive
et que la définition de ces exceptions est restrictive. Pour être compatible
avec la Convention, une restriction à ce droit doit notamment être inspirée par
un but susceptible d’être rattaché à l’un de ceux que cette disposition énumère
(S.A.S. c. France précité, § 113).
164. La
Cour relève que, tant dans ses observations écrites que dans la réponse à la
question qui lui a été posée à l’audience, le Gouvernement ne s’est pas référé
aux clauses du deuxième paragraphe de l’article 8 de la Convention.
165. Toutefois,
dans ses observations écrites portant sur l’article 8 de la Convention, le
Gouvernement a renvoyé aux considérations qu’il avait exposées sur le terrain
de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir le paragraphe
124 ci-dessus) selon lesquelles, dans l’ordre juridique italien, l’embryon
humain est considéré comme un sujet de droit devant bénéficier du respect dû à
la dignité humaine (voir le paragraphe 205 ci-dessous).
166. La
Cour relève également que, dans le même ordre d’idées, deux tierces parties (l’« ECLJ »
et les associations « Movimento per
la vita », « Scienza e
vita » et « Forum delle
associazioni familiari ») soutiennent que l’embryon humain a la qualité
de « sujet » (voir les paragraphes 140 et 143 ci-dessus).
167. La
Cour admet que la « protection de la potentialité de vie dont l’embryon
est porteur » peut être rattachée au but de protection de la morale et des
droits et libertés d’autrui, au sens où cette notion est entendue par le
Gouvernement, (voir aussi Costa et Pavan,
précité, §§ 45 et 59). Toutefois, cela n’implique aucun jugement de la Cour sur
le point de savoir si le mot « autrui » englobe l’embryon humain (A, B et C c. Irlande, précité,
§ 228).
c) Sur la nécessité de la mesure dans
une société démocratique
i. Les
principes dégagés par la jurisprudence de la Cour en matière de procréation
médicalement assistée
168. La Cour
rappelle que pour apprécier la « nécessité » d’une mesure litigieuse
« dans une société démocratique » il lui faut examiner, à la lumière
de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour justifier la mesure en
question sont pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 § 2
(voir, parmi beaucoup d’autres, S.H. et
autres c. Autriche, précité, § 91, Olsson
c. Suède (no 1), 24 mars 1988, § 68, série A no
130, K. et T. c. Finlande [GC],
no 25702/94, § 154, CEDH 2001-VII, Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 65, CEDH
2002-I, et P., C. et S. c. Royaume‑Uni,
no 56547/00, § 114, CEDH 2002-VI).
169. En
outre, pour se prononcer sur l’ampleur de la marge d’appréciation à accorder à
l’État dans une affaire soulevant des questions au regard de l’article 8, il y
a lieu de prendre en compte un certain nombre de facteurs. Lorsqu’un aspect
particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se
trouve en jeu, la marge laissée à l’État est d’ordinaire restreinte (Evans, précité, § 77, avec les
références qui s’y trouvent citées, et Dickson
c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 78, CEDH 2007‑V).
Par contre, lorsqu’il n’y a pas de consensus au sein des États membres du
Conseil de l’Europe, que ce soit sur l’importance relative de l’intérêt en jeu
ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l’affaire
soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge d’appréciation
est plus large (S.H. et autres c.
Autriche, précité, § 94, Evans,
précité, § 77, X, Y et Z c. Royaume-Uni,
22 avril 1997, § 44, Recueil des arrêts
et décisions 1997‑II, Fretté c.
France, no 36515/97, § 41, CEDH 2002-I, Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no
28957/95, § 85, CEDH 2002‑VI, et A,
B et C c. Irlande, précité, § 232).
170. La Cour a
également observé que, en tout état de cause, « les choix
opérés par le législateur en la matière n’échappent pas [à son] contrôle. Il
[lui] incombe d’examiner attentivement les arguments dont le législateur a tenu
compte pour parvenir aux solutions qu’il a retenues et de rechercher si un
juste équilibre a été ménagé entre les intérêts de l’État et ceux des individus
directement touchés par les solutions en question » (S.H. et autres c. Autriche, précitée, § 97).
171. Dans
l’affaire précitée, la Cour a aussi relevé que le parlement autrichien n’avait
pas encore « procédé à un réexamen approfondi des règles régissant la
procréation artificielle à la lumière de l’évolution rapide que connaissent la
science et la société à cet égard » et elle a rappelé que « le
domaine en cause, qui paraît se trouver en perpétuelle évolution et connaît des
évolutions scientifiques et juridiques particulièrement rapides, appelle un
examen permanent de la part des États contractants » (S.H. et autres c. Autriche, précitée, §§ 117 et 118).
172. Dans
l’affaire Costa et Pavan (précité, §
64), la Cour a jugé que la législation italienne sur le diagnostic
préimplantatoire manquait de cohérence en ce qu’elle interdisait de limiter l’implantation
aux seuls embryons indemnes de la maladie dont les intéressés étaient porteurs
sains alors qu’elle autorisait la requérante à avorter d’un fœtus qui aurait
été atteint de la maladie en question.
173. En
outre, elle a estimé qu’elle n’avait pas pour tâche de se substituer aux
autorités nationales dans le choix de la réglementation la plus appropriée en
matière de procréation médicalement assistée, soulignant notamment que l’utilisation
des techniques de fécondation in vitro
soulève des questions délicates d’ordre moral et éthique, dans un domaine en
évolution continue (Knecht, précité,
§ 59).
ii. Application
en l’espèce des principes susmentionnés
174. La
Cour rappelle d’emblée que la présente espèce ne concerne pas un projet
parental, à la différence des affaires citées ci-dessus. Dans ces conditions, s’il
n’est assurément pas dénué d’importance, le droit de donner des embryons à la
recherche scientifique invoqué par la requérante ne fait pas partie du noyau
dur des droits protégés par l’article 8 de la Convention en ce qu’il ne porte
pas sur un aspect particulièrement important de l’existence et de l’identité de
l’intéressée.
175. En
conséquence, et eu égard aux principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour
estime qu’il y a lieu d’accorder à l’État défendeur une ample marge d’appréciation
en l’espèce.
176. De
plus, elle observe que la question du don d’embryons non destinés à l’implantation
suscite de toute évidence « des interrogations délicates d’ordre moral et
éthique » (voir Evans, précité, S.H. et autres c. Autriche,
précité, et Knecht, précité) et que
les éléments de droit comparé dont elle dispose (voir les paragraphes 69 à 76
ci-dessus) montrent qu’il n’existe
en la matière aucun consensus européen, contrairement à ce qu’affirme la
requérante (voir le paragraphe 137 ci-dessus).
177. Certes,
certains États membres ont adopté une approche permissive dans ce
domaine : dix-sept des quarante États membres pour lesquels la Cour
dispose d’informations en la matière autorisent la recherche sur les lignées
cellulaires embryonnaires humaines. S’y ajoutent les états où ce domaine n’est pas règlementé, mais dont les
pratiques sont permissives en la matière.
178. Toutefois,
certains états (Andorre, la
Lettonie, la Croatie et Malte) se sont dotés d’une législation interdisant
expressément toute recherche sur les cellules embryonnaires. D’autres n’autorisent
les recherches de ce genre que sous certaines conditions strictes, exigeant par
exemple qu’elles visent à protéger la santé de l’embryon ou qu’elles utilisent
des lignées cellulaires importées de l’étranger (c’est le cas de la Slovaquie,
de l’Allemagne et de l’Autriche, tout comme de l’Italie).
179. L’Italie
n’est donc pas le seul État membre du Conseil de l’Europe à proscrire le don d’embryons
humains à des fins de recherche scientifique.
180. De
plus, les documents précités du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne
confirment que les autorités nationales jouissent d’une ample marge de
discrétion pour adopter des législations restrictives lorsque la destruction d’embryons
humains est en jeu, compte tenu notamment des questions d’ordre éthique et
moral que la notion de commencement de la vie humaine comporte et de la
pluralité de vues existant à ce sujet parmi les différents États membres.
181. Il
en va notamment ainsi de la Convention d’Oviedo, dont l’article 27 prévoit
qu’aucune de ses dispositions ne doit être interprétée comme limitant la
faculté de chaque Partie d’accorder une protection plus étendue à l’égard des
applications de la biologie et de la médecine. L’avis no 15
adopté le 14 novembre 2000 par le Groupe européen d’éthique des sciences
et des nouvelles technologies auprès de la Commission européenne, la Résolution
1352 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à la recherche
sur les cellules souches et le Règlement no 1394/2007 du
Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les
médicaments de thérapie innovante comportent des dispositions similaires (voir le
paragraphe 58, le point III lettre F et le point IV lettre B ci-dessus).
182. Les
limites imposées au niveau européen visent plutôt à freiner les excès dans ce
domaine. C’est le cas par exemple de l’interdiction de créer des embryons
humains à des fins de recherche scientifique, prévue par l’article 18 de la
Convention d’Oviedo, ou de l’interdiction de breveter des inventions
scientifiques dont le processus d’élaboration implique la destruction d’embryons
humains (voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Oliver Brüstle c. Greenpeace eV du 18 octobre 2011).
183. Cela
étant, la marge d’appréciation de l’État n’est pas illimitée et il incombe à la
Cour d’examiner les arguments dont le législateur a tenu compte pour parvenir
aux solutions qu’il a retenues ainsi que de rechercher si un juste équilibre a
été ménagé entre les intérêts de l’État et ceux des individus directement
touchés par les solutions en question (Evans,
précité, § 86 et S.H. et autres c.
Autriche, précité, § 97).
184. La
Cour relève dans ce contexte que, s’appuyant sur des documents relatifs aux
travaux préparatoires de la loi no 40/2004, le Gouvernement a
indiqué à l’audience que l’élaboration de la loi avait donné lieu à un
important débat qui avait tenu compte des différentes opinions et des questions
scientifiques et éthiques existant en la matière (voir le paragraphe 127
ci-dessus).
185. Il
ressort en effet d’un rapport de la XIIe Commission permanente
présenté au Parlement le 26 mars 2002 que le débat a été enrichi par les
contributions de médecins, spécialistes et associations engagées dans le
domaine de la procréation médicalement assistée et que les discussions les plus
vives ont porté en général sur la sphère des libertés individuelles, opposant
les partisans d’une conception laïque de l’État aux tenants d’une approche
confessionnelle de celui-ci.
186. De
plus, lors des débats du 19 janvier 2004, la loi no 40/2004
avait également été critiquée entre autres parce que la reconnaissance de la
qualité de sujet de droit à l’embryon opérée par son premier article entraînait
selon certains une série d’interdictions, notamment celle de recourir à la
fécondation hétérologue et d’utiliser à des fins la recherche scientifique des
embryons cryoconservés non destinés à une implantation.
187. Par
ailleurs, à l’instar du Gouvernement, la Cour rappelle que la loi no
40/2004 a fait l’objet de plusieurs référendums, qui ont échoué faute de
quorum. Afin de promouvoir le développement de la recherche scientifique en
Italie dans le domaine des maladies difficilement curables, l’un de ceux-ci
proposait notamment l’abrogation de la clause de l’article 13 qui
subordonne l’autorisation de mener des recherches
scientifiques sur des embryons à la condition de protéger leur santé et leur développement.
188. La Cour constate donc que, lors du
processus d’élaboration de la loi litigieuse, le législateur avait déjà tenu
compte des différents intérêts ici en cause, notamment
celui de l’État à protéger l’embryon et celui des personnes concernées à
exercer leur droit à l’autodétermination individuelle sous la forme d’un don de
leurs embryons à la recherche.
189. La
Cour relève ensuite que la requérante allègue que la législation italienne
relative à la procréation médicalement assistée est incohérente, en vue de
démontrer le caractère disproportionné de l’ingérence dont elle se plaint.
190. Dans
ses observations écrites et à l’audience, l’intéressée a notamment
souligné qu’il était difficile de concilier la protection de l’embryon mise en
avant par le Gouvernement avec, d’une part, la possibilité pour une femme de
recourir légalement à un avortement thérapeutique jusqu’au troisième mois de
grossesse et, d’autre part, l’utilisation par les chercheurs italiens de
lignées cellulaires embryonnaires issues d’embryons ayant été détruits à l’étranger.
191. La
Cour n’a point pour tâche d’analyser in
abstracto la cohérence de la législation italienne en la matière. Pour être
pertinentes aux fins de son examen, les contradictions dénoncées par la requérante
doivent se rapporter à l’objet du grief qu’elle soulève devant la Cour, à
savoir la limitation de son droit à l’autodétermination quant au sort à
réserver à ses embryons (voir, mutatis
mutandis, Olsson (no 1)
précité, § 54, et Knecht,
précité, § 59).
192. Quant
aux recherches effectuées en Italie sur des lignées cellulaires embryonnaires
importées issues d’embryons ayant été détruits à l’étranger, la Cour observe
que, si le droit invoqué par la requérante de décider du sort de ses embryons
est lié à son désir de contribuer à la recherche scientifique, il n’y a
toutefois pas lieu d’y voir une circonstance affectant directement l’intéressée.
193. De
surcroît, la Cour prend acte de l’information fournie par le Gouvernement au
cours de l’audience, selon laquelle les lignées de cellules embryonnaires
utilisées dans les laboratoires italiens à des fins de recherche ne sont jamais
produites à la demande des autorités italiennes.
194. Elle
partage l’opinion du Gouvernement selon laquelle la destruction volontaire et
active d’un embryon humain ne saurait être assimilée à l’utilisation de lignées
cellulaires issues d’embryons humains détruits à un stade antérieur.
195. Elle
en conclut que, même à les supposer avérées, les incohérences de la législation
alléguées par la requérante ne sont pas de nature à affecter directement le
droit qu’elle invoque en l’espèce.
196. Enfin,
la Cour constate que, dans la présente affaire, le choix de donner les embryons
litigieux à la recherche scientifique résulte de la seule volonté de la
requérante, son compagnon étant décédé. Or la Cour ne dispose d’aucun élément
attestant que ce dernier, qui était concerné par les embryons en cause au même
titre que la requérante à l’époque de la fécondation, aurait fait le même
choix. Par ailleurs, cette situation ne fait pas non plus l’objet d’une
réglementation sur le plan interne.
197. Pour
les raisons exposées ci-dessus, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas
excédé en l’espèce l’ample marge d’appréciation dont il jouit en la matière et
que l’interdiction litigieuse était « nécessaire dans une société
démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
198. Il
n’y a donc pas eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie
privée au titre de l’article 8 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
199. Invoquant
l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se
plaint de ne pouvoir donner ses embryons et d’être obligée de les maintenir en
état de cryoconservation jusqu’à leur mort. L’article 1 du Protocole no
1 à la Convention dispose :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Arguments
des parties
1. Arguments du Gouvernement
200. Le
Gouvernement avance d’abord que l’embryon humain ne saurait être considéré
comme une « chose » et qu’il est en tout état de cause inacceptable
de lui attribuer une valeur économique. Il souligne ensuite que, dans l’ordre
juridique italien, l’embryon humain est considéré comme un sujet de droit
devant bénéficier du respect dû à la dignité humaine.
201. Par
ailleurs, il soutient que la Cour reconnaît aux États membres une large marge d’appréciation
en matière de détermination du début de la vie humaine (Evans, précité, § 56), tout particulièrement dans des domaines
comme celui-ci, où sont en jeu des questions morales et éthiques complexes qui
ne font pas l’objet d’un consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe.
202. Il
en conclut qu’aucune violation de l’article 1 du Protocole no 1 ne
saurait être décelée en l’espèce.
2. Arguments
de la requérante
203. La
requérante soutient que les embryons conçus par fécondation in vitro ne sauraient être considérés
comme des « individus » puisque, en l’absence d’implantation, ils ne
sont pas destinés à se développer pour devenir des fœtus et naître. Elle en
déduit que, du point de vue juridique, ils sont des « biens ».
204. Dans
ces conditions, elle estime disposer d’un droit de propriété sur ses embryons.
Or elle considère que l’État y a apporté des limitations qu’aucun motif d’un
intérêt général ne justifie, la protection de la potentialité de vie dont les
embryons seraient porteurs ne pouvant être raisonnablement invoquée à cet égard
dès lors qu’ils ont vocation à être éliminés.
3. Observations des tiers
intervenants
a) Le
Centre européen pour la justice et les droits de l’homme (l’« ECLJ »)
205. L’ECLJ
soutient que les embryons ne sauraient être considérés comme des
« choses », et qu’ils ne peuvent donc pas être détruits
volontairement. Par ailleurs, il avance que la notion de « bien » a
en soi une connotation économique qui est à exclure dans le cas d’embryons
humains.
206. Enfin,
il fait observer que la Cour autorise les États à déterminer dans leur ordre
juridique interne « le point de départ du droit à la vie » (Vo c. France [GC], no
53924/00, § 82, CEDH 2004‑VIII) et que, dans ce domaine, elle leur
accorde une ample marge d’appréciation (A,
B et C c. Irlande, précité, § 237).
b) Les associations « Movimento
per la vita », « Scienza e vita » et « Forum
delle associazioni familiari », représentées par Me Carlo
Casini
207. Ces
tierces parties excluent que l’embryon humain puisse être vu comme une « chose ».
208. En
outre, elles avancent que la législation italienne en la matière est cohérente.
Si elles reconnaissent que celle-ci autorise l’avortement thérapeutique, elles
précisent que cette possibilité ne tient pas à l’attribution de la qualité de
« chose » à l’embryon mais à la prise en compte des différents
intérêts en cause, notamment celui de la mère.
c) Les
associations « Luca Coscioni », « Amica Cicogna
Onlus », « L’altra cicogna Onlus » et « Cerco
un bimbo » ainsi que quarante-six membres du Parlement italien,
représentés par de Me Filomena Gallo
209. Me
Gallo réitère les considérations exposées par la requérante concernant le
statut de l’embryon.
d) Les associations « VOX
– Osservatorio italiano sui Diritti », « SIFES – Society of
Fertility, Sterility and Reproductive Medicine » et « Cittadinanzattiva »,
représentées par Me Maria Elisa D’Amico, Mme Maria
Paola Costantini, M. Massimo Clara, Mme Chiara Ragni et Mme Benedetta
Liberali
210. Ces
tiers intervenants n’ont pas présenté d’observations sous l’angle de l’article
1 du Protocole no 1 à la Convention.
B. Appréciation
de la Cour
1. Les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour
211. La
Cour rappelle que la notion de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no
1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels
et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne :
certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer
pour des « droits patrimoniaux » et donc des « biens » aux fins de cette
disposition. Dans chaque affaire, il importe d’examiner si les circonstances,
considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt
substantiel protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (Iatridis c. Grèce [GC], no
31107/96, § 54, CEDH 1999‑II, Beyeler
c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000‑I, et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96,
§ 129, CEDH 2004-V).
212. L’article
1 du Protocole no 1 ne vaut que pour les biens actuels. Un revenu
futur ne peut ainsi être considéré comme un « bien » que s’il a déjà été gagné
ou s’il fait l’objet d’une créance certaine. En outre, l’espoir de voir
reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer
effectivement ne peut non plus être considéré comme un « bien », ni une créance
conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la
condition (Gratzinger et Gratzingerova c.
République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH
2002-VII).
213. Cependant,
dans certaines circonstances, l’« espérance légitime » d’obtenir une valeur
patrimoniale peut également bénéficier de la protection de l’article 1 du
Protocole no 1. Ainsi, lorsque l’intérêt patrimonial est de l’ordre
de la créance, l’on peut considérer que l’intéressé dispose d’une espérance
légitime si un tel intérêt présente une base suffisante en droit interne, par exemple
lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98,
§ 52, CEDH 2004-IX).
2. Application en l’espèce des principes susmentionnés
214. La
Cour relève que la présente affaire soulève la question préalable de l’applicabilité
de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention aux faits en cause.
Elle prend acte de ce que les parties ont des positions diamétralement opposées
sur cette question, tout particulièrement en ce qui concerne le statut de l’embryon
humain in vitro.
215. Elle
estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire de se pencher ici sur la question,
délicate et controversée, du début de la vie humaine, l’article 2 de la
Convention n’étant pas en cause en l’espèce. Quant à l’article 1 du Protocole no
1, la Cour est d’avis qu’il ne s’applique pas dans le cas présent. En effet, eu
égard à la portée économique et patrimoniale qui s’attache à cet article, les
embryons humains ne sauraient être réduits à des « biens » au sens de
cette disposition.
216. L’article
1 du Protocole no 1 à la Convention n’étant pas applicable en l’espèce,
cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions
de la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement ;
2. Rejette,
à la majorité, l’exception de tardiveté de la requête soulevée par le
Gouvernement ;
3. Rejette,
à la majorité, l’exception soulevée par le Gouvernement tirée de l’absence de
qualité de victime de la requérante ;
4. Déclare, à la majorité, la requête
recevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
5. Déclare, à l’unanimité, la requête
irrecevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à
la Convention ;
6. Dit, par seize voix contre une, qu’il n’y
a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en
français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits
de l’homme, à Strasbourg le 27 août 2015.
Johan Callewaert Dean Spielmann
Adjoint
au greffier Président
Au présent
arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74
§ 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion
concordante du juge Pinto de Albuquerque ;
– opinion
concordante du juge Dedov ;
– opinion
en partie concordante commune des juges Casadevall, Raimondi, Berro,
Nicolaou et Dedov ;
– opinion
en partie dissidente commune des juges Casadevall, Ziemele, Power-Forde, De
Gaetano et Yudkivska ;
– opinion
en partie dissidente du juge Nicolaou ;
– opinion
dissidente du juge Sajó.
D.S.
J.C.
OPINION CONCORDANTE DU
JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE
Table des matières
I. Introduction (§ 1)
II. La recherche sur l’embryon
humain en droit international (§§ 2-26)
A. Les normes des Nations unies (§§ 2-10)
i. La Déclaration universelle sur le génome
humain et les droits de l’homme (§ 2)
ii. Les Lignes directrices internationales d’éthique
pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains (§ 3)
iii. La Déclaration internationale sur les données
génétiques humaines (§ 4)
iv. La Déclaration des Nations Unies sur le
clonage des êtres humains (§ 5)
v. La Déclaration universelle sur la bioéthique
et les droits de l’homme (§ 6)
vi. Les avis du Comité international de bioéthique
de l’UNESCO (§§ 7‑10)
B. Les normes professionnelles universelles (§§ 11-12)
i. La Déclaration de l’Association médicale
mondiale (AMM) sur les principes éthiques applicables à la recherche médicale
impliquant des êtres humains (§ 11)
ii. Les lignes directrices relatives à la
conduite de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines (Guidelines for the Conduct of Human
Embryonic Stem Cell Research) de la Société internationale pour la
recherche sur les cellules souches (§ 12)
C. Les normes interaméricaines (§ 13)
D. Les normes africaines (§§ 14-15)
E. Les normes européennes (§§ 16-26)
i. Les normes de l’Union européenne (§§ 16-22)
ii. Les normes du Conseil de l’Europe (§§ 23-26)
III. La position des parties
(§§ 27-30)
A. Le caractère inutile de la restriction légale
italienne (§§ 27-28)
B. Le caractère contradictoire du cadre juridique
italien applicable (§ 29)
C. Le consensus européen non prohibitif (§ 30)
IV. La position de la majorité
(§§ 31-37)
V. L’application des normes de la
Cour (§§ 38-42)
VI. Conclusion (§ 43)
1. Je n’ai pas d’objection aux décisions sur
la recevabilité et l’irrecevabilité formulées par la majorité de la Grande Chambre[4]. Je ne puis cependant
souscrire au raisonnement de la majorité sur la question de fond qui est en
jeu, à savoir l’utilisation d’embryons cryoconservés aux fins de la recherche
sur les cellules souches. J’ai néanmoins voté, sans hésitation, comme la
majorité en faveur d’un constat de non-violation de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention »).
II. La
recherche sur l’embryon humain en droit international
A. Les
normes des Nations unies
i. La Déclaration universelle sur le génome
humain et les droits de l’homme
2. Comme il ressort de l’article
6 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
et du neuvième alinéa du préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant,
le droit international n’est pas indifférent à la nécessité de protéger la vie
humaine potentielle. Cependant, l’article 15 § 3 du Pacte
international de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
engage aussi les États parties « à respecter la liberté indispensable à la
recherche scientifique ». L’État peut toutefois limiter cette liberté
scientifique aux fins de favoriser le « bien-être général dans une société
démocratique ». La protection de la vie humaine à naître –valeur sociale
indispensable dans une société démocratique qui concerne le bien-être non
seulement des générations actuelles mais aussi des générations futures –
relève assurément de la clause de restriction contenue à l’article 4 du PIDESC,
lue à la lumière du développement du droit international survenu dans la
seconde moitié du XXe siècle.
En fait, les Nations unies ont pris d’importantes
mesures en vue de la reconnaissance de la dignité humaine des embryons, en les
protégeant dans le cadre de la recherche scientifique et de l’expérimentation
sur les êtres humains, à commencer par l’adoption de la Déclaration universelle
sur le génome humain et les droits de l’homme adoptée à la Conférence générale
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) en 1997[5],
confirmée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1998[6]. La
déclaration énonce que le génome humain sous-tend la reconnaissance de la
dignité intrinsèque et de la diversité de la famille humaine. Chaque individu a
droit au respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses
caractéristiques génétiques. Cette dignité impose de ne pas réduire les
individus à leurs caractéristiques génétiques et de respecter le caractère
unique de chacun et la diversité des individus. Le génome humain, par nature
évolutif, est sujet à des mutations. Il renferme des potentialités qui s’expriment
différemment selon l’environnement naturel et social de chaque individu. Le
génome humain en son état naturel ne peut donner lieu à des gains pécuniaires.
La déclaration ajoute qu’aucune recherche concernant le génome humain, ni
aucune de ses applications, en particulier dans les domaines de la biologie, de
la génétique et de la médecine, ne devrait prévaloir sur le respect des droits
de l’homme, des libertés fondamentales et de la dignité humaine des individus
ou de groupes d’individus. Des pratiques qui sont contraires à la dignité
humaine, telles que le clonage à des fins de reproduction d’êtres humains, ne
sont pas permises.
ii. Les Lignes directrices internationales d’éthique
pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains
3. En 2002, le Conseil des
organisations internationales des sciences médicales (CIOMS), en collaboration
avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a mis à jour les Lignes directrices internationales d’éthique
pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains, qui portent
sur l’application à la recherche impliquant des sujets humains de trois
principes fondamentaux d’éthique : le respect de la personne, la
bienfaisance et la justice[7]. Cet
instrument dispose donc que la
recherche biomédicale impliquant des sujets humains ne peut être éthiquement
justifiable que si elle est conduite d’une manière qui respecte et protège les
sujets de la recherche, qui soit équitable et qui soit moralement acceptable
dans les communautés où la recherche est effectuée[8].
iii. La Déclaration internationale sur les données génétiques
humaines
4. La Déclaration internationale sur
les données génétiques humaines a été adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO
en octobre 2003[9].
Elle a pour objectifs d’assurer le respect de la dignité humaine et la
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la
collecte, le traitement, l’utilisation et la conservation des données
génétiques humaines, des données protéomiques humaines et des échantillons
biologiques à partir desquels elles sont obtenues, conformément aux impératifs
d’égalité et de justice. La déclaration énonce que chaque individu a une
constitution génétique caractéristique. Toutefois, l’identité d’une personne ne
saurait se réduire à ses caractéristiques génétiques. Les données génétiques
humaines et les données protéomiques humaines peuvent être collectées,
traitées, utilisées et conservées uniquement aux fins de recherche médicale et
autre recherche scientifique, ou toute autre fin compatible avec la Déclaration
universelle sur le génome humain et les droits de l’homme et avec le droit
international des droits de l’homme.
iv. La Déclaration des Nations Unies sur le clonage des êtres
humains
5. La Déclaration des Nations Unies sur le clonage des êtres humains a
été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en mars 2005[10].
Elle invite les États membres à adopter toutes les mesures voulues pour
protéger comme il convient la vie humaine dans l’application des sciences de la
vie, à interdire toutes les formes de clonage humain dans la mesure où elles
seraient incompatibles avec la dignité humaine et la protection de la vie
humaine et à adopter les mesures voulues pour interdire l’application des
techniques de génie génétique qui pourrait aller à l’encontre de la dignité
humaine.
v. La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits
de l’homme
6. La Déclaration universelle sur la
bioéthique et les droits de l’homme a été adoptée par acclamation par la Conférence générale de l’UNESCO
en octobre 2005[11].
Elle traite des questions d’éthique posées par la médecine, les sciences de la
vie et les technologies qui leur sont associées, appliquées aux êtres humains.
Elle insiste sur la nécessité pour cette recherche scientifique de s’inscrire
dans le cadre des principes éthiques et de respecter la dignité humaine, les
droits de l’homme et les libertés fondamentales. Les intérêts et le bien-être
de l’individu devraient l’emporter sur le seul intérêt de la science ou de la
société. Dans l’application et l’avancement des connaissances scientifiques, de
la pratique médicale et des technologies qui leur sont associées, les effets
bénéfiques directs et indirects pour les individus concernés devraient être
maximisés et tout effet nocif susceptible d’affecter ces individus devrait être
réduit au minimum. L’égalité fondamentale de tous les êtres humains en dignité
et en droit doit être respectée de manière à ce qu’ils soient traités de façon
juste et équitable. Aucun individu ou groupe ne devrait être soumis, en
violation de la dignité humaine, des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, à la discrimination ou à la stigmatisation. L’incidence des sciences de la vie sur les
générations futures, y compris sur leur constitution génétique, devrait être
dûment prise en considération.
vi. Les avis du Comité international de bioéthique de l’UNESCO
7. En 2001, le Comité international de
bioéthique de l’UNESCO (CIB) a résumé sa position au sujet des cellules souches
embryonnaires dans un rapport intitulé « L’utilisation des cellules
souches embryonnaires pour la recherche thérapeutique : rapport du CIB sur
les aspects éthiques des recherches sur les cellules embryonnaires »[12].
Aux fins du rapport, l’embryon humain a été examiné aux premiers stades de son
développement, avant son implantation dans l’utérus. Si les recherches sur l’embryon
humain pour obtenir des cellules souches embryonnaires sont autorisées, alors
elles doivent être soumises à un strict contrôle et à des conditions
restrictives rigoureuses, notamment l’obtention du consentement éclairé des
donneurs et la justification en termes d’avantages pour l’humanité. Les
recherches menées à des fins non médicales ne seraient évidemment pas éthiques,
de même que des recherches qui porteraient sur des embryons ayant dépassé les
tout premiers stades de développement. Les applications médicales des
recherches doivent être sans équivoque des applications thérapeutiques et non
correspondre à des souhaits cosmétiques ou à des caprices non médicaux ou, a
fortiori, à des améliorations eugéniques. En aucun cas le don d’embryons
humains ne doit être une transaction commerciale et des mesures devraient être
prises pour décourager toute incitation financière.
Les recherches sur les cellules souches
embryonnaires – et les recherches sur l’embryon en général – sont une
question que chaque communauté doit elle-même trancher. Des mesures devraient
être prises pour garantir que ces recherches sont menées dans un cadre
législatif ou réglementaire qui accorderait le poids nécessaire aux
considérations éthiques et fixerait des principes directeurs adéquats. Si l’on
envisage d’autoriser que des dons d’embryons surnuméraires au stade
préimplantatoire, provenant de traitements de FIV, soient consentis pour des
recherches sur les cellules souches embryonnaires à des fins thérapeutiques, l’attention
sera accordée à la dignité et aux droits des deux parents donneurs. Il est donc
essentiel que le don n’ait lieu qu’après que les donneurs ont été pleinement
informés des implications de ces recherches et ont donné leur consentement
libre et éclairé. Il conviendrait d’examiner d’autres technologies permettant d’obtenir
des lignées de cellules souches à partir de sources génétiquement compatibles
pour la recherche thérapeutique dans le domaine des transplantations. Dans tous
les aspects des recherches concernant l’embryon humain, une importance
particulière devrait être accordée au respect de la dignité humaine et aux
principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)
et la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme
(1997).
8. En
2003, dans le « Rapport du CIB sur le diagnostic génétique pré‑implantatoire
et les interventions sur la lignée germinale »[13], le CIB a déclaré que la
destruction d’embryons pour des raisons non médicales ou l’interruption d’une
grossesse à cause du sexe de l’enfant n’est pas « contrebalancée »
par le désir d’éviter des souffrances futures dues à une maladie grave. L’intervention
sur la lignée germinale vise à corriger une anomalie génétique particulière
dans les cellules germinales ou dans l’embryon à ses premiers stades ou à
introduire des gènes qui peuvent conférer à l’embryon des caractères
additionnels. Le CIB a souligné qu’en ce qui concerne les interventions sur la
lignée germinale, la distinction
entre les « objectifs thérapeutiques » et « l’amélioration des
caractéristiques normales » n’est pas claire. Le CIB a rappelé que
« [les interventions sur la lignée germinale] pourraient être contraires à
la dignité humaine ».
9. Dans le « Rapport du CIB sur
le clonage humain et la gouvernance internationale »[14], le CIB a relevé que les
expressions « clonage reproductif » et « clonage
thérapeutique » introduites dans le débat bioéthique ne décrivaient pas
adéquatement les procédés techniques utilisés. Les nouvelles avancées
scientifiques, comme les cellules souches pluripotentes induites, ouvraient de
nouvelles possibilités pour la recherche et, à moyen terme, pour des applications
thérapeutiques.
10. Dans un rapport intitulé
« Avis du CIB sur la brevetabilité du génome humain »[15], le
CIB a admis qu’autoriser la brevetabilité du génome humain pourrait freiner la
recherche et monopoliser les connaissances scientifiques, et a estimé qu’il
existait de solides raisons éthiques pour exclure le génome humain de la
brevetabilité.
B. Les
normes professionnelles universelles
i. La Déclaration de l’Association médicale
mondiale (AMM) sur les principes éthiques applicables à la recherche médicale
impliquant des êtres humains
11. L’Association médicale mondiale (AMM) a approuvé la
Déclaration d’Helsinki comme énoncé de principes éthiques applicables à la
recherche médicale impliquant des êtres humains, y compris la recherche sur du
matériel biologique humain et sur des données identifiables. Adoptée en 1964 et
amendée pour la dernière fois en 2013, la déclaration énonce que l’objectif
premier de la recherche médicale impliquant des êtres humains est de comprendre
les causes, le développement et les effets des maladies et d’améliorer les
interventions préventives, diagnostiques et thérapeutiques. Même les meilleures
interventions éprouvées doivent être évaluées en permanence par de nouvelles
recherches portant sur leur sécurité, leur efficacité, leur pertinence, leur
accessibilité et leur qualité. La recherche médicale est soumise à des normes
éthiques qui promeuvent et assurent le respect de tous les êtres humains et qui
protègent leur santé et leurs droits. Cet objectif ne doit jamais prévaloir sur
les droits et les intérêts des personnes impliquées dans la recherche. Une
recherche médicale impliquant des êtres humains ne peut être conduite que si l’importance
de l’objectif dépasse les risques et inconvénients pour les personnes
impliquées. Certains groupes ou personnes sont particulièrement vulnérables et
peuvent avoir une plus forte probabilité d’être abusés ou de subir un préjudice
additionnel. Ces groupes et personnes vulnérables devraient bénéficier d’une
protection adaptée. La recherche médicale impliquant un groupe vulnérable se
justifie uniquement si elle répond aux besoins ou aux priorités sanitaires de
ce groupe et qu’elle ne peut être effectuée sur un groupe non vulnérable. En
outre, ce groupe devrait bénéficier des connaissances, des pratiques ou
interventions qui en résultent.
ii. Les lignes directrices relatives à la conduite de la
recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines (Guidelines for the Conduct of Human Embryonic
Stem Cell Research) de la Société internationale pour la recherche sur les
cellules souches
12. Les lignes directrices de 2006 de
la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches visent à
souligner la responsabilité des scientifiques s’agissant de veiller à ce que
les recherches sur les cellules souches humaines soient menées dans le respect
de rigoureuses normes d’éthique en matière de recherche, et d’encourager des
pratiques uniformes de recherche qui devraient être suivies à l’échelle
mondiale par tous les scientifiques travaillant sur les cellules souches
humaines. Ces lignes directrices mettent l’accent sur des questions qui sont
propres aux recherches sur les cellules souches concernant les stades préimplantatoires
du développement humain, aux recherches sur la dérivation ou l’utilisation des
lignées de cellules souches pluripotentes humaines, et sur l’éventail des
expériences dans le cadre desquelles de telles cellules peuvent être incorporées
dans des hôtes animaux.
Toutes les expériences pertinentes pour la
recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines qui concernent les
stades préimplantatoires du développement humain, les embryons humains ou les
cellules embryonnaires, ou qui impliquent l’incorporation de cellules
totipotentes ou pluripotentes humaines dans des chimères animales, doivent être
soumises à contrôle et approbation. En outre, toutes ces expériences doivent
faire l’objet d’un suivi constant par un dispositif ou organe spécial de
surveillance. Les chercheurs doivent demander une approbation au moyen d’un
processus de surveillance (Stem Cell
Research Oversight – SCRO).
Les types de recherches qui ne doivent pas être
menées, en raison d’un large consensus international selon lequel de telles
expériences sont dépourvues de justification scientifique impérieuse ou
soulèvent de vives préoccupations d’ordre éthique, sont : la culture in vitro de tout embryon humain après
fécondation ou de toutes structures cellulaires organisées pouvant manifester
un potentiel d’organisme humain, indépendamment de la méthode de dérivation,
pendant plus de quatorze jours ou jusqu’au début de la formation de la ligne
primitive si celle-ci se produit avant ; la recherche dans le cadre de
laquelle un produit obtenu à partir de recherches impliquant des cellules
totipotentes ou pluripotentes humaines est implanté dans un utérus humain ou un
utérus de primate non humain ; et la recherche dans le cadre de laquelle
des chimères animales comportant des cellules humaines, potentiellement
capables de former des gamètes, sont croisées les unes avec les autres.
C. Les
normes interaméricaines
13. L’article 1 de la Déclaration américaine des droits et devoirs
de l’homme (1948) énonce que « Tout être humain a droit à la vie, à la
liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne ». Les rédacteurs
de la déclaration américaine ont spécifiquement rejeté une proposition qui
tendait à ce que le texte indiquât que le droit à la vie débutait dès la conception[16].
L’article 4 de la Convention américaine relative
aux droits de l’homme (1969) dispose que : « Toute personne a droit
au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à
partir de la conception ». La Commission interaméricaine des droits de l’homme
a toutefois étudié les travaux préparatoires et établi que les termes de la
Convention reconnaissant un droit à la vie « en général à partir de la
conception » ne visaient pas à conférer un droit à la vie absolu avant la
naissance[17].
Dans Gretel Artavia Murillo c. Costa Rica[18], la
Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a constaté que l’État
défendeur avait fondé son interdiction de la fécondation in vitro sur une protection absolue de l’embryon, ce qui, en
négligeant la prise en compte d’autres droits concurrents, avait entraîné une ingérence arbitraire et excessive
dans la vie privée et familiale. Au contraire, l’impact sur la protection de la
vie prénatale était très faible, du fait que le risque de perte de l’embryon
existait tant dans le cadre d’une FIV que d’une grossesse naturelle. De plus, l’ingérence
avait un effet discriminatoire pour les personnes qui ne disposaient que de la
fécondation in vitro pour le
traitement de leur infertilité La Cour interaméricaine a également conclu que l’embryon
humain avant implantation ne pouvait être tenu pour une personne aux fins de l’article
4 § 1 de la Convention américaine.
D. Les
normes africaines
14. L’article 4 de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples (1981) déclare que « [l]a personne
humaine est inviolable » et que « [t]out être humain a droit au respect
de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne (...) ». Les
rédacteurs de la Charte africaine ont spécifiquement écarté toute formulation
qui aurait protégé le droit à la vie dès le moment de la conception[19].
L’Organisation de l’unité africaine, aujourd’hui l’Union
africaine, a adopté la Résolution sur la bioéthique en 1996[20]. L’Union africaine a
souscrit aux principes de l’inviolabilité du corps humain, de l’intangibilité du patrimoine
génétique de l’espèce humaine et de l’indisponibilité du corps humain, de ses
éléments, notamment les gènes humains et leurs séquences, qui ne peuvent être
soumis au commerce ou à un droit patrimonial. L’Union africaine s’est engagée à
promouvoir l’encadrement des
possibilités de recherche sur les embryons.
15. En 2008, le bureau de l’UNESCO au
Caire a organisé une réunion d’experts sur les questions éthiques et juridiques
de la recherche sur l’embryon humain dans le but de traiter la question de la
recherche sur les embryons, en partenariat avec l’OMS et l’Organisation
islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO). Les
recommandations figurant dans le rapport final de cette réunion « ont
vocation à être adaptées aux différentes
cultures et valeurs religieuses et sociales de la Méditerranée orientale et
de la région arabe ». Le rapport recommande que, lorsqu’il est permis d’importer
d’autres pays du matériel biologique
et/ou issu de la recherche, on s’assure que leur obtention et leur création ne
sont pas contraires aux valeurs ou traditions éthiques ou religieuses. Il faut
définir l’objet d’une recherche éthiquement correcte et présentant un bon
rapport coûts-bénéfices en tenant compte de buts tels que l’étude de la
génétique humaine et du traitement de la stérilité. La recherche qu’un pays
peut juger inacceptable doit inclure le clonage reproductif, la thérapie
germinale, la manipulation génétique germinale. Les États doivent introduire ou
procéder à la révision des dispositions sur les questions telles que l’utilisation
pour la recherche d’embryons surnuméraire issus de FIV, le clonage aux fins de
la recherche, et le typage (HLA) de
cellules embryonnaires, fœtales ou autres pour le traitement de l’enfant d’un
couple après la naissance. Les États doivent se pencher sur les types de recherche sur cellules
souches embryonnaires qui requièrent une surveillance particulière, déterminer
quelle instance doit assurer cette surveillance et quel organe doit assumer la
responsabilité. Les pays doivent procéder au suivi et à l’échange des
informations susceptibles de réduire ou d’éliminer le besoin de recherches sur
les cellules souches embryonnaires, comme le développement de cellules souches
pluripotentes induites et de lignées
de cellules pouvant en toute sécurité être utilisées sur des êtres humains.
E. Les
normes européennes
i. Les normes de l’Union européenne
16. L’article 3 de la Charte des droits
fondamentaux énonce :
« 1. Toute
personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de
la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : le
consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités
définies par la loi, l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles
qui ont pour but la sélection des personnes, l’interdiction de faire du corps
humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, l’interdiction
du clonage reproductif des êtres humains. »[21]
17. La Directive 98/44/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection
juridique des inventions biotechnologiques vise à renforcer la compétitivité de
l’UE sur le marché mondial, protège la propriété intellectuelle des grandes
industries et soutient la recherche technoscientifique innovante ; mais
elle vise aussi à assurer le respect des principes fondamentaux protégeant la
dignité et l’intégrité de la personne, en affirmant le principe selon lequel
« le corps humain, dans toutes les phases de sa constitution et de son
développement, cellules germinales comprises, ainsi que la simple découverte d’un
de ses éléments ou d’un de ses produits, y compris la séquence ou séquence
partielle d’un gène humain, ne sont pas brevetables ».
Bien qu’elle ne donne pas de définition juridique
de l’« embryon humain », la directive pose des règles sur l’utilisation
d’embryons humains à des fins scientifiques, en énonçant que « [l]es
inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou
aux bonnes mœurs sont exclues de la brevetabilité, l’exploitation ne pouvant
être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une
disposition légale ou réglementaire ». Plus spécifiquement, les procédés
de clonage des êtres humains, les procédés de modification de l’identité
génétique germinale de l’être humain et les utilisations d’embryons humains à
des fins industrielles ou commerciales, entre autres, ne sont pas brevetables.
Ainsi, l’Union européenne considère expressément l’utilisation d’embryons
humains à des fins industrielles ou commerciales comme contraire à l’exigence
minimum établie par le respect de l’ordre
public ou de la moralité[22].
18. En octobre 2011, dans l’affaire Oliver Brüstle c. Greenpeace eV (C‑34/10),
la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a fourni davantage de
précisions sur l’utilisation d’embryons humains à des fins scientifiques.
Concernant l’interprétation du terme « embryon humain », la Cour de
Luxembourg a admis que celui-ci recouvrait une notion vaste qui « [devait]
être comprise largement ». Sur ce fondement, la grande chambre de la CJUE
a conclu que ce terme visait tout ovule humain dès le stade de sa fécondation,
ce moment étant crucial pour le début du développement de l’être humain.
Devaient également se voir reconnaître cette qualification l’ovule humain non
fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature avait été implanté,
et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie
de parthénogenèse. La grande chambre a dit que l’utilisation d’embryons à des
fins de recherche scientifique n’était pas brevetable. Elle a toutefois reconnu
la brevetabilité de l’utilisation d’embryons à des fins thérapeutiques ou
diagnostiques lorsque cela s’appliquait à l’embryon humain et lui était utile.
Enfin, la CJUE a établi que la brevetabilité était également exclue lorsque la
mise en œuvre d’une invention requérait la destruction préalable de l’embryon
humain ou son utilisation comme matériau de départ, quel que fût le stade
auquel celles-ci intervenaient et même si la description de l’enseignement
technique revendiqué ne mentionnait pas l’utilisation d’embryons humains. L’embryon
jouissant de la dignité humaine dès le moment de la fécondation, il n’est pas
possible, selon la CJUE, de distinguer
à partir de la fécondation différentes phases de développement qui
justifieraient une protection inférieure de l’embryon pendant une certaine
période. Étant une « notion autonome du droit de l’Union », l’embryon
humain bénéficie d’une protection juridique obligatoire fondée sur le respect
de sa dignité humaine intrinsèque, ce qui écarte la possibilité pour les États
membres de l’Union de priver l’embryon humain de sa protection ou de lui
accorder un niveau de protection inférieur à celui qui est affirmé dans la
limpide décision des juges de la Cour de Luxembourg.
19. Le Groupe européen d’éthique des
sciences et des nouvelles technologies auprès de la Commission européenne (GEE)
a formulé son premier avis sur l’utilisation
des cellules embryonnaires à des fins de recherche dans un rapport de 1998
intitulé « Les aspects éthiques de la recherche impliquant l’utilisation d’embryons
humains »[23]. Le
GEE a relevé qu’en dépit de divergences fondamentales, les valeurs et principes
communs sur la question sont le
respect de la vie humaine, la nécessité d’alléger la souffrance humaine, la
nécessité de garantir la qualité et la sécurité des traitements médicaux, la
liberté de la recherche et l’exigence du consentement informé des femmes ou des
couples concernés. S’agissant de la FIV, l’avis reconnaît qu’elle implique
généralement la création d’embryons surnuméraires et que, si la
cryopréservation est impossible, les deux seules options possibles sont la
recherche (impliquant leur destruction) et la destruction. Ainsi, le Groupe a
conclu qu’il ne fallait « pas exclure, a
priori, des financements communautaires, les recherches sur l’embryon
humain [faisant] l’objet de choix éthiques divergents selon les pays, mais [qu’il
fallait] n’en admettre néanmoins le financement éventuel que sous les strictes
conditions définies aux paragraphes suivants ».
20. En 2000, le GEE a rendu un second
avis en complément du précédent, dans un rapport intitulé « Les aspects
éthiques de la recherche sur les cellules souches humaines et leur
utilisation »[24].
Celui-ci indique que, dans le contexte du pluralisme européen, il appartient à
chaque État membre d’interdire ou d’autoriser les recherches sur l’embryon.
Dans ce dernier cas, le respect de la dignité humaine implique que l’on
réglemente les recherches sur l’embryon et que l’on prévoie des garanties
contre les risques d’expérimentation arbitraire et d’instrumentalisation de l’embryon
humain. Est éthiquement inacceptable la création d’embryons à partir de dons de
gamètes afin de se procurer des cellules souches, étant donné que les embryons
surnuméraires représentent une source alternative disponible. Les perspectives
thérapeutiques éloignées doivent être mises en balance avec d’autres considérations
liées au risque que l’utilisation des embryons soit banalisée, que des
pressions soient exercées sur les femmes en tant que sources d’ovocytes et que
les possibilités d’instrumentalisation de la femme s’accroissent. Le
consentement libre et éclairé est nécessaire, et ce non seulement de la part du
receveur. Il faut informer le donneur de l’utilisation possible des cellules
embryonnaires pour la finalité considérée avant de lui demander son
consentement. Les possibilités de pressions coercitives ne doivent pas être
sous-estimées lorsque des intérêts financiers sont en jeu. Les embryons ne
peuvent être ni achetés ni vendus, ni même proposés à la vente. Des mesures
doivent être prises pour empêcher une telle commercialisation.
21. En 2002, le GEE a rendu un avis sur
la brevetabilité des cellules souches embryonnaires humaines[25].
Concernant l’applicabilité des brevets, le GEE a conclu que des cellules
souches isolées, qui n’ont pas été modifiées, ne répondent pas, en tant que
produits, aux exigences juridiques de la brevetabilité, notamment en ce qui
concerne les critères d’applicabilité industrielle. De même, des lignées de
cellules souches non modifiées peuvent difficilement être considérées comme un
produit brevetable. Des brevets sur de telles lignées de cellules souches non
modifiées auraient un champ d’application trop étendu. Seules les lignées de
cellules souches, qui ont été modifiées par des traitements in vitro ou génétiquement pour acquérir
les caractéristiques nécessaires en vue d’applications industrielles précises,
remplissent les conditions juridiques de la brevetabilité. Enfin, il n’y a pas
d’obstacle éthique particulier concernant les méthodes impliquant des cellules
souches humaines, quelle que soit leur source, à condition que ces méthodes
répondent aux trois critères de brevetabilité.
22. En 2007, le GEE a formulé des
recommandations sur la révision éthique du financement de projets de recherche
concernant les cellules souches embryonnaires, en reconnaissant la
nécessité de promouvoir la recherche, de servir l’intérêt général, de favoriser
la coopération internationale, de respecter l’autonomie de l’État membre et d’intégrer
l’éthique dans les initiatives en
matière de recherche[26]. Le
rapport indique que les lignées de cellules souches embryonnaires doivent
provenir d’embryons issus d’une FIV et non implantés, et que, si des solutions
autres que ces types de cellules souches sont trouvées, alors leur utilisation
doit être optimisée. En outre, le rapport souligne que les droits des donneurs
doivent être protégés et préservés en ce qui concerne la santé, le consentement
éclairé, la protection des données et la gratuité du don. Le GEE a conclu que l’utilisation
d’embryons humains pour générer des cellules souches devait « être réduite
autant que possible au sein de l’UE ».
ii. Les normes du Conseil de l’Europe
23. Le Conseil de l’Europe a d’abord
traité la question de l’utilisation des embryons humains à des fins scientifiques
dans la Recommandation 1046 (1986) de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe relative à l’utilisation d’embryons et fœtus humains à des fins
diagnostiques, thérapeutiques, scientifiques, industrielles et commerciales. L’Assemblée
a considéré que l’embryon et le fœtus humains doivent bénéficier en toutes
circonstances du respect dû à la dignité humaine, et que l’utilisation de leurs
produits et tissus doit être limitée de manière stricte et réglementée en vue
de fins purement thérapeutiques et ne pouvant être atteintes par d’autres
moyens. En conséquence, elle a invité les gouvernements des États membres à
limiter l’utilisation industrielle des embryons et de fœtus humains, ainsi que
de leurs produits et tissus, à des fins strictement thérapeutiques et ne
pouvant être atteintes par d’autres moyens, à interdire toute création d’embryons
humains par fécondation in vitro à des fins de recherche de leur vivant
ou après leur mort et à interdire tout ce qu’on pourrait définir comme des
manipulations ou déviations non désirables de ces techniques, entre autres la
recherche sur des embryons humains viables et l’expérimentation sur des
embryons vivants, viables ou non[27].
La Recommandation 1100 (1989) de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’utilisation des embryons et fœtus
humains dans la recherche scientifique souligne que l’embryon humain, bien qu’il
se développe en phases successives, « maintient néanmoins en continuité
son identité biologique et génétique ». Ainsi, elle prône l’interdiction
de la création et/ou du maintien en
vie intentionnels d’embryons ou fœtus, in
vitro ou in utero, dans un but de
recherche scientifique, par exemple pour en prélever du matériel génétique, des
cellules, des tissus ou des organes.
La Résolution 1352 (2003) de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe relative à la recherche sur les cellules
souches humaines souligne que « [l]a destruction d’êtres humains à des
fins de recherche est contraire au droit de tout être humain à la vie et à l’interdiction
morale de toute instrumentalisation de l’être humain », et en conséquence
invite les États membres à favoriser la recherche sur les cellules souches à
condition qu’elle respecte la vie des êtres humains à tous les stades de leur
développement[28].
24. L’article 18 de la Convention pour
la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard
des applications de la biologie et de la médecine énonce :
« 1. Lorsque
la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure
une protection adéquate de l’embryon.
2. La
constitution d’embryons humains aux fins de recherche est interdite. »[29]
Cette disposition affirme l’application du principe
de subsidiarité en établissant que le paramètre juridique essentiel à prendre
en compte est le droit interne de l’État membre concerné. Le paragraphe 1
dispose cependant qu’un statut juridique obligatoire doit être garanti à l’embryon,
lequel doit bénéficier d’une « protection adéquate ». Ainsi, l’utilisation
d’embryons à des fins scientifiques ne doit pas s’apprécier de manière
casuistique mais doit faire l’objet d’une évaluation fondée sur le principe du
caractère « adéquat » de la protection offerte à l’embryon, selon le
paramètre juridique européen. Les rédacteurs de la Convention d’Oviedo ont
donné une indication claire en ce sens, au paragraphe 2 de l’article 18, qui
prohibe expressément la constitution d’embryons humains dans le but de les
utiliser aux fins de la recherche, et à l’article 14, qui interdit la sélection
du sexe[30]. De
plus, cette évaluation fondée sur des principes est garantie par la Déclaration des Nations Unies sur le clonage
des êtres humains, qui invite les États membres à adopter toutes les
mesures voulues pour protéger « comme il convient » (« adequately ») la vie humaine dans l’application
des sciences de la vie.
Complément de la Convention européenne des droits
de l’homme dans le domaine de la biomédecine et de la science génétique, la
Convention d’Oviedo vise à définir des normes européennes en la matière[31].
Deux conséquences en découlent. Premièrement, la Cour européenne des droits
de l’homme (la Cour) est l’ultime interprète et garant des droits, libertés et
obligations énoncés dans la Convention d’Oviedo (article 29 de celle-ci), et
donc du caractère « adéquat » de la protection offerte à l’embryon,
en particulier à l’égard des techniques de génie génétique contraires à la
dignité humaine. Le problème susmentionné, à savoir que la distinction
entre les techniques « thérapeutiques » et les techniques visant à l’« amélioration
des caractéristiques normales » n’est pas toujours claire, ne fait qu’accroître
la nécessité d’une surveillance attentive de la Cour.
Deuxièmement, le fait que la Convention d’Oviedo et
ses Protocoles aient été ratifiés par un grand nombre d’États est un élément
solide permettant de considérer qu’un consensus européen tend à se former
autour des dispositions de cette Convention et de ses Protocoles. Ce consensus
est renforcé par les résolutions et recommandations susmentionnées de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, ainsi que le cadre législatif et jurisprudentiel complémentaire de
l’UE, à savoir la Directive 98/44/CE du
Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 et l’important arrêt
Oliver Brüstle, qui tous reflètent la
tendance du droit international à reconnaître à travers le monde une protection
juridique à l’embryon humain. À la lumière de tous ces instruments, si une
marge d’appréciation doit être accordée aux États membres du Conseil de l’Europe
sur des questions liées à l’existence et à l’identité d’un être humain, et
particulièrement à la recherche scientifique sur l’embryon humain, cette marge
doit être étroite[32].
Inspiré par une clause
similaire contenue à l’article 53 de la Convention européenne des droits de l’homme,
l’article 27 de la Convention d’Oviedo prévoit la possibilité pour le droit
interne d’accorder une protection plus étendue à la vie humaine. Il ne faut
toutefois pas interpréter cela comme octroyant une « ample » marge d’appréciation.
Il ne faut pas confondre les deux questions, comme la majorité semble le faire
au paragraphe 181 de l’arrêt. C’est une chose de permettre au législateur
national de protéger plus largement la vie humaine, les êtres, les fœtus et les
embryons humains, comme le prévoit l’article 27 de la Convention d’Oviedo[33] ;
c’en est une bien différente d’accepter en la matière une « ample »
marge d’appréciation, qui pourrait en fin de compte être invoquée, ou plutôt
détournée, aux fins de l’adoption d’une loi réduisant la protection des êtres,
fœtus et embryons humains[34].
25. En conséquence, une obligation
positive pour l’État de protéger l’embryon et d’autres formes de vie humaine
prénatale, tant in vitro qu’in utero, doit être tirée à la fois de l’article
2 et de l’article 8 de la Convention. Cette obligation positive inclut, tout d’abord,
l’obligation de favoriser le
développement naturel des embryons ; deuxièmement, l’obligation de
promouvoir les recherches scientifiques au bénéfice de l’embryon
donné qui en fait l’objet ; troisièmement, l’obligation de déterminer dans
quels cas exceptionnels les embryons et les lignées souches embryonnaires
peuvent être utilisés, et de quelle manière ; quatrièmement, l’obligation
de sanctionner au pénal toute utilisation d’embryons en dehors du cadre des
exceptions légales.
26. D’aucuns plaident qu’il s’agit là d’un
domaine en constante évolution, et que la
Cour ne devrait donc pas se compromettre
en adoptant une position scientifique bien définie, qui pourrait changer à
l’avenir. C’est un argument à double tranchant, qui peut servir à limiter l’ingérence
de la Cour dans la marge d’appréciation de l’État, mais aussi être avancé pour
étendre la surveillance par la Cour de l’ingérence de l’État au niveau de la
vie à naître. C’est précisément parce que ce domaine peut évoluer d’une manière
très dangereuse pour l’humanité, comme nous l’avons vu par le passé, qu’un
contrôle attentif de l’étroite marge d’appréciation des États, et une
intervention potentiellement préventive de notre Cour, est aujourd’hui une
nécessité absolue. Autrement, la Cour abandonnerait la plus fondamentale de ses
tâches, celle consistant à protéger les êtres humains contre toute forme d’instrumentalisation.
A. Le
caractère inutile de la restriction légale italienne
27. La requérante considère que faire
don de « ses » cinq embryons cryoconservés et non destinés à être
implantés relève de sa « vie privée » au sens de l’article 8 de la
Convention et répond à un intérêt général, dès lors que cet acte permettrait de
fournir aux chercheurs des cellules souches qui sont fort nécessaires pour la
recherche sur les maladies incurables[35]. Sur la base de l’interprétation
susmentionnée de l’article 8 de la Convention, combiné avec l’article 18 de la
Convention d’Oviedo, on peut admettre l’argument du Gouvernement selon lequel l’article
13 de la loi no 40 du 19 février 2004 poursuit le but légitime
consistant à protéger la potentialité de vie dont l’embryon est porteur. À cet
égard, la recherche scientifique sur l’embryon humain, autorisée à des fins
thérapeutiques et diagnostiques dans le but de protéger la santé et le
développement de l’embryon en question lorsqu’aucune autre méthode n’existe,
est une dérogation acceptable à l’interdiction de la recherche scientifique sur
les embryons humains.
28. À l’argument de la requérante selon
lequel la mort des cinq embryons cryoconservés est inévitable au regard du
cadre juridique italien actuel dès lors que l’implantation d’embryons post mortem est prohibée, tout comme l’acte d’en faire don pour la recherche
scientifique, le Gouvernement répond à juste titre que la cryoconservation n’est
pas limitée dans le temps. Les embryons congelés peuvent être conservés pendant
une période indéfinie. En outre, l’utilisation d’embryons cryoconservés à des
fins autres que la destruction, comme la fécondation hétérologue, est désormais
permise par l’ordre juridique italien, eu égard à l’arrêt no 162
de 2014 de la Cour constitutionnelle italienne.
B. Le
caractère contradictoire du cadre juridique italien applicable
29. À l’argument de la requérante
consistant à déclarer incohérent le cadre juridique italien, lequel permet l’importation
et l’utilisation de lignées de cellules souches issues d’embryons humains
précédemment détruits, le Gouvernement répond de manière convaincante que la
production de lignées de cellules embryonnaires
à l’étranger n’est pas effectuée à la demande des laboratoires italiens et n’est
pas incompatible avec l’interdiction qui en Italie frappe la destruction de ces
lignées de cellules. Enfin, dans les cas d’avortement, l’intérêt de la mère
doit être mis en balance avec celui du fœtus au regard du droit italien, ce qui
n’a pas été le cas en l’espèce.
C. Le
consensus européen non prohibitif
30. À l’argument de la requérante
relatif à l’existence d’un consensus européen, le Gouvernement oppose son ample
marge d’appréciation, réfutant l’existence d’un tel consensus en arguant que la
Convention d’Oviedo n’exige pas des recherches scientifiques destructrices sur
les embryons, que le programme de financement de l’Union européenne pour la
recherche scientifique ne prévoit pas le financement de projets impliquant la
destruction d’embryons et que l’arrêt
Oliver Brüstle a interdit la
brevetabilité des inventions impliquant la destruction d’embryons humains.
Comme indiqué ci-dessus, les instruments internationaux invoqués par le
Gouvernement étayent l’argument relatif à
une étroite marge d’appréciation, aux fins précisément de la protection de
l’embryon.
IV. La position de la majorité
31. Le raisonnement de la majorité est
à la fois contradictoire sur le plan de la logique et irrecevable sur le plan
scientifique. Il est illogique parce que la majorité admet, d’un côté, que l’embryon
est « autrui » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention,
dès lors que la protection de la potentialité de vie dont il est porteur peut
être rattachée au but consistant à protéger les « droits et libertés d’autrui » (paragraphe 167)[36]. De
l’autre côté, toutefois, la même majorité déclare que cette reconnaissance n’implique
aucune appréciation par la Cour du point de savoir si le terme
« autrui » s’étend à l’embryon humain. L’évidente contradiction entre
ces deux déclarations est si flagrante qu’elle en est insoluble. La seule lecture
possible de cette contradiction consiste à dire que la majorité était si
partagée qu’elle n’a pu déterminer si la déclaration de principe contenue au
paragraphe 59 de l’arrêt Costa et Pavan
devait prévaloir sur la déclaration de principe en sens opposé figurant au
paragraphe 228 de l’arrêt A, B et C c.
Irlande
([GC], no 25579/05, CEDH 2010). Avec un peu d’effort
interprétatif, on pourrait
arguer que l’ordre des déclarations indique une certaine prédominance de la
première sur la seconde.
Dans ce contexte, il est tout à fait notable que la
Grande Chambre ne cite ni le paragraphe 56 de l’arrêt Evans c. Royaume-Uni (précité), dans lequel elle a dit que
« les embryons créés par la requérante et J. ne [pouvaient] se prévaloir
du droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention », ni l’arrêt
rendu par la chambre le 7 mars 2006 dans la même affaire (§ 46), ni même
la classique déclaration de principe qui figure dans Vo c. France ([GC], no 53924/00, § 82, CEDH 2004).
Cette omission mérite d’être signalée. Non seulement elle traduit le malaise de
la Grande Chambre face au principe « anti-vie » de l’arrêt Evans, mais
de plus elle consolide le principe opposé, énoncé au paragraphe 59 de Costa et Pavan, selon lequel l’embryon
est un « autrui », un sujet doté d’un statut juridique qui peut et
doit être mis en balance avec le statut juridique des géniteurs, principe qui
cadre parfaitement avec la position de la Cour constitutionnelle italienne sur
le droit à la vie de l’embryon protégé par l’article 2 de la Constitution
nationale[37].
32. Pour la même raison, je ne peux pas
davantage admettre que le droit à l’autodétermination s’agissant de fonder une
famille, évoqué par la Cour constitutionnelle italienne dans l’arrêt no
162 de 2014, soit interprété comme incluant un « droit négatif » à
disposer des embryons non implantés. Le raisonnement figurant au paragraphe 157
du présent arrêt repose donc sur un rhétorique « sophisme du milieu non
distribué » (fallacy of the
undistributed middle), qui
permet à la majorité de partir du principe que, parce qu’elles partagent une
propriété commune, deux catégories distinctes sont liées. Autrement dit, en
interprétant l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 juin 2014, la majorité
postule que, puisque le droit de devenir parent est un aspect de la vie privée
d’un individu, de même que le droit de bénéficier d’une fécondation in vitro,
ces deux droits ne sont soumis à aucune restriction dans la mesure où il s’agit
de droits à l’ « autodétermination » ; elle oublie
cependant que dans le second cas l’exercice par les géniteurs de leur droit à l’ « autodétermination »
peut empiéter sur l’existence d’une autre vie humaine, celle de l’embryon non
implanté. Comme l’a dit la Cour constitutionnelle italienne elle-même dans l’arrêt
susvisé, « [l]a libertà e
volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori e di formare una
famiglia nel senso sopra precisato, di sicuro non implica che la libertà in
esame possa esplicarsi senza limiti » (la liberté et le caractère
volontaire de l’acte permettant à un individu de devenir parent et de fonder
une famille dans le sens défini ci-dessus ne signifie assurément pas que la
liberté en question puisse passer pour illimitée). En bref, le raisonnement
tenu par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt no 162 de 2014 n’accrédite
pas l’existence d’un droit illimité
à l’« autodétermination » ou à la « liberté de choix des parties
à un traitement par fécondation in vitro en ce qui concerne le sort des
embryons non destinés à l’implantation ». Il est erroné d’interpréter le
raisonnement de la Cour constitutionnelle en faveur de l’« adoption pour
la naissance » – c’est-à-dire de la vie de l’embryon – comme
autorisant les parties à un traitement par FIV à détruire les embryons qui en
sont issus.
33. Le raisonnement de la majorité est
également irrecevable sur le plan scientifique, car il admet que « les
embryons (...) renferment le patrimoine génétique de la personne en question et
représentent à ce titre une partie constitutive de celle-ci et de son identité
biologique » (paragraphe 158). De toute évidence, la majorité néglige le
fait que l’embryon a une identité biologique distincte de celle de la personne
ayant bénéficié de la FIV, même s’il contient le patrimoine génétique de cette
personne. La déclaration figurant au paragraphe 158 de l’arrêt est
inacceptable, sur le plan ontologique comme sur le plan biologique. La majorité
a oublié que la dignité humaine impose de respecter « le caractère unique
de chacun et la diversité » des êtres humains, comme le dit la Déclaration
universelle sur le génome humain et les droits de l’homme. Autrement dit, tout
être humain est bien plus qu’une combinaison unique d’informations génétiques
transmises par ses géniteurs.
34. Le manque de clarté du raisonnement
de la majorité transparaît également dans la définition de la théorie sur la
marge d’appréciation applicable. Au paragraphe 169 de l’arrêt, la majorité
reconnaît que la marge laissée à l’État est « restreinte » pour les
questions relatives à « l’existence ou [à] l’identité d’un
individu », mais elle admet aussi que « lorsque l’affaire soulève des
questions morales ou éthiques délicates », la marge d’appréciation est
plus large. Là encore, cela n’a aucun sens à mes yeux. Les questions touchant à
l’existence ou à l’identité d’un individu, en l’occurrence au commencement et à
la fin de la vie humaine, sont en soi lourdement influencées par des
considérations éthiques et morales. J’irai même jusqu’à dire que la plupart des
droits fondamentaux garantis par la Convention et ses protocoles sont
indissociablement liés à des questions éthiques et morales débattues depuis de
longues années. Ainsi, le caractère intrinsèquement moral ou éthique d’une
question juridique soumise au contrôle de la Cour ne doit pas être un facteur
qui restreint la compétence de celle-ci ou qui détermine la marge d’appréciation
à laisser à l’État. L’argument relatif au caractère délicat, sur le plan
éthique ou moral, de la question en jeu est donc dénué de pertinence lorsqu’il
s’agit d’établir l’ampleur de la marge d’appréciation[38].
35. À cela, la majorité ajoute, au
paragraphe 174, que la relation entre la requérante et « ses »
embryons « ne porte pas sur un aspect particulièrement important de l’existence
et de l’identité de l’intéressée ». Là encore, la majorité se contredit.
Alors que plus haut, au paragraphe 158, elle a déclaré que les embryons
représentaient une « partie constitutive » du patrimoine génétique de
la requérante et de son identité biologique, au paragraphe 174 elle dit le
contraire et conclut que la protection d’une « partie constitutive »
de l’identité biologique de l’intéressée ne
fait pas partie du noyau dur des droits garantis par l’article 8. Cela dépasse mon entendement que la majorité
puisse, selon sa propre logique, soutenir que le noyau dur des droits garantis par l’article 8 n’englobe pas la protection d’une « partie
constitutive » de l’identité de la requérante.
36. Ayant admis que la marge d’appréciation
n’est pas illimitée, la majorité promet une analyse des « arguments dont
le législateur a tenu compte pour parvenir aux solutions qu’il a
retenues » (paragraphe 183). Hélas, aucune analyse de ce type n’a été
faite. Dans les paragraphes qui suivent, la majorité évoque simplement
– et superficiellement – le processus national au terme duquel la loi
litigieuse a été approuvée, mentionnant le « débat qui avait tenu compte des différentes
opinions et des questions scientifiques et éthiques existant en la
matière » (paragraphe 184),
un rapport parlementaire sur les différentes contributions de « médecins, spécialistes et associations engagées
dans le domaine de la procréation médicalement assistée » (paragraphe 185), certaines critiques formulées
lors des débats du 19 janvier 2004 (paragraphe 186), ainsi que plusieurs référendums dont la loi a fait l’objet (paragraphe 187). La
conclusion selon laquelle « lors
du processus d’élaboration de la loi litigieuse, le législateur avait déjà tenu
compte des différents intérêts ici en cause » (paragraphe 188) est déconcertante. Elle n’ajoute
rien à l’appréciation au fond de la question.
37. Après avoir consacré neuf
paragraphes à l’ampleur de la marge d’appréciation (paragraphes 174-182) et six
paragraphes au processus national d’approbation de la loi (paragraphes 183-188), l’arrêt se penche enfin, aux
paragraphes 189 à 195, sur le cœur des arguments de la requérante, à savoir les
contradictions alléguées de l’ordre juridique italien. Ici, la majorité s’aligne
clairement sur la position du Gouvernement. Si elles n’entrent guère dans les
détails, les importantes déclarations contenues aux paragraphes
193 et 194 n’en signalent pas moins clairement aux Parties contractantes que la
Cour ne s’oppose pas à la politique d’importation et d’utilisation de lignées
de cellules souches issues d’embryons humains qui ont été détruits hors de l’espace
juridique européen, tant qu’elles ne sont pas produites à la demande des
Parties contractantes.
V. L’application des normes de la Cour
38. L’insuffisance du raisonnement de
la majorité n’enlève rien à l’essentiel. Malgré les hésitations et
contradictions que comporte son raisonnement, la majorité rappelle le principe
issu de l’affaire Costa et Pavan
selon lequel les embryons sont « autrui » aux fins de la Convention
et, à la lumière de ce principe, admet que leur protection justifie l’interdiction
de la recherche sur l’embryon humain
et de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, et ce
à deux exceptions près :
a) La recherche scientifique sur l’embryon
humain peut être autorisée si elle poursuit des finalités thérapeutiques et
diagnostiques tendant à la protection de la santé ainsi qu’au développement de
l’embryon et s’il n’existe pas d’autres méthodes ;
b) La recherche sur les cellules souches
embryonnaires est autorisée à condition d’être effectuée uniquement sur des
lignées de cellules souches obtenues à partir d’embryons humains détruits hors
de l’espace juridique européen sans intervention des Parties contractantes.
39. Dès lors que l’embryon n’est pas
une chose ou un « bien », comme la Cour le dit à juste titre au
paragraphe 215 de l’arrêt, c’est un « autrui » avec lequel la
personne ayant bénéficié de la FIV a une relation parentale potentielle. Dans
la mesure où l’embryon possède une identité biologique unique mais partage le
patrimoine génétique de ses géniteurs, le caractère privé de la relation entre
ces êtres humains est incontestable. C’est pourquoi l’article 8 entre en
jeu[39].
40. Pour la majorité, la législation
italienne n’outrepasse pas l’ample marge d’appréciation dont jouit l’État
défendeur (paragraphe 197). À mon avis, la première exception ne va pas au-delà
des limites étroites de la marge d’appréciation de l’État pour les questions
liées à l’existence et à l’identité d’êtres humains. De plus, elle cadre avec
le but de la Convention d’Oviedo, qui doit aujourd’hui être considérée comme le
complément de la Convention européenne des droits de l’homme dans le domaine de
la biomédecine et de la science génétique. Bien qu’il n’ait pas encore ratifié
la Convention d’Oviedo, l’État italien s’est conformé à l’objet de cet instrument
consistant à protéger la vie humaine, les êtres, fœtus et embryons humains, à la protection par la Convention de l’embryon
en tant qu’ « autrui », sujet doté d’un statut juridique, à l’interdiction
de la discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques énoncée dans la
Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, et au
principe primordial de la Déclaration d’Helsinki selon lequel la recherche
médicale sur un groupe vulnérable n’est
justifiée que si elle correspond aux besoins ou priorités sanitaires de ce
groupe, ce qui – au sens le plus profond – ne peut qu’englober les
membres les plus vulnérables de toute l’humanité, à savoir les embryons.
41. La situation est plus délicate en
ce qui concerne la seconde exception. Eu égard à l’intention de la Grande
Chambre de garantir le « droit » de l’embryon en tant qu’« autrui »
dans tout l’espace juridique européen, et aux principes fondamentaux du
raisonnement juridique, cette exception doit être interprétée de manière
étroite. La seconde exception implique, en toute logique, trois conséquences.
Premièrement, une Partie contractante à la Convention ne peut ni utiliser ni
autoriser l’utilisation sur son territoire de lignées cellulaires issues d’embryons
détruits hors de l’espace juridique européen à l’initiative de cette Partie.
Deuxièmement, une Partie contractante ne peut ni utiliser ni autoriser l’utilisation
sur son territoire de lignées cellulaires issues d’embryons détruits sur le territoire
d’une autre Partie contractante. Troisièmement, une Partie contractante ne peut
ni utiliser ni autoriser l’utilisation sur son territoire de lignées
cellulaires issues d’embryons détruits hors de l’espace juridique européen à l’initiative
d’une autre Partie contractante.
42. Seule cette interprétation étroite
de la seconde exception permet de garantir son application dans le contexte de
l’article 8 § 2 de la Convention. À défaut, le fait d’utiliser ou d’autoriser
l’utilisation sur le territoire d’une Partie contractante de lignées
cellulaires issues d’embryons détruits hors de l’espace juridique européen à l’initiative
de cette Partie ou de toute autre Partie à la Convention permettrait d’externaliser
la violation de la Convention. De surcroît, le fait d’utiliser ou d’autoriser l’utilisation
sur le territoire d’une Partie contractante de lignées cellulaires issues d’embryons détruits sur le territoire d’une
autre Partie contractante rendrait la première Partie contractante complice de la violation de la Convention par
la seconde. Aucune de ces situations n’est tolérable au regard des règles sur
la responsabilité internationale des États, combinées avec les obligations
incombant aux Parties contractantes en vertu de la Convention[40].
43. La vie humaine à naître n’est en
rien différente par essence de la vie postnatale. Les embryons humains doivent
en toute circonstance être traités avec tout le respect qui est dû à la dignité
humaine. Les applications de la recherche scientifique concernant le génome
humain, en particulier dans le domaine de la génétique, ne prévalent pas sur le
respect de la dignité humaine. Les progrès de la science ne doivent pas reposer
sur le non-respect de la nature humaine ontologique.
Le but scientifique consistant à sauver des vies humaines ne justifie pas l’emploi
de moyens intrinsèquement destructeurs pour cette vie.
Le commencement et la fin de la vie humaine ne sont
pas des questions de politique à laisser à la discrétion des États membres du
Conseil de l’Europe. Le caractère « adéquat » de la protection
offerte à l’embryon par les Parties contractantes à la Convention est soumis au
contrôle attentif de la Cour, car les États n’ont qu’une étroite marge d’appréciation
s’agissant des questions fondamentales liées à l’existence et à l’identité de l’être
humain. En Europe, la Convention établit une insurmontable limite à la
possibilité de faire des
expérimentations sur la vie humaine. Ainsi, il est
incompatible avec la Convention de produire ou d’utiliser des embryons humains
vivants pour la préparation de cellules souches embryonnaires, ou de produire
des embryons humains clonés puis de les détruire pour produire des cellules
souches embryonnaires. Dans l’espace juridique européen, la recherche
scientifique sur les embryons humains et les lignées de cellules souches
embryonnaires n’est autorisée que dans les deux cas exceptionnels évoqués
ci-dessus.
OPINION CONCORDANTE DU
JUGE DEDOV
(Traduction)
1 La
Cour a conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention. Tout en
souscrivant à cette conclusion, je pense que cette affaire aurait pu apporter
beaucoup plus à la jurisprudence de la Cour concernant le début de la vie.
2. La
Cour a relevé que la présente espèce, contrairement aux affaires précédentes, n’avait
pas trait au choix de la requérante de devenir parent, et que cela
affaiblissait sa position. Elle s’est livrée à une analyse des intérêts
concurrents en jeu, à savoir l’ample marge d’appréciation dont dispose l’État
en matière de protection des embryons et le droit de la requérante à l’autodétermination.
3. Le
Gouvernement invoque la « potentialité de vie dont l’embryon est
porteur » pour démontrer la légitimité de la finalité de l’ingérence. Cet
important objectif, qui ne peut se réduire à une question de marge d’appréciation,
présuppose que l’embryon conditionne le développement d’un être humain. Le fait
que le droit à la vie soit en jeu change complètement l’approche judiciaire,
conformément au rôle de la Cour s’agissant d’interpréter la Convention, y
compris l’obligation positive de l’État de préserver le début de la vie.
4. Le
principe du respect du droit à la vie de l’embryon signifie qu’on ne peut
apporter des limites à la décision judiciaire en invoquant la marge d’appréciation.
Sinon, la Cour devrait aussi conclure à la non-violation dans la situation
opposée, c’est-à-dire dans le cas où un requérant s’opposerait au don de ses
embryons à des fins de recherche scientifique, qu’un État peut autoriser ou ne
pas interdire.
5. À
mon avis, le droit à la vie de l’embryon est un critère clé pour parvenir à la
bonne décision. Je suis sûr que si ce critère avait été appliqué, de nombreuses
affaires précédentes, telles que les affaires Evans, Vo et S.H. (citées
dans l’arrêt), auraient été tranchées en faveur des requérantes, qui
souhaitaient en réalité devenir parents et, en conséquence, sauver la vie de l’embryon.
6. De
nombreuses sources viennent étayer ce point de vue. Elles ont été présentées à
la Cour par les tiers intervenants et les institutions européennes. Ces sources
comprennent notamment l’initiative citoyenne européenne « One of
us », l’affaire Brüstle et le
règlement Horizon 2020. En particulier, la Recommandation 874 (1979) de l’APCE
relative à la Charte européenne des droits de l’enfant affirme « les
droits de chaque enfant à la vie dès le moment de sa conception ». Je
regrette de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la Cour interaméricaine des
droits de l’homme dans l’affaire Murillo
(citée dans l’arrêt) selon laquelle la « conception » n’intervient qu’après
l’implantation de l’embryon dans l’utérus. D’un point de vue humain, je préfère
le point de vue du gouvernement italien selon lequel, aux fins de préserver la
potentialité de l’embryon, il est vital de l’implanter dans l’utérus d’une
autre femme souhaitant devenir mère en ayant recours à cette méthode.
7. Il
me faut également mentionner la Résolution 1352 (2003) de l’APCE relative à la
recherche sur les cellules souches humaines, qui est encore plus explicite :
« [l]a destruction d’êtres humains à des fins de recherche est contraire
au droit de tout être humain à la vie (...) » (paragraphe 10 de la
Résolution). De plus, grâce à l’initiative citoyenne européenne « One of
us », le droit à la vie de l’embryon a été expressément reconnu par des
millions de citoyens européens, et l’initiative a été soutenue par les
instances dirigeantes de l’Union européenne. Cependant, la Cour est toujours
silencieuse sur ce sujet. Cette ambiguïté, qui perdure d’affaire en affaire, a
finalement affecté la requérante et ses représentants légaux, qui ne savaient
pas avec certitude quel article de la Convention devrait être appliqué en l’espèce,
ou quel droit devrait être protégé : le droit à la vie privée ou le droit
de propriété.
8. Je
ne suis pas convaincu que la marge d’appréciation ou l’absence de consensus
devrait interdire à la Cour de parvenir à une telle conclusion. Étant donné que
le droit à la vie est absolu, et constitue l’un des droits les plus
fondamentaux, ni la marge d’appréciation ni la souveraineté ni le consensus ne
constituent des éléments pertinents en la matière. La marge d’appréciation n’intervient
que s’agissant de déterminer quelles mesures sont nécessaires pour protéger une
valeur fondamentale (par exemple les dépenses publiques ou un délai pour la
cryoconservation d’embryons). La vie de l’embryon ne saurait être sacrifiée aux
fins de la concurrence entre États en matière de biomédecine.
9. Le
droit à la vie est absolu, et ce précepte fondamental fait qu’il est inutile d’expliquer
pourquoi un meurtrier, un handicapé, un enfant abandonné ou un embryon doivent
être gardés en vie. Nous n’avons pas besoin d’évaluer leur utilité pour la
société, mais nous plaçons de l’espoir en leur potentialité. Le droit à la vie
de l’embryon ne saurait être remis en question par le fait que, jusqu’à son
implantation, son potentiel de développement est quelque chose qui peut être
maintenu artificiellement, parce que toute technologie de la sorte est un
développement naturel créé par les êtres humains.
10. Même
si le droit à la vie est absolu, on pourrait réfléchir aux conséquences de
cette approche et j’aimerais exprimer quelques pensées à ce sujet. Premièrement,
le droit de la requérante à l’autodétermination ne serait en rien affecté si l’embryon
était donné à une autre femme de manière anonyme. Deuxièmement, la recherche se
tournerait (et se tourne déjà) vers une autre direction, celle consistant à reprogrammer
des cellules adultes en cellules souches ou à recombiner l’ADN, si nécessaire,
en particulier pour cultiver un nouvel organe destiné à une personne malade à
partir des propres cellules souches de celle-ci.
11. La
décision litigieuse du gouvernement italien de maintenir la vie de l’embryon n’est
pas une mesure extraordinaire. Pareille approche est adoptée dans toutes les
sociétés qui dépensent déjà des fonds publics en vue de soutenir les personnes
handicapées ou autres qui ne peuvent pas prendre soin d’elles-mêmes. De plus,
étant donné que les banques de sperme et d’ovules existent, ce ne serait pas un
problème de créer une banque d’embryons (gamètes). Finalement, un don – en l’espèce
un don automatique que certains peuvent considérer comme une ingérence – est
éthiquement acceptable s’il est nécessaire pour sauver la vie d’une personne.
12. La
nature absolue du droit à la vie permet de concilier toutes les opinions
éthiques, morales, religieuses, scientifiques, sociales ou autres. L’unique
question éthique que j’admettrais dans le développement de la biomédecine est
la question de la paternité/maternité dans le contexte du don. Comme l’a
expliqué le Gouvernement, le seul moyen de maintenir la potentialité de vie de
l’embryon est de l’implanter dans l’utérus d’une autre femme (incapable de
concevoir) qui souhaite avoir un enfant. En pareille situation, la situation de
la requérante en tant que donneuse devrait être reconnue automatiquement. Le
statut juridique de donneur permet de résoudre les problèmes éthiques puisque
la maternité, en termes de relations familiales, diffère de la simple
similarité du matériel génétique. Dans l’affaire S.H., la Cour a conclu à la non-violation des droits de la
requérante par l’État défendeur à raison de l’interdiction du don de matériel
reproductif de tierces personnes autres que les parents du futur enfant. Dans
la situation opposée, comme en l’espèce, la Cour a de nouveau conclu à la
non-violation. Tel est le cas parce que les principes pertinents (le droit à la
vie) n’ont pas été appliqués par la Cour, et l’affaire S.H. était donc malheureuse. Le présent arrêt rend l’issue de
futures affaires touchant à la biomédecine imprévisible.
13. Le
rôle de la Cour est de déterminer les valeurs fondamentales et les intérêts
prédominants afin d’examiner chaque affaire particulière sur le fond. En
conséquence, la Cour ne peut que conclure que le droit à la vie, en tant que l’un
des droits et libertés fondamentaux, est en jeu en l’espèce.
14. Étant
donné que les nouvelles biotechnologies étendent objectivement notre perception
des formes et conditions de l’existence humaine, je ne vois aucun obstacle
objectif à la reconnaissance juridique, dès que possible, de cette évolution,
dès lors que l’on sait bien que tout retard dans pareille reconnaissance au
niveau national et international est potentiellement mortel et arbitraire.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE
COMMUNE DES JUGES CASADEVALL, RAIMONDI, BERRO, NICOLAOU ET DEDOV
1. Nous
ne partageons pas entièrement le raisonnement de la Grande Chambre en ce qui
concerne le rejet de l’exception de non-épuisement des voies de recours
internes soulevée par le gouvernement italien.
2. Nous
avions été initialement convaincus par l’analyse du Gouvernement. Celui-ci a
observé que, s’il est vrai que la question de constitutionnalité ne peut être
soulevée que par le juge et non par les parties – dont le pouvoir se limite à
solliciter qu’on fasse usage de cette faculté, et qu’il ne s’agit donc pas d’un
recours à épuiser en principe au sens
de l’article 35 de la Convention, il n’en va pas de même dans le cadre
juridique établi par les célèbres arrêts dits « jumeaux » de la Cour
constitutionnelle nos 348 et 349 de 2007, qui concernent l’hypothèse
d’un conflit entre une loi italienne et la Convention telle qu’interprétée par
la Cour.
3. Le
Gouvernement a souligné, à juste titre selon nous, que si le juge du fond avait
constaté l’existence d’un conflit insurmontable entre son interprétation de la
loi et les droits invoqués par la partie demanderesse, il aurait eu l’obligation
de soulever une question de constitutionnalité. La Cour constitutionnelle
aurait alors examiné au fond la compatibilité des faits litigieux avec les
droits de l’homme, et elle aurait pu annuler les dispositions nationales avec
effet rétroactif et erga omnes.
4. En
effet, le cadre juridique découlant de ces deux arrêts de 2007 place le juge du
fond devant une alternative lorsque se pose la question de la compatibilité de
la loi nationale avec la Convention : ou bien il parvient, avec tous les
moyens techniques dont il dispose, à lire la loi nationale dans un sens
conforme à la Convention telle qu’interprétée par la Cour de Strasbourg, ou
bien il doit renvoyer la question à
la Cour constitutionnelle, laquelle annulera la loi interne à moins qu’elle ne
constate l’existence d’un conflit entre la Convention et la Constitution
italienne. Il s’agit là d’une alternative au sens strict (tertium non datur).
5. Dans
ces conditions, la jurisprudence traditionnelle de la Cour évoquée au
paragraphe 101 de l’arrêt ne devrait pas s’appliquer en l’espèce. D’après cette
jurisprudence, fondée sur l’absence d’accès direct des particuliers à la Cour
constitutionnelle italienne due à la règle voulant que seule une juridiction
qui connaît du fond d’une affaire ait la faculté de la saisir, à la requête d’un
plaideur ou d’office, pareille requête ne saurait s’analyser en un recours dont
la Convention exige l’épuisement.
6. Mais
lorsqu’un requérant potentiel met en cause la compatibilité d’une loi nationale
avec la Convention, nous ne sommes plus dans le cas de figure classique où le
juge du fond est seul maître de la décision de saisir ou de ne pas saisir la
Cour constitutionnelle. Dans cette hypothèse, qui est celle de l’espèce, la
jurisprudence traditionnelle n’est plus pertinente : si le juge du fond
est placé par le requérant potentiel dans la situation de devoir apprécier la
compatibilité d’une loi nationale avec la Convention, il pourra bien entendu
interpréter la loi nationale dans un sens conforme à la Convention. Toutefois,
s’il n’y parvient pas, il n’aura pas le choix : il devra renvoyer la question – à condition bien sûr qu’elle soit
pertinente pour la solution du litige – à la Cour constitutionnelle.
7. Dans cette
situation, un
requérant potentiel qui n’a pas obtenu du juge du fond une interprétation de la
loi nationale conforme à la Convention a
le droit de voir la Cour constitutionnelle se prononcer sur la question, à
une réserve près que nous examinerons ci-dessous et qui s’applique en l’espèce.
8. La
seule raison qui nous conduit à nous rallier en définitive à la décision de la
majorité concluant au rejet de cette
exception dans la présente affaire tient à l’évolution de la jurisprudence de
la Cour constitutionnelle italienne qui s’est fait jour dans un arrêt no
49 déposé le 26 mars 2015. Dans cet arrêt, la haute juridiction a analysé,
entre autres, la place de la Convention européenne des droits de l’homme et de
la jurisprudence de la Cour dans l’ordre juridique interne, indiquant à cet
égard que le juge du fond n’était tenu de se conformer à la jurisprudence de la
Cour que dans le cas où celle-ci était « bien établie » ou énoncée
dans un « arrêt pilote ». Or lorsque se pose une question nouvelle,
comme c’est indéniablement le cas en l’espèce, la position adoptée par la Cour
constitutionnelle exclut que l’on puisse considérer que le requérant potentiel
doit saisir le juge interne avant de s’adresser à la Cour.
9. Cela dit,
nous constatons que la motivation de l’arrêt, de laquelle nous devons nous
démarquer en partie pour les raisons susmentionnées, renvoie à l’arrêt no
49/2015 de la Cour constitutionnelle italienne (paragraphe 100 du présent
arrêt), et que ce renvoi lui confère un caractère éclectique. Nous y voyons une
ouverture par rapport à la jurisprudence traditionnelle.
10. Le poids
accordé à cette décision dans la motivation du présent arrêt ouvre à notre avis
la voie à une remise en cause de la jurisprudence traditionnelle de la Cour –
dans les limites permises par la nouvelle jurisprudence de la Cour
constitutionnelle italienne, bien entendu – qui pourrait l’amener à considérer
que, même lorsqu’une loi est directement à l’origine de la violation alléguée,
le requérant potentiel doit en principe
saisir d’abord le juge interne, pour autant que le cadre juridique tracé par
les arrêts nos 348 et 349 de 2007 de la Cour constitutionnelle
italienne puis atténué par l’arrêt no 49/2015 rendu par cette
même cour ne soit pas remis en cause dans sa substance même.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE
DES JUGES CASADEVALL, ZIEMELE, POWER-FORDE, DE GAETANO ET YUDKIVSKA
(Traduction)
1. Dans
sa requête, la requérante alléguait que l’interdiction, édictée par le droit
italien, de donner à la recherche scientifique des embryons conçus par procréation médicalement assistée
était incompatible avec son droit au respect de sa vie privée. Dans le présent
arrêt, la Cour juge que la possibilité pour l’intéressée d’exercer un choix
conscient et réfléchi quant au « sort à réserver à ses embryons »
touche un aspect intime de la vie personnelle de celle-ci et relève à ce titre
de son droit à l’autodétermination (§ 159 du présent arrêt). La Cour en déduit
que l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce et conclut à
la non-violation de cette disposition, au motif notamment que l’interdiction
litigieuse est « nécessaire dans une société démocratique » à la
protection des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 8 § 2 de la
Convention.
2. Bien
que nous ayons voté pour la non-violation de l’article 8 de la Convention, les
motifs qui nous ont conduits à cette conclusion diffèrent grandement de ceux
qui ont été retenus dans le présent arrêt. Nous nous dissocions de la majorité
bien avant l’appréciation de la proportionnalité de l’interdiction incriminée à
laquelle celle-ci s’est livrée. Nous estimons en effet que le grief de la
requérante est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 §§
3 et 4 de ce texte.
3. L’ancienne
Commission et la Cour ont déjà eu à connaître de nombreuses affaires sensibles
dans lesquelles se posaient des questions fondamentales touchant à la
potentialité de la vie humaine, au début de la vie humaine, et à la vie humaine
embryonnaire ou fœtale, en rapport ou non avec les droits de la personnalité d’autrui[41]. Bien que la
Cour ait jugé que les questions ayant trait à la procréation – et, en
particulier, à la décision de devenir ou de ne pas devenir parent – constituent
un aspect de la vie privée des personnes[42], elle s’est
abstenue de statuer sur le point fondamental de savoir à quel moment débute la
« vie protégée » par la Convention. En conséquence, elle s’est gardée
de se prononcer sur le statut de l’embryon humain en tant que tel.
4. Comme
la Cour le reconnaît dans le présent arrêt, la requérante revendiquait en
réalité le droit de « disposer d’embryons »
(§ 149) ou, en d’autres termes, le droit de « décider du sort » d’embryons
issus d’une fécondation in vitro (§
152). Or la Cour juge ici, pour la première fois, que le fait de « décider du sort » d’embryons ou d’en
« disposer » relève du
droit des personnes au respect de leur vie privée (§ 152). Le présent
arrêt marque donc un tournant décisif dans la jurisprudence de la Cour. Il s’agit
là d’une décision d’une portée considérable – et à nos yeux inacceptable – sur
le statut de l’embryon humain.
5. La
conclusion à laquelle parvient la majorité est déconcertante non seulement en
raison de la connotation utilitaire des termes employés par celle-ci pour
parler de l’embryon humain, mais aussi de la logique déroutante sur laquelle
repose la décision adoptée. La raison pour laquelle la majorité considère qu’un
choix concernant « le destin de l’embryon » relève de la sphère de la
vie privée de la requérante tient « au lien
existant entre la personne qui a eu recours à une fécondation in vitro et les
embryons ainsi conçus ». Selon la majorité, ce lien découle du fait
que « [ces embryons] renferment
le patrimoine génétique de la personne en question et représentent à ce titre une partie constitutive de celle-ci et de
son identité biologique »
(§ 158) (gras ajouté).
6. La
conclusion selon laquelle l’embryon est une « partie constitutive »
de l’identité de la requérante revêt une portée considérable. Contrairement à
la majorité, nous estimons que l’embryon ne saurait être considéré comme une
simple partie constitutive de l’identité de telle ou telle personne, que cette
identité soit biologique ou d’une autre nature. S’il hérite du patrimoine
génétique de ses « parents » biologiques, l’embryon humain n’en est
pas moins une entité séparée et distincte dès les tout premiers stades de son développement.
S’il n’était qu’une partie constitutive de l’identité de telle ou telle
personne, pourquoi tant de rapports, de recommandations, de conventions et de
protocoles internationaux seraient-ils consacrés à sa protection ? Ces
instruments reflètent l’existence, au sein de la communauté humaine, d’un large
consensus sur le fait que l’embryon n’est pas une simple « chose ».
Comme l’a déclaré l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, l’embryon
est une entité qui « doi[t] bénéficier en toutes circonstances du respect
dû à la dignité humaine » (§ 53).
7. L’approche
adoptée par la Cour dans la présente affaire consacre une conception
positiviste et réductrice de l’embryon humain. Ayant qualifié l’embryon de
« partie constitutive » du matériel génétique et de l’identité
biologique de telle ou telle personne, la Cour décide que la question du sort
de l’embryon et de l’ « usage » qui peut en être fait relève du
droit de cette personne au respect de sa vie privée. L’ADN de l’embryon humain,
comme celui de toutes les autres entités humaines, provient nécessairement de
celui de ses « parents » biologiques. Mais il est hasardeux et
arbitraire de se fonder sur une simple parenté génétique pour décider que le
sort d’une entité humaine relève du droit de telle ou telle personne à l’autodétermination.
8. La
confusion qui caractérise le raisonnement de la majorité et qui est manifeste
dans la partie consacrée à la recevabilité de la requête s’étend
malheureusement à la motivation de l’arrêt (§ 167). Pour apprécier la
proportionnalité de l’interdiction litigieuse, la majorité considère que
celle-ci peut être rattachée au but de protection « des droits et libertés
d’autrui », mais elle se hâte d’ajouter que cela n’implique aucun jugement
sur le point de savoir si le mot « autrui » englobe l’embryon
humain !
9. Nous
considérons pour notre part, conformément à la jurisprudence de la Cour en
vigueur jusqu’à présent, qu’il eût été préférable de conclure que le droit de
la requérante à l’ « autodétermination »
en tant qu’aspect de sa vie privée n’était tout simplement pas en cause puisque
la question d’une possible maternité ne se posait pas en l’espèce. Nous
observons que l’intéressée a déclaré que le don de ses embryons susciterait
chez elle un « noble sentiment ». Toutefois, il va sans dire que la
Convention a pour vocation exclusive de protéger les droits fondamentaux de l’homme,
non de promouvoir des sentiments, quelle qu’en soit la nature. Le droit
revendiqué par la requérante de « disposer
de ses embryons » à des fins de recherche scientifique n’entre pas
dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention. En
conséquence, nous estimons que la requête aurait dû être rejetée comme étant
incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de ce
texte.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE
DU JUGE NICOLAOU
(Traduction)
1. À
mon avis, la requête aurait dû être rejetée car elle n’a pas été introduite
dans le délai requis.
2. Selon
l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie que dans un
délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
Cependant, le point de départ de ce délai n’est pas toujours apparent. Il se
peut qu’il ne soit pas matérialisé par une décision ou qu’il soit peu distinct
pour une autre raison. Pour certaines situations continues dans lesquelles des
droits issus de la Convention sont violés, il peut être particulièrement
difficile de définir quand le délai a commencé à courir. Notre jurisprudence
fournit des indications sur la façon d’aborder ce type d’affaires. Dans l’affaire
Varnava et autres c. Turquie ([GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90,
16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, §§ 159 et 161, CEDH 2009), la Cour a
déclaré en termes généraux que le délai ne s’appliquait pas aux situations
continues. Ce n’est pas tout à fait exact puisque, comme l’explique ensuite l’arrêt,
en pareil cas la violation continue signifie simplement que le délai recommence
en fait à courir chaque jour, de sorte que le délai s’applique bien en
principe. À la cessation de la situation continue, le délai commence à courir
sans interruption pendant la période de six mois. La difficulté, dans certaines
affaires, tient à la détermination du moment exact où la situation est arrivée
à son terme. Comme il a été souligné dans l’affaire Varnava (précitée, § 161), toutes les situations continues ne sont
pas identiques : en fonction de leur nature, les enjeux peuvent changer au fil
du temps. Il peut donc être nécessaire d’examiner comment une situation a
évolué afin d’apprécier la signification des événements ou les perspectives de
parvenir à une solution et de juger ce qui serait raisonnable de prendre comme
point de départ dans les circonstances particulières de l’espèce. La Cour peut
adopter un point de vue général et pratique quant à de telles questions.
3. La
majorité est d’avis que la présente affaire porte sur une situation continue de
durée illimitée, coïncidant avec l’existence de la loi no 40 du
19 février 2004, entrée en vigueur le 10 mars 2004. À mon avis, la
requérante n’était pas en droit d’attendre indéfiniment avant de demander
réparation.
4. Les
faits, très sommairement présentés par la requérante, sont les suivants. Quelque
part en 2002, cinq embryons, obtenus dans le cadre d’un processus de
fécondation in vitro par la
requérante et son partenaire, furent placés en cryoconservation aux fins d’une
implantation future. Avant la fin de l’année suivante, le partenaire de la
requérante fut tué en Irak où il réalisait un reportage de guerre. Par la
suite, à une date non précisée, la requérante décida de ne pas implanter les
embryons. Elle formula alors oralement, en vain, plusieurs demandes de mise à
disposition de ses embryons en vue d’une utilisation par la recherche
scientifique. Le nombre de demandes et les périodes où elles ont été présentées
n’ont pas été précisés. On peut supposer qu’elles sont toutes intervenues après
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, puisqu’auparavant il n’y aurait pas eu
d’obstacles à donner les embryons, pour quelque objectif que ce soit. De plus,
nul n’a expliqué pourquoi la requérante n’a pas porté l’affaire plus tôt devant
la juridiction de Strasbourg, c’est-à-dire peu après l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi, au lieu d’attendre plus de sept ans avant de le faire.
5. Il
doit avoir été clair pour la requérante que ses demandes ne pouvaient pas être
accordées au titre de la nouvelle loi. Celle-ci, en ses passages pertinents, se
lit ainsi :
Article 13 – Expérimentation sur l’embryon humain
« 1. Toute
expérimentation sur l’embryon humain est interdite.
2. La recherche clinique et expérimentale sur l’embryon humain
ne peut être autorisée que si elle poursuit exclusivement des finalités
thérapeutiques et diagnostiques tendant à la protection de la santé ainsi qu’au
développement de l’embryon et s’il n’existe pas d’autres méthodes. »
6. Aux termes de l’article 13 § 5 de cette
loi, toute violation de cette interdiction est passible de sanctions sévères, y
compris d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans.
7. Il y a bien sûr des exemples dans
lesquels les dispositions législatives donnent bien lieu à une ingérence
continue dans l’exercice de droits issus de la Convention au titre soit de l’article
8 soit de l’article 14 combiné avec l’article 8, ingérence dont les effets ne
peuvent s’atténuer ou cesser au fil du temps à moins d’en supprimer la
cause. La majorité cite les affaires Dudgeon
c. Royaume-Uni (22 octobre 1981, § 41, série A no 45), Norris c. Irlande
(26 octobre 1988, § 38, série A no 142), Vallianatos et
autres c. Grèce ([GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 54, CEDH 2013 (extraits)) et S.A.S. c. France [GC], no
43835/11, § 110, CEDH 2014 (extraits)), et ce ne sont pas les seules affaires
sur le sujet. La majorité reconnaît que dans ces affaires l’impact des mesures
législatives incriminées sur la vie quotidienne des requérants « était
plus important et plus direct qu’en l’espèce ». Toutefois, elle n’attache
aucune importance à une différence que, pour ma part, je considère comme
cruciale. Dans ces affaires, les dispositions législatives litigieuses avaient,
d’une manière ou d’une autre, un impact pratique majeur sur le quotidien des
requérants, avec des effets décisifs et lourds de conséquences sur leur
conduite et l’organisation de leurs affaires. Rien de tel en l’espèce : la
majorité se contente de reconnaître l’existence d’un « lien biologique
existant entre l’intéressée et ses embryons ainsi que de l’objectif de
réalisation d’un projet familial à l’origine de leur création »
(paragraphe 111 de l’arrêt), bien que, en ce qui concerne la deuxième
proposition, le projet de fonder une famille en ayant recours aux embryons ait
été abandonné à une phase précoce et ne fût plus d’actualité en l’espèce. Elle
conclut que l’interdiction en question « a une incidence sur la vie privée
de la requérante » (ibidem).
8. Dans
la décision sur la recevabilité sur le délai de six mois, la majorité ne va pas
au-delà que ce que j’ai déjà rapporté. La recevabilité est admise sur la base
du point de vue, que je ne partage pas, que la nouvelle loi a un impact
incessant sur la vie de la requérante. Par la suite, toutefois, dans la partie
de l’arrêt sur le fond, la majorité explique ce qu’elle voit comme la nature
particulière de cet impact, et donc qui expliquerait sa force. Les paragraphes
158 et 159 de l’arrêt se lisent ainsi :
« 158. En
l’espèce, la Cour doit aussi avoir égard au lien existant entre la personne qui
a eu recours à une fécondation in vitro
et les embryons ainsi conçus, et qui tient au fait que ceux-ci renferment le
patrimoine génétique de la personne en question et représentent à ce titre une
partie constitutive de celle-ci et de son identité biologique.
159. La
Cour en conclut que la possibilité pour la requérante d’exercer un choix
conscient et réfléchi quant au sort à réserver à ses embryons touche un aspect
intime de sa vie personnelle et relève à ce titre de son droit à l’autodétermination.
L’article 8 de la Convention, sous l’angle du droit au respect de la vie
privée, trouve donc à s’appliquer en l’espèce. »
9. Ma
position est très éloignée de celle de la majorité selon laquelle la question
en jeu tient au droit à l’autodétermination de la requérante. En fait, avec
tout le respect que je dois à la majorité, il me semble que par la suite,
celle-ci prend également ses distances par rapport à cette position initiale.
Il est intéressant de noter à cet égard que, lorsqu’elle examine les
circonstances spécifiques de la présente affaire, la majorité déclare, au
paragraphe 174 de l’arrêt que :
« (...)
la présente espèce ne concerne pas un projet parental (...). Dans ces
conditions, s’il n’est assurément pas dénué d’importance, le droit de donner
des embryons à la recherche scientifique invoqué par la requérante ne fait pas
partie du noyau dur des droits protégés par l’article 8 de la Convention en ce
qu’il ne porte pas sur un aspect particulièrement important de l’existence et
de l’identité de l’intéressée. »
10. J’en
suis tout à fait d’accord. Un peu plus loin, au paragraphe 192, la majorité
observe que :
« (...)
si le droit invoqué par la requérante de décider du sort de ses embryons est
lié à son désir de contribuer à la recherche scientifique, il n’y a toutefois
pas lieu d’y voir une circonstance affectant directement l’intéressée. »
11. Encore
une fois, je suis bien d’accord. Contrairement aux affaires pertinentes
susmentionnées, où l’on a souligné que les requérants avaient été directement
touchés par la législation litigieuse, en l’espèce la requérante n’était pas
directement concernée. Ce qu’elle envisageait de faire – à savoir faire don de
ses embryons à la recherche – n’a pas affecté directement sa vie privée. Je ne
comprends pas pourquoi la majorité, lorsqu’elle examine les arguments de la
requérante à la lumière des divers aspects de la nouvelle loi, ne pouvait pas
conclure dès la départ, ainsi qu’elle le fait au paragraphe 195, que, quelles
que soient les incohérences figurant ou non dans la nouvelle législation, elles
« (...)
ne sont pas de nature à affecter directement le droit qu’elle invoque en l’espèce. »
12. Cette
conclusion est dans la droite ligne de ce que j’ai déjà présenté comme une
différence déterminante entre la présente espèce et les affaires Dudgeon, Norris, Vallianatos et S.A.S. précitées.
13. Mon
opinion selon laquelle la requête aurait dû être déclarée irrecevable pour
non-respect du délai requis se fonde sur la nature très ténue, à mon sens, du
lien entre la requérante et les embryons congelés. S’il existe bien un lien
significatif puisque les embryons sont issus du matériel génétique de la
requérante et de son partenaire, et qu’en conséquence de ce lien la question
relève du champ de l’article 8, il me semble que ce n’est qu’à la périphérie,
et que cela ne tient qu’à la possibilité, pour la requérante, d’exprimer un
souhait concernant le sort de ces embryons. À la réception d’une réponse
négative, étant donné qu’il n’y avait pas de recours interne adéquat à épuiser,
le délai de prescription aurait dû alors commencer à courir aux fins de
soumettre la restriction législative en question à un examen au titre de la
Convention.
14. Eu
égard au point de vue décrit ci-dessus, on ne saurait dire que cet aspect de l’article
8 donne à la requérante un droit pendant une période indéfinie. La nouvelle loi
est entrée en vigueur quatre mois environ après le drame qui a changé sa vie
et, si le délai de six mois est ajouté à cela, on serait tenté de croire qu’elle
disposait d’assez de temps pour décider si elle souhaitait avoir son mot à dire
dans cette affaire. Il est également possible, cependant, d’aborder la question
de manière plus large et, sur la base d’une situation continue créée par la
nouvelle loi, d’examiner ce qui pouvait être un cadre temporel raisonnable
permettant à une personne dans la situation de la requérante, dans les tristes
circonstances dans lesquelles elle s’est trouvée, de suffisamment réfléchir et
agir. Ce que je ne peux certainement pas admettre, c’est l’idée que la
requérante n’était soumise à aucune limite temporelle pour mettre en branle le
dispositif strasbourgeois de protection des droits de l’homme.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE
SAJÓ
(Traduction)
À mon grand
regret, je ne peux souscrire aux points de vue exprimés par la majorité. Je me
vois donc dans l’obligation de m’en écarter, pour les raisons exposées ci-dessous.
Applicabilité
de l’article 8 de la Convention en l’espèce
1. En
l’espèce, la Cour conclut que « que la possibilité pour la requérante d’exercer
un choix conscient et réfléchi quant au sort à réserver à ses embryons touche
un aspect intime de sa vie personnelle et relève à ce titre de son droit à l’autodétermination «
(paragraphe 159 de l’arrêt). Je ne peux que souscrire à cette conclusion, sauf
à ajouter que cela non seulement « relève » du droit de l’intéressée
à l’autodétermination mais qu’il s’agit là de l’exercice de ce droit, qui se
trouve au cœur du droit à la vie privée. Le droit de la requérante à l’autodétermination
reflète son droit à l’autonomie personnelle et à sa liberté de choix (S.H. et autres c. Autriche [GC], no 57813/00,
§ 80, CEDH 2011 ; McDonald c.
Royaume-Uni, no 4241/12, §§ 46-47, 20 mai 2014 ; et Pretty c. Royaume-Uni, no
2346/02, § 61, CEDH 2002‑III). Ici, le choix (un droit) de la
requérante était de donner ses embryons pour faire avancer la science en vue de
sauver des vies plutôt que de laisser leur viabilité s’éteindre avec le temps[43]. La nature
du droit en jeu en l’espèce est la liberté de choix de la requérante. Il ne s’agit
pas d’une affaire touchant aux droits de la parentalité ni même aux droits éventuels
d’un fœtus ; le droit de la requérante dont il est ici question est celui
d’agir comme un individu libre et autonome en ce qui concerne son empreinte
génétique.
2. Selon
la jurisprudence de la Cour, « il n’incombe pas à la Cour d’examiner in abstracto la législation et la
pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché le
requérant a enfreint la Convention » (N.C.
c. Italie [GC], no 24952/94, § 56, CEDH 2002‑X). Il ne s’agit
pas ici d’examiner l’utilisation des embryons par la recherche telle que
réglementée par le droit italien, mais de considérer la manière dont la mesure
générale a affecté des embryons qui avaient été créés et cryoconservés avant
que la restriction n’entre en vigueur. Cette affaire porte sur une situation
très spécifique : que passe-t-il lorsqu’une législation intervient et entrave l’exercice
de ce droit préexistant concernant des embryons préexistants ? L’embryon peut
potentiellement devenir un être humain, mais cela reste une simple potentialité
puisque cette évolution ne peut se produire sans le consentement du ou des
donneurs, comme il en a été discuté dans l’affaire Evans c. Royaume-Uni ([GC], no 6339/05, CEDH 2007‑I).
La
requérante a décidé de ne pas donner son consentement. Certainement, une loi qui
exigerait de la requérante d’utiliser les embryons elle-même contreviendrait à
son droit à décider de devenir ou non parent. De même, une loi qui l’obligerait
à autoriser « l’adoption » de ses embryons par un tiers violerait son droit
fondamental à ne pas être contrainte à la parentalité[44]. Le droit
italien ne laisse donc qu’une option : la cryoconservation pour une
période illimitée des embryons non implantés[45].
3. Pour
moi, le « droit de choisir » de la requérante (en tant qu’aspect
relevant de l’autodétermination) ne représente pas « un aspect
particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’une
personne ». Si le point mérite débat, j’admets qu’il n’existe pas de
consensus européen[46] concernant
le sort des embryons cryoconservés et je ne discuterai pas de la question de
savoir si l’expérience de sept ou quatre pays est suffisante pour tirer cette
conclusion (bien que les données comparatives fournies par la Cour ne reflètent
pas la pratique des pays en ce qui concerne les embryons qui ont été créés à
des fins reproductrices avant l’imposition d’une interdiction sur la recherche,
et que seuls quelques pays interdisent toute recherche sur les cellules souches
embryonnaires). Il s’ensuit que l’État dispose d’une ample marge d’appréciation
s’agissant de restreindre ce droit.
Sur le
point de savoir s’il y a eu une « ingérence » « prévue par la
loi »
4. La
Cour reconnaît qu’il y a eu une ingérence dans le droit de la requérante au
respect de la vie privée au titre de l’article 8. Toutefois, il importe de
souligner qu’au moment où la requérante a choisi la voie de la fécondation in vitro, il n’y avait pas de loi en
vigueur en Italie concernant le sort à réserver aux embryons surnuméraires.
Ainsi que la Grande Chambre l’a déjà dit, l’expression « prévue par la
loi » implique que « la législation interne doit user de termes assez
clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et
sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à des
mesures affectant leurs droits protégés par la Convention » (Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 117, CEDH 2014
(extraits)). La requérante était face à une situation dans laquelle elle n’avait
pas de choix réel à part celui d’accepter que l’État conserve ses embryons en
les congelant pour une durée indéterminée. Cela n’était pas prévisible lorsqu’elle
a choisi de subir une FIV. Elle n’avait aucune possibilité de savoir qu’elle
aurait seulement quatre mois après le décès de son partenaire pour décider ce
qu’il fallait faire des embryons, avant que la nouvelle législation ne lui
enlève le contrôle de cette décision. Il importe de relever que la loi ne
contient pas de règles spécifiques quant au sort des embryons qui étaient déjà
cryoconservés avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Légitimité
du but poursuivi
5. En
l’espèce, le Gouvernement n’a pas donné de raison claire justifiant l’ingérence.
Ces buts ont été reconstitués (non sans effort) par la Cour, puis admis par
elle. En l’absence de toute justification par le Gouvernement du but de l’ingérence,
la majorité en propose deux : la protection de la morale et la protection des
droits d’autrui. Quant à la protection de la morale, la Cour ne donne aucune
information sur la morale publique en Italie, où la pratique litigieuse est
légale depuis de nombreuses années[47]. Le
Gouvernement n’a pas invoqué la protection de la morale et la Cour n’explique
pas où l’intérêt moral se trouve ; elle ne prend pas davantage en compte un
intérêt moral spécifique dans l’analyse sur la proportionnalité.
6. En
ce qui concerne les droits d’autrui, « [l]a Cour admet que la
« protection de la potentialité de vie dont l’embryon est porteur »
peut être rattachée au but de protection de la morale et des droits et libertés
d’autrui » (paragraphe 167 de l’arrêt)[48]. Mais qui
est « autrui » ? L’embryon est-il « autrui », c’est-à-dire
une personne ? Il n’y a pas de réponse, sauf que l’embryon est décrit dans
la loi de 2004 comme un « sujet » ayant des droits. Le fait qu’il ne
tombe pas dans la catégorie des biens ne fait pas de l’embryon un être humain
ou un titulaire de droits[49]. Le fait
que l’État ait intérêt à protéger une vie potentielle ne saurait se mesurer au
droit d’une personne.
7. La
Cour estime que les droits d’autrui sont présents parce que « la potentialité
de vie » peut être liée à ce droit allégué. J’espère me tromper, mais je
crains qu’il n’y ait ici un risque de distendre la norme applicable à la liste
des buts admissibles pour une restriction des droits. Jusqu’ici, la Cour a constamment
affirmé que la liste d’exceptions aux droits individuels reconnus par la
Convention était exhaustive et que leur définition était restrictive (voir,
parmi d’autres, Sviato-Mykhaïlivska
Parafiya c. Ukraine, no 77703/01, § 132, 14 juin 2007; et Nolan et K. c. Russie, no
2512/04, § 73, 12 février 2009). Cela est essentiel à toute protection sérieuse
de droits. Malheureusement, dans l’affaire S.A.S.
c. France ([GC], no 43835/11, § 113, CEDH 2014
(extraits)), la Cour a dit que « [p]our être compatible avec la
Convention, une restriction à cette liberté doit notamment être inspirée par un
but susceptible d’être rattaché à l’un de ceux que cette disposition énumère.
La même approche s’impose sur le terrain de l’article 8 de la
Convention ». D’une position selon laquelle le but « est susceptible
d’être rattaché » à ces exceptions énumérées de manière exhaustive, nous
passons à présent à un point de vue selon lequel un lien peut exister si cela n’est
pas exclu comme étant abusivement spéculatif (« peut être susceptible »
au lieu de « est susceptible »).
Le fait de
ne pas examiner sérieusement un but supposé d’un État saperait le potentiel de
protection des droits de toute analyse de proportionnalité. L’examen de la
finalité d’une mesure relève du rôle de supervision de la Cour (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre
1976, § 49, série A no 24). Si nous souhaitons appliquer la
doctrine de la marge d’appréciation, nous pourrions dire qu’en matière de
politique économique il y a peu de place pour une telle analyse, eu égard à l’avantage
cognitif dont bénéficient la législation nationale ou les autorités nationales,
ou considérant que « [g]râce à une connaissance directe de leur société et
de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées
que le juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité
publique » (James et autres c.
Royaume-Uni, 21 février 1986, § 46, série A no 98). Ce
raisonnement ne peut pas être appliqué sans raisons additionnelles et
convaincantes à des domaines où la question n’est pas d’« utilité
publique » en matière de politiques économiques et sociales mais tient à
la morale, la politique de santé ou la science[50].
8. L’arrêt
accepte sans autre réflexion la force de l’intérêt de l’État à interdire toutes
les utilisations des embryons issus des FIV, sauf l’implantation. Toutefois,
dans l’affaire S.A.S., la Cour a
relevé que « [l]a pratique de la Cour est d’être plutôt succincte lorsqu’elle
vérifie l’existence d’un but légitime, au sens des seconds paragraphes des
articles 8 à 11 de la Convention » (ibidem).
Cependant, la Grande Chambre a ensuite expliqué dans la même affaire que,
particulièrement lorsque les objectifs du Gouvernement sont controversés (comme
dans le contexte de la présente affaire, voir les paragraphes 135-137 de l’arrêt),
la Cour se livre à un examen approfondi du lien entre la mesure et l’objectif.
En l’espèce, ce lien a été tenu pour acquis sans autre demande ou justification
adressée au Gouvernement.
Nécessaire,
dans une société démocratique
9. La
Cour a affirmé que, même lorsqu’il existe une ample marge d’appréciation au
titre de l’article 8, le Gouvernement doit toujours présenter des « motifs
pertinents et suffisants » pour justifier l’ingérence (Zaieţ c. Roumanie, no
44958/05, § 50, 24 mars
2015 ; Hanzelkovi c
République tchèque, no
43643/10, § 72, 11 décembre 2014 ; Winterstein et autres c.
France, no 27013/07, §§ 75-76, 17 octobre 2013 ; et S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et
30566/04, § 101, CEDH 2008)[51]. S’agissant
de mesures générales portant atteinte à un droit au titre de l’article 8, la
Cour a formulé les considérations suivantes : « Premièrement, [la
Cour] peut apprécier le contenu matériel de la décision du gouvernement, en vue
de s’assurer qu’elle est compatible avec l’article 8. Deuxièmement, elle
peut se pencher sur le processus décisionnel, afin de vérifier si les intérêts
de l’individu ont été dûment pris en compte » (Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 99, CEDH 2003‑VIII).
10. Une
mesure d’ingérence qui sert le but susmentionné est une mesure générale. Selon
la Cour, « pour déterminer la proportionnalité d’une mesure générale, la
Cour doit commencer par étudier les choix législatifs à l’origine de la mesure
(James et autres, précité, § 36). La
qualité de l’examen parlementaire et judiciaire de la nécessité de la mesure
réalisé au niveau national revêt une importance particulière à cet égard, y
compris pour ce qui est de l’application de la marge d’appréciation pertinente
(Animal Defenders International c.
Royaume-Uni [GC], no 48876/08,
§ 108, CEDH 2013 (extraits)).
11. Il
ressort de l’histoire législative de la loi de 2004 que, pendant des décennies,
la question n’a pas été réglementée en Italie en raison de divergences de vues
persistantes au sein de la société et parmi les professionnels. Les divisions
ont continué pendant des années de débats parlementaires. Les opposants au
projet d’interdiction[52]
soutenaient qu’il reflétait une conviction idéologique spécifique, tandis que
ses partisans estimaient qu’il servait la protection de la vie et de la
famille, et constituait une solution conforme au droit naturel, et non aux
diktats de la religion catholique. Les divisions se sont poursuivies jusqu’au
débat final[53].
12. Le
Gouvernement n’a fourni aucun élément démontrant qu’il y ait eu une discussion
parlementaire approfondie sur le sort des embryons déjà cryoconservés au moment
de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi[54]. De plus,
la loi a été adoptée à la majorité, dans un climat très polémique[55]. Le débat
parlementaire italien a donc été différent de celui examiné dans l’affaire Animal Defenders International précitée,
dans laquelle, notamment, il y avait un soutien transversal de tous les partis
représentés au Parlement. Par ailleurs, rien ne prouve que les droits ou la
situation personnelle de la requérante aient été pris en compte ; la loi
comporte une interdiction globale qui prive la requérante de son droit à la
liberté de choix. Contrairement à la situation dans l’affaire Animal Defenders International, précitée,
il ne pouvait pas y avoir d’analyse de proportionnalité interne dans son
affaire. Non seulement cette interdiction générale ignore le droit à l’autodétermination
de la requérante concernant une décision privée importante, mais elle le fait
de manière absolue et imprévisible. La loi ne contient aucune règle transitoire
qui aurait pu permettre à l’autorité compétente de prendre en considération la
situation spécifique de la requérante, dont les embryons obtenus à partir d’une
FIV ont été placés en cryoconservation en 2002 et dont le mari est décédé en
2003, trois mois avant l’entrée en vigueur de la loi.
13. Contrairement
à l’intérêt moral clairement exprimé par la requérante, et au fort intérêt
social dans la recherche scientifique en jeu, qui a prêté un poids considérable
au droit par ailleurs pas « particulièrement important » de la requérante,
la majorité observe simplement que le législateur italien s’est livré à un
examen approfondi de cette question avant d’élaborer la loi de 2004 (paragraphe
184). Comme mentionné ci-dessus, les conditions requises à cet égard dégagées
dans les affaires Hatton et autres et
Animal Defenders International
(précité) ne sont pas remplies. En l’absence de raison claire ressortant du
débat parlementaire, ce n’est que lorsque le gouvernement offre des
explications suffisamment précises que la Cour peut examiner de manière
adéquate pourquoi l’interdiction globale sur les dons était nécessaire lorsqu’on
la met en balance avec le choix personnel de la requérante. Le passage des
travaux préparatoires cité par la Cour n’explique pas pourquoi il est
indispensable d’interdire les dons pour respecter la préférence morale supposée
des Italiens pour les embryons dans les circonstances de l’espèce. Étant donné
que le Gouvernement ne peut contraindre une personne à utiliser ses embryons
pour créer un être humain sans son consentement, une interdiction globale de
toutes les autres utilisations visant à promouvoir la vie (telles que la
recherche médicale) non seulement constitue une restriction excessive au droit
individuel à l’autodétermination, mais elle ignore également les valeurs
consacrées par l’article 33 de la Constitution italienne[56] ainsi que
le système de valeurs de la Convention, qui reconnaît l’intérêt de l’article 10
dans la recherche scientifique (Mustafa
Erdoğan et autres c. Turquie, nos 346/04 et 39779/04, §§ 40-41, 27 mai 2014). Plus important, la protection de la vie
ne peut pas être invoquée, non seulement parce que la signification et le poids
de cet argument demeurent contestés en ce qui concerne les embryons de la
requérante mais également parce que ces embryons, malgré leur potentialité de
vie, n’ont aucune chance de devenir des êtres humains. Quant aux embryons en
général en Italie, le devoir de protéger le potentiel d’un embryon non viable
ne peut exister de manière absolue en droit italien étant donné que même un
fœtus viable peut faire l’objet d’un avortement[57].
14. La requérante en l’espèce était face à un choix impossible
et imprévisible. Au mieux, les choix qui lui étaient ouverts étaient d’utiliser
les embryons elle-même, de laisser un autre couple les utiliser, ou de laisser
son matériel génétique dépérir indéfiniment jusqu’au moment (inconnu et
impossible à connaître) où les embryons ne seront plus viables ou seront
susceptibles d’être utilisés à des fins de procréation, contrairement à son
souhait clairement exprimé.
15. Vu l’âge de la requérante, il ne lui serait pas possible d’utiliser
les cinq embryons elle-même. De plus, selon un témoignage d’expert présenté à l’audience
devant la Cour et non contesté par le Gouvernement, ses embryons ne pourraient
pas, en pratique, être utilisés par un autre couple en raison de leur âge et
parce qu’ils n’ont pas été soumis à des tests adéquats au moment de leur création.
Dès lors, en réalité, ces embryons ne seront pas utilisés pour créer une vie
humaine car ils ne seront jamais implantés dans un utérus[58]. Cette réalité médicale n’est pas contestée par le Gouvernement.
16. Plus important, la requérante a fait clairement le choix
de ne pas autoriser l’utilisation de ses embryons à des fins de procréation.
17. L’intérêt de la requérante à donner ses embryons à la
recherche scientifique, plutôt que de les laisser sans utilisation, est une
décision profondément personnelle et morale. Ce choix se fonde sur le souhait d’honorer
la mémoire de son partenaire décédé et de soutenir une recherche médicale
précieuse pouvant potentiellement sauver des vies[59]. Selon le témoignage d’expert présenté à l’audience (et beaucoup d’autres
sources internationales médicales et scientifiques), les recherches provenant
des cellules souches des embryons sont actuellement utilisées dans le cadre d’essais
cliniques pour les blessures médullaires, la maladie de Parkinson et d’autres
maladies qui sont actuellement incurables ou difficiles à soigner. Les pays qui
autorisent de telles recherches ont développé des formes sophistiquées de
consentement éclairé pour assurer que les embryons sont utilisés de manière
éthique[60]. Pareilles recherches utilisent les cellules pluripotentes
(indifférenciées) créées dans le cadre des procédures de FIV pour mieux
comprendre le développement humain et découvrir de nouvelles modalités de
traitement de maladies qui sont dévastatrices et incurables pour de nombreuses
personnes dans le monde entier[61]. Les cellules créées dans le cadre de procédures de FIV constituent un
matériel biologique unique et précieux, que la requérante souhaitait mettre à
disposition pour qu’il soit utilisé plutôt que de le voir perdre sa viabilité
en demeurant congelé indéfiniment.
18. Que le souhait du Gouvernement de protéger la potentialité
de vie des embryons pèse ou non plus lourd que l’intérêt de la requérante à
utiliser son propre matériel génétique pour contribuer à la science qui sauve
des vies est une question qui ne peut être écartée sans réflexion. Le présent
arrêt est dénué de toute analyse sur la proportionnalité, et ne prend pas en
compte l’intérêt important des tiers à profiter des bénéfices en matière de
santé découlant des découvertes scientifiques. En disant simplement qu’il n’existe
pas de consensus européen sur la question de savoir si les embryons
surnuméraires produits dans le cadre de FIV peuvent être utilisés par la
recherche scientifique, la Cour s’écarte des normes bien établies dans sa
jurisprudence. Bien entendu, il existe une marge d’appréciation quant à cette
question, mais cela ne signifie pas que la loi peut intervenir selon toute
modalité que le Gouvernement estime adéquate. La mesure doit toujours être
proportionnée à l’ingérence dans les droits du requérant.
19. Afin que l’ingérence soit proportionnée, le Gouvernement
doit fournir des motifs légitimes (pertinents et suffisants). À supposer même,
eu égard à l’arrêt en l’affaire Evans
(précité, § 81) qu’il existe une ample marge d’appréciation dans les cas de FIV
« dès lors que le recours au traitement par FIV suscite de délicates
interrogations d’ordre moral et éthique, qui s’inscrivent dans un contexte d’évolution
rapide de la science et de la médecine »[62], il reste que l’ingérence ne peut pas être arbitraire. En Italie, tant l’avortement
que la recherche sur les lignées de cellules souches étrangères sont autorisés.
La loi ignore l’intérêt à prévenir la souffrance humaine réelle par la
recherche scientifique au nom de la protection d’une potentialité de
vie, qui, de plus, ne pourra jamais se matérialiser dans les circonstances de l’espèce.
Je ne vois pas pourquoi on attache une importance prépondérante à une
potentialité de vie alors que le droit italien autorise bien l’avortement d’un
fœtus viable et que, dans les circonstances particulières de l’espèce, cette
potentialité ne peut pas se matérialiser en l’absence du consentement de la
requérante. Cette attitude et l’explication y relative sont non seulement
incohérentes, mais tout simplement – irrationnelles et, en soi, ne sauraient
représenter une justification suffisante pour la proportionnalité de la mesure.
[1]. Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République Tchèque, Estonie, Finlande,
France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Liechtenstein,
Lituanie, Luxembourg, « ex-République
yougoslave de Macédoine », Malte, République de
Moldova, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie,
Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie,
Royaume-Uni et Ukraine.
[2]. Bulgarie,
République Tchèque, Estonie, Finlande, « ex-République yougoslave de Macédoine », France,
Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Slovénie, Espagne et Suisse.
[3] Cellules
embryonnaires non encore différenciées et dont chacune, isolée, est capable de
se développer en un organisme entier (Larousse dictionnaire médical).
[4]. À mon
avis, le non-épuisement des voies de recours internes est la seule question
problématique, mais cette objection a été écartée comme il se devait au vu de
la position expresse de la Cour constitutionnelle italienne, laquelle a ajourné
l’examen d’une affaire qui soulevait la même question juridique, dans l’attente
de la décision de la Grande Chambre en l’espèce (paragraphe 53 de l’arrêt).
[5]. Résolution
29 C/17 de la Conférence générale de l’UNESCO, UNESCO GC, 29e session
(11 novembre 1997), adoptée à l’unanimité et par acclamation. Voir aussi les
Orientations pour la mise en œuvre de la Déclaration universelle sur le génome
humain et les droits de l’homme, annexées à la Résolution 30 C/23 (16 novembre
1999). Ces résolutions avaient déjà été anticipées par la Déclaration de
l’Association médicale mondiale sur les principes éthiques applicables à la
recherche médicale impliquant des êtres humains, évoquée ci-dessous dans la
présente opinion.
[6]. Résolution
de l’Assemblée générale des Nations unies A/RES/53/152, 9 décembre 1998,
adoptée sans vote.
[7]. Le
Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) est
une organisation internationale non gouvernementale et à but non lucratif
établie conjointement par l’OMS et l’UNESCO en 1949. Comme celles de 1982 et de
1993, les Lignes directrices du CIOMS de 2002 visent à aider les États à
définir leurs politiques nationales en matière d’éthique de la recherche
biomédicale impliquant des sujets humains.
[8]. Voir
aussi la publication de l’OMS « Standards and Operational Guidance for
Ethics Review of Health-related Research with Human Participants », 2011. En 2003, l’OMS
avait déjà adopté la Guideline for
Obtaining Informed Consent for the Procurement and Use of Human Tissues, Cells
and Fluids in Research, qui vise à aider les chercheurs à gérer les
questions éthiques liées aux modes d’obtention, d’utilisation et enfin
d’élimination du matériel de
recherche clinique, ainsi que la question du consentement éclairé. Cette
recommandation s’applique aussi au matériel biologique humain auparavant
recueilli et conservé dans un dépôt. Elle
indique que le versement d’une somme d’argent ou toute autre incitation à
donner du tissu embryonnaire est
expressément prohibée.
[9]. Résolution
32 C/15 de la Conférence générale de l’UNESCO, UNESCO GC, 32e session
(2003).
[10]. Résolution
280 de l’Assemblée générale des Nations unies, cinquante-neuvième session (23
mars 2005), ONU, document A/RES/59/280.
La déclaration a été adoptée à l’issue d’un vote où 84 États se sont
prononcés pour, 34 pays contre, et 37 pays se sont abstenus.
[11]. Conférence
générale de l’UNESCO, 33e session (2005).
[12]. Comité international de bioéthique de l’UNESCO,
« L’utilisation des cellules
souches embryonnaires pour la recherche thérapeutique : rapport du CIB sur
les aspects éthiques des recherches sur les cellules embryonnaires »,
BIO-7/00/GT-1/2(Rev.3), 6 avril 2001. Créé en 1993, le CIB se compose de 36
experts indépendants qui suivent les avancées dans les sciences de la vie.
[13]. Comité
international de bioéthique de l’UNESCO, Rapport du CIB sur le diagnostic génétique pré-implantatoire et les
interventions sur la lignée germinale, SHS-EST/02/CIB-9/2(Rev.3), 24 avril 2003.
[14]. Comité
international de bioéthique de l’UNESCO, Rapport du CIB sur le clonage humain et la gouvernance internationale,
SHS/EST/CIB-16/09/CONF.503/2 Rev.2, juin 2009.
[15]. Comité
international de bioéthique de l’UNESCO, Avis du CIB sur la brevetabilité du génome humain, huitième
session de l’UNESCO (CIB), Paris, 12-14 septembre 2001.
[16]. Résolution
no 23/81, OEA/Ser. L/V/II.54, doc.9 rev.1. § 18 b)
(6 mars 1981).
[17]. Affaire
« Baby Boy » c. États-Unis,
CIDH 2141/1981, 6 mars 1981.
[18]. CIDH,
Affaire Artavia Murillo et autres
(fécondation in vitro) c. Costa Rica.
Exceptions préliminaires, fond, réparation et frais, arrêt du 28 novembre
2012, série C no 257,
§§ 315-317.
[19]. Draft African Charter on Human and
Peoples’ Rights, art. 17,
OUA. doc. CAB/LEG/67/1
(1979).
[20]. Résolution
de l’Organisation de l’unité africaine AHG/Res.254 (XXXII).
[21]. Le
Commentary of the Charter, établi par
le Réseau UE d’experts indépendants en
matière de droits fondamentaux, explique que l’article 3 (paragraphe 2)
a été rédigé dans le but de limiter certaines pratiques en matière de médecine
et de biologie. Il indique par ailleurs que les quatre principes qui s’y
trouvent consacrés ne sont pas exhaustifs et doivent être lus dans le sens des
dispositions de la Convention d’Oviedo.
[22]. Voir aussi les
règles de l’Union européenne sur le financement en matière de recherche et de
développement technologique, évoquées aux paragraphes 62 à 64 de l’arrêt. Il
est d’usage d’exclure les projets qui prévoient des activités de recherche
impliquant la destruction d’embryons humains, notamment pour l’obtention de cellules souches.
[23]. Avis du GEE no
12, Les aspects éthiques de la recherche impliquant l’utilisation d’embryons
humains dans le contexte du 5e programme-cadre de recherche, 23 novembre 1998.
Le GEE est un organe indépendant qui conseille la Commission européenne sur les
questions éthiques dans la science et les nouvelles technologies, dans le
contexte de la législation et de la politique.
[24]. Avis
du GEE no 15, Les aspects éthiques de la recherche sur les cellules
souches humaines et leur utilisation, 14 novembre 2000.
[25]. Avis
du GEE no 16, Les aspects éthiques de la brevetabilité des
inventions impliquant des cellules souches humaines, 7 mai 2002.
[26]. Avis
du GEE no 22, Recommendations
on the ethical review of hESC FP7 research projects, 20 juin 2007.
[27]. Le
point de départ de l’Assemblée était que « dès la fécondation de l’ovule,
la vie humaine se développe de manière continue, si bien que l’on ne peut faire
de distinction au cours des premières phases (embryonnaires) de son
développement ». Dans sa Recommandation 874 (1979) sur une Charte
européenne des droits de l’enfant, l’Assemblée avait déjà affirmé « [l]es
droits de chaque enfant à la vie dès le moment de sa conception ».
[28]. Voir
aussi la Résolution 1934 (2013) sur l’éthique dans la science et la
technologie.
[29]. La
Convention (STE no 164) a été adoptée le 4 avril 1997 à Oviedo, en
Espagne, et est entrée en vigueur le 1er décembre 1999. À ce jour,
elle a été ratifiée par 29 États. Le Protocole additionnel portant interdiction
du clonage d’êtres humains (STE no 168) a été adopté le 12 janvier
1998 et est entré en vigueur le 1er mars 2001. Le Protocole
additionnel relatif à la recherche biomédicale (STE no 195), adopté
le 25 janvier 2005 et entré en vigueur le 1er septembre 2007, couvre
tout l’éventail des activités de recherche en matière de santé impliquant des
interventions sur les êtres humains, y compris sur les fœtus et les embryons in vivo.
[30]. Soulignons
que l’article 14 est l’une des dispositions absolues de la Convention d’Oviedo,
comme il ressort de l’article 26 § 2.
[31]. Voir
les paragraphes 8-20 et 165 du rapport explicatif de la Convention d’Oviedo.
[32]. En
cela, je souscris sans réserve à la conclusion de la Grande Chambre selon
laquelle la Convention d’Oviedo témoigne d’un rétrécissement de la marge d’appréciation
laissée aux États membres du Conseil de l’Europe (paragraphe 182 de l’arrêt).
Dans Evans c. Royaume-Uni ([GC],
no 6339/05, CEDH 2007‑I), affaire qui portait également sur le
sort d’embryons humains congelés, les parties et la Cour s’étaient accordées à
dire que l’article 8 était applicable et que l’affaire concernait le droit
de la requérante au respect de sa vie privée. Dans leur convaincante opinion
dissidente commune, les juges Türmen, Tsatsa-Nikolovska, Spielmann et Ziemele
avaient déclaré : « [u]ne affaire aussi sensible que celle‑ci
ne peut être tranchée sur une base simpliste et mécanique consistant à dire
qu’il n’y a aucun consensus en Europe et que, dès lors, l’État défendeur
bénéficie d’une ample marge d’appréciation, qui s’étend aux règles adoptées
(...) La marge d’appréciation ne doit (...) pas empêcher la Cour d’exercer son
contrôle, en particulier relativement à la question de savoir si un juste
équilibre a été ménagé entre tous les intérêts conflictuels en jeu au niveau
interne. La Cour ne devrait pas utiliser le principe de la marge d’appréciation
comme un simple substitut pragmatique à une approche réfléchie du problème de
la portée adéquate de son contrôle. » Un commentaire identique pourrait
s’appliquer à l’affaire Parrillo.
[33]. Voir
les paragraphes 161 et 162 du rapport explicatif de la Convention d’Oviedo. En
cas de conflit entre la liberté de la recherche et la protection à offrir aux
embryons, les États parties peuvent aller au-delà de l’obligatoire protection
« adéquate » qui est due à ceux-ci et adopter des politiques
prohibitives.
[34]. Rappelons
que la Recommandation 934 (1982) de l’APCE relative à l’ingénierie génétique
avait déjà appelé les États à « prévoir la reconnaissance expresse, dans
la Convention européenne des Droits de l’Homme, du droit à un patrimoine
génétique n’ayant subi aucune manipulation, sauf en application de certains
principes reconnus comme pleinement compatibles avec le respect des droits de
l’homme (par exemple dans le domaine des applications thérapeutiques) ».
En fait, la Convention n’est pas indifférente à la création et à
l’instrumentalisation des embryons aux fins de l’expérimentation scientifique,
à la création d’hybrides ou au clonage d’êtres humains. Ce sont des questions
essentielles relevant de la protection de ce que l’on peut sur le plan
ontologique définir comme une forme de vie humaine, questions qui entrent
assurément dans le champ d’application de la Convention. Je ne vois pas comment
on peut au regard de la Convention accepter une ample marge d’appréciation si une
partie contractante veut, par exemple, mettre en œuvre une politique prénatale
eugénique ou raciste.
[35]. En
fait, la requérante a une position contradictoire, car elle affirme également
avoir un droit de propriété sur ses embryons. Il n’est pas acceptable
d’invoquer à la fois un droit de propriété et un droit au respect de la vie
privée à l’égard d’embryons humains « possédés ». Sauf si cela
implique que le fait d’utiliser des
êtres humains – en l’espèce des embryons humains – et d’en disposer est
une manière de maintenir une relation avec eux.
[36]. Ce
n’est pas une nouvelle déclaration de principe de la Cour, comme le montre
le paragraphe 59 de l’arrêt Costa et Pavan c. Italie. Compte tenu
des circonstances fort exceptionnelles de l’espèce sur le plan humain, j’ai
voté dans le sens des conclusions contenues dans Costa et Pavan et je souscris naturellement au principe énoncé au
paragraphe 59 de cet arrêt. Toutefois, je dois également préciser aujourd’hui
que la deuxième section n’avait pas l’intention de créer un droit nouveau
découlant de la Convention de devenir parent d’un enfant en bonne santé, donc
un « droit » négatif et illimité à l’« autodétermination »
consistant à disposer d’embryons non implantés. Pareil droit n’a été établi ni
explicitement ni implicitement par l’arrêt en question. C’est le principe de
nécessité qui a été déterminant dans l’arrêt, dans la mesure où le critère de
la mesure moins intrusive envisage une atteinte minimale aux intérêts
concurrents en posant la question de savoir s’il existe un moyen aussi efficace
mais moins intrusif de répondre au même besoin social. La Cour a ainsi reconnu
la pertinence du principe de précaution dans l’appréciation des interventions
en milieu médical, qui vise à éviter à tous les stades de la vie humaine les
interventions lourdes au profit de celles qui le sont moins (sur le principe de
précaution dans l’ordre juridique italien, voir l’avis du Comitato Nazionale per la Bioetica intitulé « Principe de
précaution : aspects bioéthiques, philosophiques et juridiques », du
8 juin 2004). Bien que le paragraphe 65 de l’arrêt Costa et Pavan emploie le terme « droit », cette fâcheuse
maladresse de plume ne doit pas être prise littéralement, car le même arrêt
parle également, au paragraphe 57, du « désir » des parents d’avoir
un enfant en bonne santé. Les circonstances propres à l’affaire Costa et Pavan ne sont en rien
semblables à la présente espèce, et ne peuvent assurément pas être utilisées
pour justifier un « droit négatif » et illimité de décider du sort
d’embryons non implantés.
[37]. Voir le raisonnement
clair qui est tenu dans l’arrêt no 27 du 18 février 1975 (Ritiene la Corte che la tutela del concepito
– che già viene in rilievo nel diritto civile (artt. 320, 339, 687
c.c.) – abbia fondamento costituzionale. L’art. 31, secondo comma, della
Costituzione impone espressamente la « protezione della maternità »
e, più in generale, l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari
caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito) et dans
l’arrêt no 35 du 30 janvier 1997 (il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più lata, sia da
iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento
una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per
usare l’espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – « all’essenza
dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana »). Voir
aussi les avis du Comitato Nazionale per
la Bioetica (Comité national italien pour la bioéthique) des 22 juin 1996
(identité et statut de l’embryon humain), 27 octobre 2000 (utilisation
thérapeutique de cellules souches), 11 avril 2003 (recherches utilisant
des embryons et des cellules souches humains), 16 juillet 2004
(utilisation à des fins de recherche de lignées de cellules h1 et h9 issues
d’embryons humains), 15 juillet 2005 (considérations bioéthiques concernant
l’ « ootide »), 18 novembre 2005 (adoption pour la
naissance d’embryons cryoconservés issus de la procréation médicalement
assistée (PMA), 26 octobre 2007 (le sort d’embryons issus de la PMA et ne
répondant pas aux conditions de l’implantation) et 26 juin 2009 (chimères et hybrides, avec une attention
particulière pour les hybrides cytoplasmiques).
[38]. Je
ne puis dès lors souscrire au raisonnement tenu aux paragraphes 176 et 180,
dans lesquels la Cour, tout en évoquant les arrêts Evans, S.H. et autres et Knecht,
conclut que les « questions d’ordre éthique et moral que la notion de
commencement de la vie humaine comporte » appellent une « ample marge
de discrétion ».
[39]. La
même conclusion peut être tirée de S.H.
et autres c. Autriche (GC), no 57813/00, § 82, 3 novembre
2011.
[40]. L’article
16 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite (2001) pourrait ici être invoqué.
[41]. Voir, par exemple, Vo c. France ([GC], n° 53924/00, § 75 et
80, CEDH 2004‑VIII), Evans c.
Royaume-Uni ([GC], n° 6339/05, CEDH 2007‑I), Dickson c. Royaume-Uni ([GC], n° 44362/04, CEDH 2007‑V), Brüggemann et Scheuten c. Allemagne (n°
6959/75, rapport de la Commission du 12 juillet 1977, Décisions et rapports (DR) 10, p. 100), et H. c. Norvège (n° 17004/90, décision de la Commission du
19 mai 1992, DR 73, p. 155).
[42]. Voir,
par exemple, Dickson, précité, Evans, précité, et S.H. et autres c. Autriche ([GC], n° 57813/00, CEDH 2011).
[43]. Cela
n’implique pas que les cellules en question font partie intégrante de
l’« identité biologique » de la requérante, comme le décrit l’arrêt,
mais plutôt que l’intéressée a le droit de contrôle principal sur son empreinte
génétique.
[44]. Evans, précité. Bien entendu, l’affaire Evans n’est qu’en partie pertinente pour
la présente espèce, puisque les droits de la requérante en cause en l’espèce ne
touchent pas à la parentalité.
[45]. Bien
que la requérante ne paie rien, actuellement, pour le stockage de ses embryons,
il n’existe selon elle aucune disposition juridique qui empêcherait le service
de stockage médical de mettre ces frais à sa charge. Le Gouvernement n’a pas
contesté cette observation.
[46]. Une
question reste un mystère à mes yeux : pourquoi l’absence de consensus européen sur l’existence d’un droit est si
souvent interprétée contre l’existence de ce droit, alors même que l’existence
d’un tel droit peut être déduite de la notion autonome d’un droit fondé sur la
Convention, aussi, par exemple, à la lumière des évolutions du droit
international et des réalités sociales. Si l’exercice d’une liberté a été
autorisé au moins dans certains pays, cela devrait alors créer une présomption en
faveur de ce droit fondé sur la Convention dès lors que celui-ci est par
ailleurs compatible avec une interprétation raisonnable de la signification et
de la portée du droit en question. Cela n’exclut pas la possibilité qu’il peut
y avoir de bonnes raisons dans un autre pays pour restreindre ce doit. Ou
disons-nous que la reconnaissance de la portée plus large d’un droit dans
plusieurs pays est arbitraire et dénuée de pertinence ?
Avec
la théorie controversée sur la marge d’appréciation, telle qu’interprétée par
la Cour, l’État est exonéré de l’obligation de fournir une justification
matérielle de l’existence d’un besoin impérieux d’opérer une ingérence.
Invoquer l’absence de consensus européen comme indicateur déterminant de
l’absence d’une certaine signification ou portée d’un droit fondé sur la
Convention ignore le préambule de celle-ci, qui évoque « le développement
des droits de l’homme » comme l’un des moyens d’atteindre le but de la Convention.
[47]. Bien
entendu, cela n’incombe pas à la Cour. C’est au Gouvernement de savoir et
d’expliquer ce qu’est le but de la législation en cause. Au moins pendant le
dernier stade du débat, les partisans de la loi ont expressément nié que
celle-ci avait une quelconque finalité morale. Le député Giuseppe Fioroni a
déclaré que la loi ne servait pas la morale catholique mais le droit naturel
(19 janvier 2004).
http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/framedinam.asp?sedpag=sed408/s000r.htm
[48]. La
Cour s’inspire des observations écrites formulées par le Gouvernement au titre
de l’article 1 du Protocole n° 1, dont l’applicabilité en l’espèce a été
rejetée. Ce n’est que dans la plaidoirie orale que le Gouvernement a soutenu
que la loi servait la protection de « la potentialité de vie de
l’embryon », mais pas dans le contexte de l’article 8 § 2.
[49]. Les
organes, par exemple, ne sont pas traités purement comme des biens mais cela ne
leur confère pas la qualité « d’êtres humains ». Le statut juridique
du matériel biologique n’est pas évident et doit être précisé avant que des
hypothèses ne puissent être formulées sur des droits en la matière.
En
théorie juridique italienne, un « sujet » est un point de référence
pour les relations juridiques, pas une personne. Toutes les personnes sont des
sujets, mais tous les sujets ne sont pas des personnes (“Ogni persona è soggetto, non ogni soggetto è persona”) Cass.,
24 juillet 1989, n° 3498, dans Foro
it., 1990, I, c. 1617.
[50]. Dans
l’affaire James et autres (ibidem), la Cour n’a accordé qu’une
« certaine marge d’appréciation » qui au fil des ans s’est transformé
en « ample » marge d’appréciation.
[51]. Voir
également la jurisprudence citée au paragraphe 167 du présent arrêt.
[52]. Des
dispositions clés de la loi ont déjà été jugées contraires à la Constitution ou
à la Convention (paragraphes 27-39 du présent arrêt, et Costa et Pavan c. Italie, no 54270/10, 28 août 2012).
[53]. “Tutti (sia il
rapporto Warnock sia gli scienziati che hanno partecipato alle varie audizioni
di Camera e Senato) hanno dichiarato: sì, è vita, però...” « Tous
(le rapport Wamock et les scientifiques qui ont participé aux différentes
audiences de la Chambre et du Sénat) ont déclaré : oui, la vie, mais… »
(La députée Maria Burani Procaccini, défendant le projet de loi
(19 janvier 2004)).
[54]. La
loi ne prévoyait en aucune façon le sort à réserver aux embryons surnuméraires.
C’est uniquement le Comité national de bioéthique qui a décidé ultérieurement
(le 18 novembre 2005), sur des fondements juridiques incertains, que
l’adoption en vue d’une naissance était autorisée (paragraphes 19-20 du présent
arrêt).
[55]. Un
pourcentage de 25% des électeurs inscrits ont participé au référendum non
valable sur la loi en 2005, 88% des votants s’étant prononcés en faveur d’une
abrogation partielle.
[56]. « La
République garantit la liberté des arts et des sciences, qui peuvent être
enseignés librement ». Le Gouvernement n’a pas démontré que les valeurs
constitutionnelles de la science ont été mises en balance par le Parlement, et
a formulé des observations uniquement sur l’utilisation des cellules
pluripotentes par la recherche.
[57]. Les
commentateurs ont été prompts à souligner les incohérences internes de la loi. Voir Carlo Casonato, Legge 40 e principio di non contraddizione: una
valutazione d’impatto normativo. Collana Quaderni del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell'Università di Trento, vol. n° 47, Università di Trento, 2005.
[58]. Le
Gouvernement s’attend peut-être à ce que l’humanité développe la faculté
scientifique de faire pousser un être humain à partir d’un embryon in vitro en se passant d’un
utérus ?
[59]. Un
choix qui est au moins étroitement lié à la préservation et à la protection de
la vie comme celui de la législation actuelle.
[60]. Voir
le rapport de la Stanford Medical School à l’adresse suivante : http://med.stanford.edu/news/all-news/2011/04/new-approach-to-ivf-embryo-donations-lets-people-weigh-decision.html.
[61]. Voir,
par exemple, le témoignage du professeur de Luca; Patient Handbook on Stem Cell Therapies publié par la International
Society of Stem Cell
Recherche:http://www.closerlookatstemcells.org/docs/default-source/patient-resources/patient-handbook---english.pdf;
National Institutes of Health: http://stemcells.nih.gov/Pages/Default.aspx.
[62]. Je
ne pense pas que les évolutions rapides de la science et de la technologie
soient pertinentes ici, à moins que la science ne permette un jour la
production de bébés en dehors de l’utérus et en dehors du corps humain ;
et dans ce cas, il y aura un consensus moral que l’embryon a le droit de
devenir un homuncule (ectogénèse), quel que soit les souhaits des donneurs. Je
ne peux imaginer que pareilles considérations soient applicables en l’espèce,
nonobstant les efforts consentis en vue de créer un ventre artificiel.