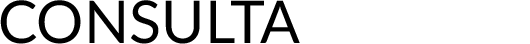Corte europea dei diritti dell’uomo
(sezione II), 27 aprile 2010
(Requête n. 16318/07)
AFFAIRE MORETTI E
BENEDETTI C. ITALIE
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de
En l'affaire Moretti
et Benedetti c. Italie,
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir
délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no
16318/07) dirigée contre
2. Les requérants sont représentés par Me L. Mollica
Busacca, avocate à Milan. Le gouvernement italien (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E.
Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri.
3. Le 29 janvier 2009, le président de la deuxième
section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de
l'article 29 § 3 de
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le premier requérant, M. Luigi Moretti, et la deuxième
requérante, Maria Brunella Benedetti, sont un couple marié de nationalité
italienne. Ils sont nés en 1966 et 1959 et résident à Lugo di Ravenna. Devant
5. Après sa naissance, A. resta quelque temps à l'hôpital parce
qu'elle présentait des troubles d'abstinence à cause de la toxicomanie de sa
mère biologique. Celle-ci cessa de s'occuper d'elle quelques jours après
l'avoir mise au monde.
6. Par un décret urgent du 20 mai 2004, le tribunal pour enfants
de Venise ouvrit une procédure visant à déclarer l'enfant adoptable et ordonna
son placement à l'assistance publique. A. fut placée dans le foyer des
requérants. Prévu pour une période de 5 mois (3 juin 2004 - 3 novembre 2004),
le placement fut prorogé jusqu'en décembre 2005.
7. Les requérants vivaient avec leur fille et un enfant adopté
par la première requérante quelques années auparavant. Ils avaient déjà
accueilli des enfants à titre provisoire, qui ensuite avaient été adoptés par
d'autres familles.
8. Le 26 octobre 2004, les requérants adressèrent une demande
d'adoption spéciale au tribunal pour enfants de Venise.
9. Le 16 décembre 2004, la mère biologique, les parents proches
et les requérants furent entendus par le tribunal.
10. A l'âge de sept mois, A. fut inscrite à la crèche.
11. En janvier 2005, la famille des requérants se rendit au
Brésil en vacances.
12. Le 7 mars 2005, le tribunal déclara l'enfant adoptable. Le
15 mars 2005, n'ayant pas reçu de réponse à leur demande d'adoption spéciale
introduite le 26 octobre 2004, les requérants adressèrent une nouvelle demande
d'adoption spéciale au tribunal pour enfants de Venise.
13. Le 9 juin 2005, la mère biologique fit opposition à la
déclaration d'adoptabilité de l'enfant. Par une décision du
4 juillet 2005, le tribunal rejeta l'opposition de la mère
biologique.
14. Le 30 novembre 2005, deux juges se rendirent chez
les requérants pour les entendre. L'objectif de cette rencontre était de
demander aux requérants d'aider A. à s'insérer dans la nouvelle famille
adoptive choisie par le tribunal.
15. Le 7 décembre 2005, le tribunal pour enfants autorisa les
contacts avec la nouvelle famille choisie pour l'adoption. Il interdit tout
contact entre la famille choisie et les requérants. Le 19 décembre 2005, il
confia la garde de A. à une nouvelle famille aux fins de l'adoption. Cette décision
ne fut pas notifiée aux requérants.
16. Le même jour, A. fut éloignée du foyer des requérants, avec
l'aide de la force publique.
17. Le 21 décembre 2005, les requérants saisirent le tribunal
pour enfants de Venise. Ils se plaignaient de n'avoir jamais reçu de réponse à
leur demande d'adoption de mars 2005, et de n'avoir pas été mis au courant de
la procédure d'adoption de A. Ils demandaient à pouvoir renouer les contacts
avec A.
18. Le même jour, le tribunal classa la demande d'adoption des
requérants au motif qu'entre-temps, une autre famille avait été choisie pour
l'enfant.
19. Par un décret du 3 janvier 2006, le tribunal rejeta la
deuxième demande des requérants au motif que le choix de la nouvelle famille
était dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
20. Le 6 avril 2006, les requérants interjetèrent appel du
décret devant la cour d'appel de Venise.
21. Par un arrêt du 19 mai 2006, la cour d'appel annula le
décret du tribunal, relevant notamment un défaut de motivation. De surcroît, la
cour souligna que la demande d'adoption des requérants aurait dû être examinée
avant de déclarer l'enfant adoptable et de choisir une nouvelle famille. Par conséquent,
la cour chargea un expert de vérifier la relation entre la mineure et les
requérants et son intégration dans la nouvelle famille.
22. Le 27 octobre 2006, après avoir relevé que l'enfant
manifestait de l'attachement aux deux couples en cause, la cour d'appel rejeta
le recours des requérants au motif que, selon le rapport de l'expert, la
mineure semblait bien intégrée dans la nouvelle famille, et qu'ainsi, pour
sauvegarder ses intérêts, il n'était pas opportun de procéder à une nouvelle
séparation qui aurait pu provoquer un traumatisme chez l'enfant.
23. L'adoption d'A. devint définitive à une date non précisée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
24. La loi no 184 du 4 mai
1983 avait déjà amplement modifié la matière de
l'adoption. Elle a depuis lors été amendée de nouveau (loi no 149 de
2001).
L'article 1 de cette loi prévoit que « le mineur a le droit à
être éduqué dans sa propre famille ».
Selon l'article 2, « le mineur qui est resté temporairement sans un
environnement familial adéquat peut être confié à une autre famille, si
possible comprenant des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à une
communauté de type familial, afin de lui assurer la subsistance, l'éducation et
l'instruction. Au cas où un placement familial adéquat ne serait pas possible,
il est permis de placer le mineur dans un institut d'assistance public ou
privé, de préférence dans la région de résidence du mineur ».
L'article 5 prévoit que la famille ou la personne à laquelle le mineur est
confié doivent lui assurer la subsistance, l'éducation et l'instruction (...)
compte tenu des indications du tuteur et en observant les prescriptions de
l'autorité judiciaire. Dans tous les cas, la famille d'accueil exerce la
responsabilité parentale en ce qui concerne les rapports avec l'école et le
service sanitaire national. La famille d'accueil doit être entendue dans la procédure
de placement et celle concernant la déclaration d'adoptabilité.
Par ailleurs, l'article 7 prévoit que l'adoption est possible au bénéfice
des mineurs déclarés adoptables.
L'article 8 prévoit que « peuvent être déclarés en état d'adoptabilité
par le tribunal pour enfants, même d'office, (...) les mineurs en situation
d'abandon car dépourvus de toute assistance morale ou matérielle de la part des
parents ou de la famille tenus d'y pourvoir, sauf si le manque d'assistance est
dû à une cause de force majeure de caractère transitoire ». « La
situation d'abandon subsiste », poursuit l'article 8, « (...) même si
les mineurs se trouvent dans un institut d'assistance ou s'ils ont été placés
auprès d'une famille ». Enfin, cette disposition prévoit que la cause de
force majeure cesse si les parents ou d'autres membres de la famille du mineur
tenus de s'en occuper refusent les mesures d'assistance publique et si ce refus
est considéré par le juge comme injustifié. La situation d'abandon peut être
signalée à l'autorité publique par tout particulier et peut être relevée
d'office par le juge. D'autre part, tout fonctionnaire public, ainsi que la
famille du mineur, qui ont connaissance de l'état d'abandon de ce dernier, sont
obligés d'en faire la dénonciation. Par ailleurs, les instituts d'assistance
doivent informer régulièrement l'autorité judiciaire de la situation des
mineurs qu'ils accueillent (article 9).
L'article 10 prévoit ensuite que le tribunal peut ordonner, jusqu'au
placement pré-adoptif du mineur dans la famille d'accueil, toute mesure
temporaire dans l'intérêt du mineur, y compris, le cas échéant, la suspension
de l'autorité parentale.
Les articles 11 à 14 prévoient une instruction visant à éclaircir la
situation du mineur et à établir si ce dernier se trouve dans un état
d'abandon. En particulier, l'article 11 dispose que lorsque, au cours de
l'enquête, il ressort que l'enfant n'a de rapports avec aucun membre de sa
jusqu'au quatrième degré, il peut déclarer l'état d'adoptabilité sauf s'il
existe une demande d'adoption au sens de l'article 44.
A l'issue de la procédure prévue par ces derniers articles, si l'état
d'abandon au sens de l'article 8 persiste, le tribunal des mineurs déclare le
mineur adoptable si : a) les parents ou les autres membres de la famille
ne se sont pas présentés au cours de la procédure ; b) leur audition a
démontré la persistance du manque d'assistance morale et matérielle ainsi que
l'incapacité des intéressés à y remédier ; c) les prescriptions imposées
en application de l'article 12 n'ont pas été exécutées par la faute des parents
(article 15). L'article 15 prévoit également que la déclaration d'état
d'adoptabilité est prononcée par le tribunal des mineurs siégeant en chambre du
conseil par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, le
représentant de l'institut auprès duquel le mineur a été placé ou de son
éventuelle famille d'accueil, le tuteur et le mineur lui-même s'il est âgé de
plus de douze ans ou, s'il est plus jeune, si son audition est nécessaire.
L'article 17 prévoit que l'opposition à la décision déclarant un mineur
adoptable doit être déposée dans un délai de trente jours à partir de la date
de la communication à la partie requérante.
L'article 19 prévoit que pendant l'état d'adoptabilité, l'exercice de l'autorité
parentale est suspendu.
L'article 20 prévoit enfin que l'état d'adoptabilité cesse au moment où le
mineur est adopté ou si ce dernier devient majeur. Par ailleurs, l'état
d'adoptabilité peut être révoqué, d'office ou sur demande des parents ou du ministère
public, si les conditions prévues par l'article 8 ont entre-temps disparu. Cependant,
si le mineur a été placé dans une famille en vue de l'adoption ("affidamento
preadottivo") au sens des articles 22 à
L'article 44 prévoit certains cas d'adoption spéciale : l'adoption est
possible au bénéfice des mineurs qui n'ont pas encore été déclarés adoptables. En
particulier l'article 44 d) prévoit l'adoption quand il est impossible de
procéder à un placement en vue de l'adoption.
EN DROIT
I. SUR
25. Sous l'angle de l'article 8, les requérants estiment que
l'application erronée de la loi et des règles de procédure a entraîné une
ingérence illégitime dans leur vie privée et familiale.
26. Les requérants se plaignent, en outre, de la violation des
articles 6 et 13, au motif que la procédure n'aurait pas été équitable et
qu'ils n'auraient pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance
nationale.
27. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la
cause,
L'article 8 de
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...)
familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur la question de savoir si les deux premiers requérants
peuvent représenter les intérêts de A. devant
a) Arguments des parties
28. Selon le Gouvernement, les requérants ne peuvent pas représenter
l'enfant devant
29. En conclusion, la requête présentée au nom de A. par les
deux premiers requérants, qui défendent leur propre intérêt et non celui de
l'enfant, serait, pour cette partie, incompatible ratione materiae.
30. Les deux premiers requérants contestent la thèse du
Gouvernement.
31. Ils affirment que s'il est vrai que les deux premiers
requérants ne sont pas les parents biologiques de A. et n'ont aucune autorité
parentale sur elle, leur locus standi
en vertu de
Par ailleurs, les organes de
b) Appréciation de
32.
33. En la présente espèce,
34. De plus,
35. Dans ces circonstances,
2. Sur l'exception préliminaire tirée du non-épuisement des
voies de recours internes
a) Arguments des parties
36. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de
recours internes au motif que les requérants ne se sont pas pourvus en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Venise en vertu de l'article 56
de la loi no 184 de 1983.
37. Selon les requérants un recours en cassation n'aurait eu
aucun effet. Le recours devant la cour d'appel était la seule voie de recours
pour remédier à la violation, compte tenu de ce que
Au demeurant, les requérants rappellent que la jurisprudence de
b) Appréciation de
38.
38. A la lumière de ce qui précède et sans prendre en
considération le fait que la jurisprudence de
39. Par conséquent l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes du Gouvernement ne saurait être retenue.
3. Sur l'existence d'un lien entre les requérants et A. constitutif
d'une « vie familiale », au sens de l'article 8 § 1 de
a) Arguments des parties
40. Le Gouvernement considère à titre principal que l'article 8
de
41. Le Gouvernement rappelle que, dans le cas d'espèce, les
requérants avaient accueilli l'enfant à titre provisoire et étaient
parfaitement conscients de la tâche qui leur avait été confiée par les
autorités. Le fait d'accueillir l'enfant à titre provisoire ne leur donnait pas
un droit à l'adoption.
42. Selon le Gouvernement, l'existence d'un lien purement de
facto n'entraînerait pas la protection de l'article 8.
43. Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement. Ils
font valoir qu'il ressort des expertises que le lien établi entre eux et A.
était très étroit et que la mineure était bien intégrée dans leur famille. Cette
adoption avait donc pour unique finalité de légaliser cette famille « de
fait ».
b) Appréciation par
44. Conformément à sa jurisprudence,
45.
46.
47. Par ailleurs,
48.
49.
50.
51. Au demeurant,
52. A la lumière de ce qui précède,
4. Conclusion
53.
B. Sur le fond
a) Arguments des parties
54. Les requérants estiment que l'application erronée de la loi
et des règles de procédure a entraîné une ingérence illégitime dans leur vie privée
et familiale. Ils affirment qu'ils avaient introduit la demande d'adoption, en
conformité avec les dispositions de la loi, en raison du lien étroit qui
s'était établi avec A. Toutefois, la procédure irrégulière suivie par le
tribunal a empêché que leur demande d'adoption soit examinée par les
juridictions. Bien que la cour d'appel ait annulé le décret du tribunal, elle
n'a pas pu mettre fin à la violation dans la mesure où elle a décidé, afin de
sauvegarder les intérêts de l'enfant, qu'il n'était pas opportun de procéder à
une nouvelle séparation qui aurait pu provoquer un traumatisme chez l'enfant.
55. De surcroît, les requérants font valoir que l'expert nommé
par la cour d'appel n'a pas estimé nécessaire organiser des rencontres avec A.
56. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants. Il fait
valoir que le tribunal a examiné les demandes d'adoption de A. avec une
diligence particulière. A cet égard, il rappelle que, le
30 novembre 2005, deux juges se sont rendus chez les requérants afin
de les entendre.
Il soutient que l'ingérence dans le droit des requérants était prévue par
la loi no 184 de 1983 et poursuivait un but légitime, à savoir la
protection de l'enfant. L'intervention du tribunal se fondait sur des motifs
pertinents et suffisants, notamment sur l'examen des différentes demandes
d'adoption.
57. Selon le Gouvernement, la procédure suivie par le tribunal
pour enfants était justifiée dans l'intérêt de l'enfant.
58. Le Gouvernement rappelle que
59. Le Gouvernement estime en outre, que « la
défaillance » du tribunal dans le rejet de la demande d'adoption des
requérants a été réparée par la cour d'appel, qui s'est ensuite prononcée par
un arrêt motivé.
b) Appréciation par
60.
61.
62.
63. La marge d'appréciation dont disposent les Etats
contractants est de façon générale ample lorsque les autorités publiques
doivent ménager un équilibre entre les intérêts privés et publics concurrents
ou différents droits protégés par
64.
65.
66.
67.
68.
69. A cet égard,
70.
71. Ainsi, tout en réitérant qu'il ne lui revient pas de
substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant
aux mesures qui auraient dû être prises car ces autorités sont en principe
mieux placées pour procéder à une telle évaluation, et tout en reconnaissant
qu'en l'espèce, les juridictions se sont appliquées de bonne foi à préserver le
bien-être de A.,
II. SUR
72. Les requérants affirment avoir subi des traitements
inhumains et dégradants à cause, d'une part, des modalités d'éloignement de la
mineure, qui auraient eu des conséquences traumatisantes tant pour celle-ci que
pour eux-mêmes, et, d'autre part, de la décision du tribunal, qui aurait
préféré la nouvelle famille à la place de la leur. Ils invoquent l'article 3 de
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants. »
73.
74. A cet égard,
75. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE
76. Aux termes de l'article 41 de
« Si
A. Dommage
77. La première requérante demande 100 000 euros (EUR) pour
le préjudice moral qu'elle aurait subi. Elle joint une expertise psychologique
montrant la nécessité de se soumettre à des soins psychologiques à cause du
traumatisme subi. Le deuxième requérant demande 30 000 EUR pour lui-même
et 30 000 EUR au nom de l'enfant.
78. Quant au préjudice matériel, les requérants réclament
12 732 EUR pour les frais qu'ils ont dû engager à l'occasion des
procédures internes. Ce montant inclut les sommes dépensées pour se rendre
auprès des juridictions, les frais de téléphone et des visites médicales.
79. Le Gouvernement estime que les montants réclamés par les
requérants au titre de leurs propres dépenses ne justifient pas en eux-mêmes un
remboursement, car aucun lien de causalité n'a été établi entre les pertes
supposées et les violations alléguées. S'agissant du dommage moral, le
Gouvernement conteste l'expertise produite par les requérants et considère
exorbitante la somme indiquée. En tout état de cause, le Gouvernement estime
que l'état de santé de la requérante et son lien de causalité avec la
séparation d'avec A. devraient être établis par un expert nommé par
80. En ce qui concerne les prétentions des requérants pour
préjudice matériel, il est établi dans la jurisprudence de
81. S'agissant des prétentions au titre du dommage moral,
82. Statuant en équité,
B. Frais et dépens
83. Les requérants demandent le remboursement des frais et
dépens exposés dans le cadre des procédures devant les juridictions italiennes,
soit 9 862 EUR. Ils demandent en outre 10 000 EUR au titre des frais
afférents à la procédure devant
84. Quant aux frais engagés devant les juridictions internes,
85. En ce qui concerne les frais encourus devant elle,
86. Dans ces conditions
C. Intérêts moratoires
87.
PAR CES MOTIFS,
1. Dit, à l'unanimité, que les deux premiers requérants
n'ont pas qualité pour agir devant
2. Déclare, à la majorité, la requête recevable quant au
grief tiré de l'article 8 ;
3. Déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable pour
le surplus ;
4. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation
de l'article 8 de
5 Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser aux deux premiers requérants
conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de
ii. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant
être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iii. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant
pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à
celui de la facilité de prêt marginal de
6 Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 27 avril 2010, en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de
– opinion concordante du juge Cabral Barreto ;
– opinion dissidente de la juge Işıl
KARAKAŞ.
F.T.
F.E.P.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE CABRAL BARRETO
Je suis d'accord avec la majorité mais je souhaite me dissocier du
raisonnement qu'elle suit au paragraphe 51. Elle y dit ceci :
« Toutefois, dans le cas d'espèce, les requérants, en considération du
lien étroit avec A., avaient décidé de déposer une demande d'adoption. Cette
demande constitue pour
Si je comprends bien la majorité, il existerait des « liens
familiaux » entre une famille d'accueil et l'enfant. Si c'est bien là ce
que veut dire la majorité, il me semble qu'elle va très loin.
Pour moi, les liens interpersonnels étroits entre les requérants et
l'enfant ne suffisent pas à transformer qualitativement ce rapport. Les enfants
sont confiés à une famille d'accueil en attendant qu'on leur trouve une
famille. Ni ce but ni l'intérêt supérieur de l'enfant ne commandent de regarder
le rapport entre l'enfant et la famille d'accueil comme des liens familiaux.
Toutefois, dans le cas d'espèce, à un moment donné les requérants ont fait
une demande d'adoption de l'enfant.
Pour la majorité, cet indice n'est pas déterminant ; pour moi, il est
déterminant et décisif.
Si les requérants n'avaient pas demandé à adopter l'enfant, ils ne se
différencieraient en rien des autres familles d'accueil qui reçoivent des
enfants non pas pour entretenir des rapports familiaux mais tout simplement
pour s'occuper de ces enfants, si possible avec beaucoup de tendresse et même
d'amour, mais sans intention de fonder avec eux une famille.
Bref, sans la demande d'adoption qui révèle que les requérants ont voulu
accueillir l'enfant comme membre de leur famille, j'aurais du mal à admettre
que la relation entre les requérants et A. relève de la vie familiale.
OPINION DISSIDENTE DE
Contrairement à la majorité, j'estime que, dans le cas d'espèce, l'article
8 de
D'après la jurisprudence de
En matière d'adoption, il faut rappeler que
Dans le cas d'espèce, la majorité trouve (au paragraphe 50 de l'arrêt)
qu'il existait entre les requérants et le bébé A. un lien interpersonnel
étroit, en se fondant sur quelques éléments (la mineure était bien insérée dans
la famille, les requérants avaient assuré le développement social de l'enfant
parce qu'ils l'avaient envoyée à la crèche et ils avaient fait un voyage avec
le bébé). Finalement, les requérants ont décidé de déposer une demande
d'adoption, ce qui constitue pour la majorité un indice – même s'il n'est pas
déterminant – de la force du lien instauré entre les requérants et le bébé
(paragraphe 51).
Ces éléments ne suffisent pas à mes yeux pour que l'on puisse conclure à
l'existence d'une relation suffisamment forte pour s'analyser en une vie
familiale, d'autant que, pour moi, en agissant ainsi les requérants ont rempli
le rôle et les responsabilités qui leur étaient dévolus en tant que famille
d'accueil (voir, notamment, la partie « droit interne », au
paragraphe 24 de l'arrêt).
Tout d'abord, ils n'ont pas obtenu l'adoption de A. ; donc on ne peut
parler d'une relation entre un adoptant et un adopté, qui est en principe de
même nature que les relations familiales protégées par l'article 8 (Pini et
autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 140, CEDH
2004-V ; voir aussi les autres références qui y sont citées). Dans le cas
d'espèce, les requérants représentaient une famille d'accueil qui avait la
garde de l'enfant à titre transitoire. Ils n'avaient même pas la garde de
l'enfant en vue de l'adoption, mais ils ont tout simplement accueilli A.
provisoirement à la suite de l'offre des services sociaux pendant une procédure
devant permettre de déclarer l'enfant adoptable. Ce sont les juridictions
internes qui décident de toutes mesures opportunes dans l'intérêt supérieur de
l'enfant.
Comme les requérants assuraient l'accueil de A. à titre provisoire, cette
situation ne pouvait leur donner aucun droit ou avantage aux fins de
l'adoption ; dire le contraire reviendrait à admettre que les personnes
qui accueillent des enfants à titre provisoire ont éventuellement la priorité
en cas d'adoption. Or les juridictions internes doivent évaluer les demandes
d'adoption présentées par d'autres familles en donnant la priorité à l'intérêt
supérieur de l'enfant.
La protection de l'enfant est bien plus importante que le désir des requérants
de l'adopter, d'autant que, d'après le dossier, A. est très bien intégrée dans
sa nouvelle famille et qu'il ne serait pas judicieux de procéder à une nouvelle
séparation, qui pourrait lui causer un traumatisme (paragraphe 22 de l'arrêt).
A mes yeux, le simple lien de fait établi entre les requérants et le bébé
et le désir qu'avaient les requérants d'adopter celui-ci, n'étaient pas
suffisants pour que l'on puisse conclure à l'existence d'une vie familiale qui
mérite la protection de l'article 8 de
Au demeurant, les relations de type familial ont été considérées, selon
l'approche traditionnelle des organes de
Concernant la violation de l'article 8, dans sa jurisprudence
Dès lors, selon moi, l'Etat défendeur n'a pas failli à ses obligations
positives découlant de l'article 8 de