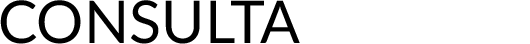Corte europea dei diritti dell’uomo
(Seconda Sezione)
22 giugno
2000
AFFAIRE
COËME ET AUTRES c. BELGIQUE
(Requêtes
nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96)
DÉFINITIF
18/10/2000
En
l'affaire Coëme et autres c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de
l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis,
président,
A.B. Baka,
B. Conforti,
Mme F.
Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en
chambre du conseil les 30 mars, 6 avril et 30 mai 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à
cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouvent cinq requêtes (nos 32492/96, 32547/96, 32548/96,
33209/96 et 33210/96) dirigées contre le Royaume de Belgique et dont cinq
ressortissants de cet Etat avaient saisi la Commission européenne des Droits de
l'Homme (« la Commission »), en vertu de l'ancien article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
La première de ces requêtes a été
déposée par M. Guy Coëme le 23 juillet 1996 et a
été enregistrée le 2 août 1996 sous le numéro de dossier 32492/96. Devant
la Cour, le requérant est représenté par Me P. Lambert,
avocat au barreau de Bruxelles.
La deuxième requête a été déposée
par M. Jean-Louis Mazy le 1er août 1996 et
a été enregistrée le 7 août 1996 sous le numéro de dossier 32547/96. Devant la
Cour, le requérant est représenté par Me O. Klees,
avocat au barreau de Bruxelles.
La troisième requête a été
déposée à l'origine par M. Jean-Louis Stalport le 5
août 1996 et a été enregistrée le 7 août 1996 sous le numéro de dossier 32548/96.
M. Stalport est décédé le 7 mai 1997. Par une lettre
du 4 juillet 1997, son épouse et ses filles – toutes trois de nationalité
belge et nées respectivement en 1951, 1976 et 1979, qui sont ses seules
héritières – ont exprimé leur intention de poursuivre la procédure et d'être
représentées par les conseils choisis par leur mari et père : Mes
J. Cruyplants, R. De Baerdemaeker
et O. Louppe, avocats au barreau de Bruxelles.
La quatrième requête a été
déposée par M. Auguste Merry Hermanus
le 8 août 1996 et a été enregistrée le 27 septembre 1996 sous le numéro de
dossier 33209/96. Devant la Cour, le requérant est représenté par Mes N. Cahen, F. Maussion et R. de Béco, avocats au barreau de Bruxelles.
La cinquième requête a été
déposée par M. Camille Javeau le 31 juillet 1996 et enregistrée le 27 septembre
1996 sous le numéro de dossier 33210/96. Devant la Cour, le requérant est
représenté par Mes T. Delahaye, P. Mayence, M.-F. Dubuffet et P. Erkes, avocats au barreau de Bruxelles.
Le gouvernement belge (« le
Gouvernement ») était représenté par son agent, M. C. Debrulle,
directeur d'administration au ministère de la Justice.
Sous l'angle des articles 6, 7,
13 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent des poursuites pénales
engagées contre eux en Belgique. M. Coëme, qui
était ministre lorsque les faits en cause furent commis, fut traduit devant la
Cour de cassation conformément à l'article 103 de la Constitution, tel que
libellé avant la modification constitutionnelle du 12 juin 1998, qui
prévoyait que seule la Cour de cassation, chambres réunies, avait le droit de
juger les ministres. Les autres requérants furent traduits devant cette
juridiction en raison des liens de connexité existant entre les faits qui leur
étaient reprochés et ceux reprochés à M. Coëme. Le
5 avril 1996, la Cour de cassation prononça un arrêt de condamnation à
l'égard des cinq requérants.
2. Le 7 avril 1997, la Commission a
décidé de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement.
En ce qui concerne la première
requête, la Commission a invité le Gouvernement à présenter ses observations
sur le grief relatif à l'absence de loi d'application régissant la procédure
d'examen par la Cour de cassation, ainsi que sur les griefs fondés sur le fait
que cette juridiction, en faisant application de l'article 21 de la loi du 17
avril 1978 tel que modifié par l'article 25 de la loi du 24 décembre 1993,
aurait attribué une rétroactivité à l'article 103 de la Constitution tel que
modifié le 5 mai 1993 et aurait étendu sa saisine à des faits et préventions
qui n'étaient pas visés par la décision de renvoi de la Chambre des
représentants. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 septembre 1997
et le requérant y a répondu le 12 novembre 1997.
Dans le cadre de son examen de la
deuxième requête, la Commission a invité le Gouvernement à présenter ses
observations sur les griefs relatifs au renvoi du requérant devant la Cour de
cassation malgré le fait qu'il n'ait jamais exercé les fonctions de ministre et
à l'absence de loi d'application régissant la procédure d'examen par la Cour de
cassation, ainsi que sur le grief selon lequel le requérant n'aurait pas
disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et
sur celui fondé sur le refus de soumettre une question préjudicielle à la Cour
d'arbitrage. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 septembre 1997
et le requérant y a répondu le 5 novembre 1997.
Pour la troisième requête, la
Commission a invité le Gouvernement à présenter ses observations sur les griefs
relatifs au renvoi du requérant devant la Cour de cassation malgré le fait
qu'il n'ait jamais exercé les fonctions de ministre et à l'absence de loi
d'application régissant la procédure d'examen par la Cour de cassation, ainsi
que sur le grief selon lequel le requérant n'aurait pas disposé du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Le Gouvernement a
également été invité à présenter ses observations sur les griefs selon lesquels
la Cour de cassation avait refusé de soumettre une question préjudicielle à la
Cour d'arbitrage et aurait retenu certaines déclarations faites par le
requérant lors de son audition du 16 mars 1994 comme constitutives d'un aveu.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 septembre 1997 et les héritières
du requérant y ont répondu le 19 décembre 1997.
En ce qui concerne la quatrième
requête, la Commission a invité le Gouvernement à présenter ses observations
sur les griefs relatifs au renvoi du requérant devant la Cour de cassation
malgré le fait qu'il n'ait jamais exercé les fonctions de ministre et à
l'absence de loi d'application régissant la procédure d'examen par la Cour de
cassation, ainsi que sur ceux fondés sur le fait que cette juridiction a fait
application de l'article 21 de la loi du 17 avril 1978 tel que modifié par
l'article 25 de la loi du 24 décembre 1993, a refusé de soumettre une question
préjudicielle à la Cour d'arbitrage et ne se serait pas prononcée dans un délai
raisonnable. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 septembre 1997
et le requérant y a répondu le 19 décembre 1997.
S'agissant de la cinquième
requête, la Commission a invité le Gouvernement à présenter ses observations
sur les griefs relatifs au renvoi du requérant devant la Cour de cassation
malgré le fait qu'il n'ait jamais exercé les fonctions de ministre et à
l'absence de loi d'application régissant la procédure d'examen par la Cour de
cassation, ainsi que sur le grief selon lequel le requérant n'aurait pas
disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et
sur celui fondé sur le refus de soumettre une question préjudicielle à la Cour
d'arbitrage. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 septembre 1997
et le requérant y a répondu le 19 décembre 1997.
3. A la suite de l'entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention le 1er novembre
1998, et conformément à l'article 5 § 2 dudit Protocole, l'affaire est examinée
par la Cour.
4. Conformément à l'article 52 § 1 du
règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M.
L. Wildhaber, a attribué l'affaire à la deuxième
section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein
droit Mme F. Tulkens, juge élue au titre
de la Belgique (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement),
et M. C.L. Rozakis, président de la section
(article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier
pour compléter la chambre étaient M. B. Conforti, M.
P. Lorenzen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. A.B. Baka
et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le 8 décembre 1998, la chambre a
décidé de joindre les requêtes (article 43 § 1 du règlement). Elle a ensuite
décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience
des observations sur la recevabilité et le fond de certains griefs soulevés
dans les requêtes.
6. Ainsi qu'en avait décidé le président
de la chambre, les débats se sont déroulés en public le 2 mars 1999, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M. J.
Lathouwers, conseiller juridique adjoint,
chef de service au ministère de la
Justice, agent,
Mes F. Herbert,
F.
de Visscher, avocats au barreau de Bruxelles, conseils ;
– pour les requérants
(pour M. Coëme)
Me P. Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, conseil,
M. M.
Verdussen, professeur à l'Université catholique
de Louvain, conseiller,
(pour M. Mazy)
Me O. Klees, avocat au barreau de Bruxelles, conseil,
(pour les
héritières de M. Stalport)
Mes J. Cruyplants,
R.
De Baerdemaeker,
O.
Louppe, avocats au barreau de Bruxelles, conseils,
(pour M.
Hermanus)
Mes N. Cahen,
R.
de Béco, avocats au barreau de Bruxelles, conseils,
(pour M. Javeau)
Mes M.-F. Dubuffet,
P.
Erkes, avocats au barreau de Bruxelles, conseils.
La Cour a entendu en leurs
déclarations Me de Visscher, Me
Klees, M. Verdussen, Me
Lambert, Me Cahen, Me Erkes, Me Dubuffet et Me Cruyplants.
7. A l'issue des délibérations qui se sont
tenues à la suite de l'audience du 2 mars 1999, la chambre a déclaré les
requêtes recevables quant aux griefs relatifs :
– à l'absence de loi
d'application régissant la procédure d'examen du bien-fondé des poursuites
dirigées contre les ministres en application de l'article 103 de la
Constitution et aux difficultés qui en ont découlé pour l'organisation de la
défense des requérants,
– à l'application de
l'article 21 de la loi du 17 avril 1978, tel que modifié par l'article 25 de la
loi du 24 décembre 1993,
– au renvoi devant la
Cour de cassation des quatre requérants qui n'ont jamais exercé les fonctions
de ministre,
– au refus opposé par
la Cour de cassation à la demande de soumettre à la Cour d'arbitrage des
questions préjudicielles relatives à la connexité et à l'allongement du délai
de prescription,
– à la circonstance
que la Cour de cassation aurait retenu certaines déclarations faites par M. Stalport lors de son audition du 16 mars 1994, à titre de
témoin, comme constitutives d'un aveu,
– à la durée
prétendument excessive des poursuites dirigées contre M. Hermanus,
– au fait que la Cour
de cassation serait structurellement et traditionnellement soumise à
l'influence de son ministère public.
8. Le 24 mars 1999, le
texte de la décision sur la recevabilité[1] a été notifié aux parties.
Celles-ci ont également été invitées à présenter leurs observations sur le
grief selon lequel la Cour de cassation serait structurellement et traditionnellement
soumise à l'influence de son ministère public, soulevé dans les requêtes nos
32547/96 et 32548/96. Elles ont aussi été informées de la possibilité de
soumettre d'autres observations sur le fond de l'affaire. Les requérants ont en
outre été invités à fournir des précisions au sujet de leurs demandes de
satisfaction équitable (article 60 § 2 du règlement).
9. Les requérants ont présenté leurs
observations sur le fond de l'affaire le 4 mai 1999 et le Gouvernement a
présenté les siennes le 21 mai 1999. Les requérants ont présenté des
observations complémentaires le 9 juillet 1999. Des notes relatives à la
satisfaction équitable ont été déposées le 11 mai 1999 (requête no
32492/96), le 21 mai 1999 (requêtes nos 32547/96, 32548/96 et
33209/96) et le 25 mai 1999 (requête no 33210/96). Le Gouvernement y
a répondu le 29 juillet 1999.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Ressortissant belge né en 1948, M. Coëme est ancien membre de la Chambre des représentants et
ancien ministre.
M. Mazy,
ressortissant belge né en 1955, est économiste.
La requête no 32548/96
a été introduite à l'origine par M. Stalport,
ressortissant belge né en 1950, qui exerçait alors les fonctions
d'administrateur général de la Radio-Télévision
belge. A la suite du décès de M. Stalport le 7
mai 1997, son épouse et ses filles ont exprimé leur intention de poursuivre la
procédure par lettre du 4 juillet 1997.
M. Hermanus
est un ressortissant belge, né en 1944. Fonctionnaire public, il a été, de 1983
à 1986, échevin de la commune de Jette et, de 1989 à 1996, président de la
Société de développement régional pour l'arrondissement de Bruxelles-capitale
(SDRB).
M. Javeau, ressortissant belge né
en 1943, est psychologue.
11. En 1984, M.
Javeau, employé de l'association « I », en fut nommé directeur.
L'objet social de cette association consistait dans la réalisation d'études de
marché et de sondages d'opinion, ainsi que dans la création et le développement
de logiciels informatiques. Les études de marché étaient notamment commandées
et payées par des tiers issus tant du secteur privé que du secteur public
(Etat, établissements publics, partis politiques, etc.). L'association
réalisait également des études de marché et des sondages d'opinion de sa propre
initiative. Le 22 août 1989, M. Javeau fut licencié pour faute grave, alors
qu'il se trouvait aux Etats-Unis.
12. Le 25 août 1989, un juge d'instruction
au tribunal de première instance de Bruxelles fut chargé d'une instruction
relative à certaines activités de l'association « I ».
13. Le 26 août 1989, M. Javeau fut placé
en détention préventive, à son retour des Etats-Unis. On le soupçonnait
d'avoir, par des faux en écritures, surfacturé le prix de conventions de
recherche conclues par l'association « I », notamment avec l'Etat belge,
la Région wallonne et la communauté française. Il aurait profité
personnellement et aurait permis à des tiers de profiter des suppléments de
prix ainsi versés à l'association. Parmi les personnes qui auraient bénéficié
de ces opérations, se trouvaient des personnalités politiques.
14. En octobre 1989, V., l'administrateur
délégué de l'association « I », fut également mis en détention
préventive et fut remis en liberté en novembre 1989, comme M. Javeau.
15. Le 28 août 1989, M. Hermanus déposa une plainte contre X à propos « de
rumeurs calomnieuses qui se [répandaient à son] sujet, en rapport avec le
licenciement de M. C. Javeau ». Dans cette plainte, il donnait des
explications circonstanciées à propos de deux études qu'il avait confiées à
l'association « I », en sa qualité de secrétaire général du ministère
de la Communauté française de Belgique. Ces études, dont l'une n'aurait pas été
réalisée, furent confiées à l'association « I » sur la base de deux
conventions datant respectivement des 16 et 27 novembre 1987 et dont les
factures furent payées les 20 janvier et 29 février 1988 par la Communauté
française.
16. Dans le cadre des poursuites engagées notamment
contre M. Javeau, le juge d'instruction désigna un expert judiciaire, aux fins
de mettre à jour le mécanisme mis en place et de déterminer ses responsables
ainsi que ses bénéficiaires. L'expert fut notamment chargé de décrire l'état de
la comptabilité de l'association, d'étudier ses comptes annuels, de déterminer
dans quelle mesure celle-ci aurait ou non une activité d'ordre commercial,
d'individualiser les pièces à arguer de faux et de relever tous éléments de
caractère frauduleux dans les limites des réquisitions de mise à l'instruction
et d'éventuelles réquisitions complémentaires.
17. L'expert déposa un rapport
préliminaire en décembre 1989.
18. A la suite de réquisitoires, des
rapports d'expertises complémentaires furent demandés par le juge
d'instruction. L'un de ceux-ci fut déposé en 1990.
19. Le 28 août 1991, des perquisitions
furent effectuées au domicile de M. Hermanus et
à ses bureaux d'échevin à Jette.
20. Le 10 juin 1992, le Comité supérieur
de contrôle (un organisme indépendant chargé de rechercher les fraudes ou
infractions commises à l'occasion du fonctionnement de services publics,
d'effectuer des contrôles concernant les marchés publics et de procéder à des
vérifications concernant les subventions publiques) entendit M. Hermanus. Un procès-verbal no 2337 fut établi à
cette occasion. M. Hermanus fut encore entendu à
plusieurs reprises par le comité en 1992 et 1993.
21. Le 8 juin 1993, un enquêteur du Comité
supérieur de contrôle interrogea M. Javeau à propos de certains contrats
conclus par l'association « I » et notamment trois conventions de
1 200 000 francs belges (BEF), chacune signée par le ministre M. et
concernant les entreprises bruxelloises :
– à vocation
d'exportation,
– à vocation de
sous-traitance,
– qui reçoivent une
aide de la Région bruxelloise (sous dossiers IN B/40, B/50 et B/60).
Il lui fut notamment demandé si
on n'avait pas « effectivement vidé les fonds de tiroir » avant que
le ministre M. ne quitte la Région bruxelloise et si on n'avait pas scindé une
pré-étude en trois conventions, de manière à éluder le contrôle de l'inspecteur
des Finances.
Selon le procès-verbal
d'audition, M. Javeau y répondit en ces termes :
« Oui, effectivement on a
passé ces contrats à la fin du mandat du ministre M. à la région bruxelloise
comme je viens de vous l'expliquer, mais en ce qui concerne la scission du
marché en trois contrats, je pense que c'était simplement pour gagner du temps.
En effet, il fallait installer le nouveau ministre-président et une autre
procédure aurait entraîné des délais supplémentaires. Si on n'avait pas scindé
le contrat il aurait effectivement fallu passer par l'avis de l'inspecteur des
finances, et, en cas d'avis défavorable, aller jusqu'au conseil des ministres,
pour une convention que M. avait la volonté de faire accepter à quel niveau de
la procédure que cela soit. »
22. Le rapport final des expertises comporte
six tomes qui furent déposés entre décembre 1993 et mars 1994.
23. Des rapports concernant les demandes
d'expertises complémentaires furent encore déposés en janvier et février 1995.
24. Le 2 février 1994, le juge
d'instruction inculpa M. Hermanus d'abus de
confiance, escroquerie, faux en écritures et usage de faux, ainsi que de
corruption de fonctionnaire.
25. L'instruction
paraissant révéler des indices d'infraction à charge de personnalités protégées
par des immunités ministérielles ou parlementaires à l'égard desquelles des
actes de poursuite ou d'instruction ne pouvaient être accomplis que dans les
conditions prévues par l'article 59 (membre de la Chambre des représentants ou
du Sénat), 103 (ministres) ou 120 (membres des conseils des communautés et
régions) de la Constitution, le magistrat instructeur communiqua, dans
l'intervalle, son dossier au parquet de la cour d'appel de Bruxelles le 7
février 1994.
26. Le procureur général près la cour
d'appel de Bruxelles considéra qu'effectivement des indices d'infraction
semblaient pouvoir être mis à charge de onze personnalités politiques protégées
par des immunités ministérielles ou parlementaires, dont M. Coëme
et le ministre M.
27. Le 16 mars 1994, M. Stalport fut entendu, en qualité d'ancien chef de cabinet
du ministre M., par deux fonctionnaires du service d'enquête du Comité
supérieur de contrôle, agissant en exécution de devoirs prescrits par le juge
d'instruction chargé des poursuites engagées contre M. Javeau. Cette audition
fut consacrée essentiellement aux relations entre M. Javeau et le cabinet du
ministre M. et au fonctionnement du cabinet. Elle porta notamment sur trois
conventions datées du 15 juin 1989 conclues entre la Région bruxelloise et
l'association « I ». Le procès-verbal de cette audition relate cet
aspect de l'audition en ces termes :
« Q [Question] : Le
17/05/89, Javeau a fait parvenir au cabinet un projet de convention relatif à
une pré-étude à réaliser auprès des PME bruxelloises pour un montant de
4 800 000 BEF HTVA. L'étude devait permettre d'établir la liste
des entreprises :
– à vocation à
l'exportation
– à vocation de
sous-traitance
– qui reçoivent une
aide de la Région bruxelloise ;
quelques jours plus tard, vous
signaliez à Javeau que son projet de convention avait été transmis pour examen
à l'administration (annexes 116 à 122 du même rapport). Aviez-vous des
instructions pour agir dans ce sens ? Vous êtes-vous renseigné sur les
possibilités d'appel à la concurrence pour la réalisation d'une telle banque de
données ?
R [Réponse] : Je n'avais aucune instruction en
ce sens. Quant aux renseignements à prendre au niveau d'appel à la concurrence,
j'ai laissé ce soin à l'administration, pour les raisons que j'ai déjà évoquées
antérieurement.
(...)
Q : Quelle est la
procédure à suivre en cas d'avis défavorable de l'Inspecteur des Finances
concernant un projet ?
R : Je sais
aujourd'hui qu'il était possible de s'adresser au Conseil des Ministres
régionaux pour arbitrage ; à l'époque, j'ignorais cette procédure et
personne ne m'en a parlé. Il faut savoir que ma volonté était de faire avancer
les dossiers et que l'avis de l'Inspection des Finances, en l'occurrence de L.,
avait un caractère fort réglementaire et peu tourné vers la rentabilité. En
substance, j'étais agacé par la lourdeur et l'immobilisme de l'Inspection des
Finances. Au sein de mon cabinet, il m'a été conseillé d'agir autrement, à
savoir de scinder le contrat en trois, afin que les montants soient inférieurs
au montant de 1 250 000 BEF seuil d'intervention obligatoire de
l'Inspecteur des Finances. Je tiens à préciser que malgré cette façon d'opérer,
j'ai à nouveau soumis le projet scindé à l'Inspecteur des Finances qui, cette
fois, a rendu un avis favorable.
Q : Nous vous
soumettons trois conventions conclues le 15/06/89 entre la Région bruxelloise
représentée par le ministre M. et l'association « I » représentée par
Javeau (cfr annexes 100 à 111 du rapport
d'expertise). Chacune de ces conventions a pour objet une pré-étude à réaliser
auprès des PME bruxelloises en vue de déterminer celles qui seraient
intéressées à figurer dans une banque de données telle que décrite dans le
projet initial. Chacune des conventions concerne l'un des trois critères
précédemment énoncé. Elles représentent un coût total pour la pré-étude de
3 600 000 BEF HTVA à comparer au projet initial qui représentait
un coût de 4 800 000 BEF HTVA. Cette réduction ne
résulte-t-elle pas de la nécessité de diviser le projet initial en 3, puisqu'il
y avait 3 critères, tout en évitant que chacune des 3 conventions n'excède
1 250 000 BEF HTVA, seuil d'intervention de l'Inspecteur
des Finances.
R : Je tiens à
répondre ici que j'ai sollicité à nouveau l'avis de l'Inspection des Finances
malgré que l'on se trouvait dans chaque cas en dessous du seuil [de]
1 250 000 francs. Je tiens encore à faire remarquer que la scission
en trois projets a amené une réduction significative, soit 25 % du coût du
volume global.
Q : Par ailleurs
le fait que Javeau accepte d'effectuer le même travail pour
3 600 000 BEF ne démontre-t-il pas que la convention initiale
acceptée par le cabinet et l'administration était surévaluée ?
R : La réflexion
concernant le prix initial n'est pas fausse mais l'accord à
3 600 000 BEF doit probablement résulter d'un accord tri- ou
quadripartite entre le cabinet, l'Administration, l'Inspection des Finances et
l'association « I ». C'est une supposition car je ne me souviens plus
aujourd'hui des détails précis concernant ce dossier.
(...)
Q : Nous vous
soumettons le bulletin d'engagement relatif à l'une des conventions conclues
avec l'association « I » le 15 juin 89. Ce document porte la
signature pour engagement de
l'Inspecteur des Finances, M. L. en date du 30 juin 89. M. L. avait-il la
possibilité de s'opposer à la mise en œuvre de ce contrat, son avis semblant
n'avoir pas été sollicité avant la conclusion de la convention ?
R : Je rappelle
ici que je n'étais pas obligé de transmettre le dossier à L. compte tenu de son
montant. Mais, comme je travaillais plus avec l'Administration qu'avec le
Cabinet, celle-ci a transmis automatiquement, pour engagement, le bulletin ad hoc à l'Inspecteur des Finances. A
mon avis, M. L. a bien dû recevoir la convention avant sa passation.
Q : Nous vous
signalons qu'à la réception de ces trois conventions, l'Administration n'a
attribué qu'un seul numéro d'engagement pour l'une d'entre elles (cfr annexes 130 et 131 du même rapport). Nous vous
présentons une série d'autres documents qui indiquent que l'Administration a
cru erronément avoir affaire à un seul contrat, à tel point que lorsque
l'association « I » lui a adressé 3 factures relatives au payement
partiel de chacun des 3 contrats, P. a signalé à Javeau ce qu'il croyait être
une erreur de l'association « I ». En effet, il a demandé 3
exemplaires originaux de ce qu'il croyait être une même facture, lesquels ne
pouvaient porter 3 numéros différents (cfr annexes
130 à 136 du même rapport). L. n'a donc pu viser pour engagement qu'un seul
bulletin relatif à une seule convention ?
R : Oui, c'est un
fait. Mais ce n'est pas de ma responsabilité. La totalité de la gestion des
dossiers était du ressort de l'Administration.
(...)
Q : En ce qui
concerne la signature pour engagement de l'Inspection des Finances pour des
conventions d'un montant inférieur à son seuil d'intervention, était-il encore
possible que l'Inspecteur rende un avis d'opportunité ?
R : Il est vrai
que sur le plan du droit administratif, son visa ne semble pas requis pour de
tels engagements. Cependant, en ce qui me concerne, et compte tenu de mon
manque d'expérience en matière de technique budgétaire, j'ai préféré, en toutes
matières, recourir au visa de l'Inspecteur des Finances considérant qu'il
s'agissait ainsi pour moi d'une garantie de légalité provenant du conseiller
budgétaire du Ministre. Dès lors, si M. L. avait formellement refusé de signer
le bulletin d'engagement, je ne serais pas passé outre. Vous me dites qu'il y a
contradiction entre ce que je vous explique et la scission du projet initial
refusé par M. L. Je vous réponds qu'on m'a conseillé d'agir ainsi et que j'ai
veillé à ce que M. L. vise les trois nouvelles conventions.
Lecture faite, persiste et signe
avec nous. »
28. Par une lettre de soixante-quinze
pages datée du 30 juin 1994, le procureur général près la cour d'appel de
Bruxelles transmit au président de la Chambre des représentants « un
dossier faisant apparaître, à [son] avis des indices d'infraction à charge de
M. (...) Guy Coëme (...) ancien ministre ».
Cette lettre précisait : « Il s'agit, notamment, de faits de faux en
écritures et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et corruption, à
titre de coauteur, visés par les articles 66, 193, 196, 197, 213, 214, 246,
248, 491 et 496 du code pénal. Ces faits, pouvant d'ailleurs recevoir
d'autres qualifications, (...) auraient été commis à des époques où (il
exerçait) des fonctions ministérielles (...). Il en résulte que les
dispositions de l'article 103 de la Constitution sont susceptibles de trouver
application en l'espèce. »
Après une synthèse de l'affaire,
le dossier exposait les faits et les indices d'infraction imputés à M. Coëme, la période infractionnelle s'étendant du
30 mars 1981 au 8 décembre 1989. La lettre mettait en cause deux autres
ministres ou anciens ministres, ainsi que huit autres parlementaires, le
procureur général considérant cependant, en ce qui concerne six d'entre eux,
que les faits étaient vraisemblablement prescrits.
Le procureur général exposait
également un problème général de prescription de l'action publique. En effet,
l'article 25 de la loi-programme du 24 décembre 1993, entrée en vigueur le 31
décembre 1993, avait entraîné un allongement du délai de prescription de trois
à cinq ans et, selon le texte de cette disposition, cette modification
législative s'appliquait à « toutes les actions nées avant l'entrée en
vigueur de la loi, et non encore prescrites à cette date ». Le procureur
général estimait donc que : « Dans la présente affaire, tous les
faits infractionnels commis avant le 1er janvier 1988 sont, pour le
moins, prescrits. Pour les faits postérieurs à cette date commence à courir le
premier délai de prescription de trois ans, expirant le 1er janvier
1991. Le premier acte interruptif de prescription se situe en août 1989 et,
plus précisément, le 25 août 1989, date des réquisitions aux fins d'en informer
adressées au juge d'instruction. »
Le procureur général adressait
cette dénonciation au président de la Chambre des représentants pour permettre
à celle-ci « d'exercer les prérogatives qui lui sont dévolues par
l'article 103 de la Constitution ». A toutes fins utiles, il sollicitait
en outre la levée de l'immunité parlementaire des trois ministres mis en cause,
dont M. Coëme et le ministre M.
29. La Chambre des représentants, réunie
le 1er juillet 1994 en séance plénière, constitua, selon la règle de
la représentation proportionnelle, une commission spéciale. Celle-ci entendit
séparément le juge d'instruction, l'expert judiciaire et M. Coëme,
assisté de ses avocats.
Par délibérations du 8 juillet
1994, la commission spéciale recommanda à la Chambre des représentants
d'ordonner le renvoi de M. Coëme devant la Cour de
cassation et de ne pas ordonner celui des deux autres ministres. En ce qui
concerne le ministre M., elle s'exprima comme suit :
« La commission spéciale,
écartant tous autres moyens de droit invoqués, décide de recommander à la
Chambre des Représentants de conclure
– qu'il n'y a pas lieu
de renvoyer [le ministre M.] devant la Cour de cassation dans le cadre des
conventions IN B040, 050 et 060, et
– que pour les autres
faits, il n'y a pas lieu pour la Chambre des Représentants de se prononcer dans
le cadre de l'article 103 de la Constitution. »
30. La recommandation fut adoptée
exactement dans les mêmes termes par la Chambre des représentants, lors de sa
séance du 14 juillet 1994, par cent quarante voix contre trente-neuf, avec deux
abstentions.
31. A la suite de la décision de la
Chambre des représentants, le procureur général près la Cour de cassation estima
devoir, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir le
premier président de la Cour de cassation de désigner d'urgence un conseiller à
la Cour, en qualité de magistrat instructeur, avec mission de compléter et de
poursuivre l'instruction des faits, en étroite collaboration avec le juge
d'instruction saisi.
32. Par une ordonnance du 21 juillet 1994,
le premier président, faisant droit à ces réquisitions, désigna le conseiller
F. et le chargea de cette mission.
33. Le 9 mai 1995, le conseiller F.
communiqua les pièces de la procédure au procureur général près la Cour de
cassation pour réquisitions.
34. A la suite des élections tenues en
avril 1995, M. Hermanus exerça, à partir du 6 juin
1995, les fonctions de conseiller au sein du Conseil de la région de
Bruxelles-capitale.
Le 26 juin 1995, le procureur
général près la cour d'appel de Bruxelles demanda par une lettre adressée au
Conseil de la région de Bruxelles-capitale, « eu égard aux prescrits des
articles 59, al. 3 et 120 de la Constitution », de lui « faire
connaître si le Conseil [estimait] devoir requérir la suspension des poursuites
entamées alors que M. Hermanus n'était pas encore
revêtu des fonctions » de conseiller régional.
Le 10 juillet 1995, le Conseil
décida d'« autoriser » les poursuites contre M. Hermanus pour l'instruction de la cause devant une chambre
correctionnelle du tribunal de première instance de Bruxelles et de
« réserver sa décision quant à toutes autres formes de poursuites jusqu'à
plus ample informé, de manière à apprécier leur compatibilité avec l'exercice
de son mandat par l'intéressé ».
Le 25 septembre 1995, le
procureur général près la Cour de cassation demanda au président du Conseil de
la région de Bruxelles-capitale « de bien vouloir prier le Conseil de la
région de Bruxelles-capitale de statuer dans le meilleur délai sur la présente
demande d'autorisation de poursuites de M. Hermanus
devant la Cour de cassation ».
Sur avis de sa commission des
poursuites, le Conseil décida, en sa séance du 18 octobre 1995, de donner
l'autorisation demandée, estimant que « la connexité [était] constatée par
l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de
Bruxelles du 22 septembre 1995, intervenue après la décision du Conseil du 10
juillet 1995 ». Il estime également que « les questions de la
connexité, de la proportionnalité des faits et des conséquences du renvoi
devant la Cour de cassation et de la durée raisonnable de l'instruction de la
cause, relèvent de l'appréciation du juge du fond et que la commission des
poursuites n'a pas à se prononcer ».
35. Entre-temps, la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Bruxelles avait en effet pris, par ordonnance
non contradictoire du 22 septembre 1995, une décision de dessaisissement
du juge d'instruction désigné.
36. Outre M. Coëme,
le ministère public près la Cour de cassation décida de poursuivre devant cette
cour sept autres personnes, dont les quatre autres requérants. Il estimait que
l'enquête révélait un système de financement illégal d'activités de certains
hommes politiques. Il s'agissait de la conclusion, à charge d'autorités
publiques, de contrats dont les prix étaient surévalués de manière à permettre
au cocontractant de transférer à des tiers une partie du prix pour couvrir les
frais de ces activités. Selon lui, les pratiques concernées consistaient à
négocier et conclure des contrats pour des études ou sondages divers à réaliser
notamment par l'association « I » au « profit » de
ministères. Les budgets alloués, dans le cadre de ces contrats, étaient
surévalués par rapport au coût réel des études et sondages réalisés et au
bénéfice à en escompter. On veillait en outre à éviter la mise en concurrence
prévue dans les marchés passés par l'administration qui aurait pu empêcher
l'attribution de certains marchés à l'association « I », ainsi que
les contrôles internes à l'administration, principalement celui de l'inspection
des Finances, qui auraient pu révéler le caractère surévalué de certains prix.
Pour ce faire, on veillait à ce que les seuils qui entraînent l'application des
réglementations et circulaires en matière de marchés publics et de procédures
de contrôle interne à l'administration ne soient pas atteints. Le ministère
public reprochait aussi à certains prévenus (dont M. Javeau) le
remboursement frauduleux de certaines notes de frais. Il estimait enfin que
deux des requérants, MM. Stalport et Mazy, bien qu'ils n'aient pas profité de ces contrats,
avaient participé à leur élaboration.
37. Le 3 novembre 1995 à 11 heures, le
procureur général près la Cour de cassation reçut les conseils de cinq des
personnes mises en cause par l'enquête, dont MM. Coëme
et Javeau, pour les aviser des mesures prises pour l'organisation du procès. Le
procureur général remit aux participants à la réunion une copie de la citation
qu'il se proposait de faire signifier à leurs clients. Il aurait proposé de tenir
une audience début janvier 1996. A la suite des protestations des avocats, il
aurait reculé l'ouverture des débats au 5 février 1996, en dépit des
réserves formulées verbalement par les avocats quant au trop court délai qui
leur était imparti pour préparer la défense de leurs clients respectifs. Il
aurait aussi précisé que les débats devant la Cour de cassation suivraient la
procédure correctionnelle ordinaire.
M. Stalport
ne fut pas invité à cette réunion. Il a expliqué qu'il n'avait, à l'époque,
consulté aucun avocat, ne s'estimant pas mis en cause.
38. Par exploits d'huissier signifiés
entre le 8 et le 15 novembre 1995, les huit personnes mises en cause par le
ministère public près la Cour de cassation furent citées à comparaître devant
cette cour, en date du 5 février 1996, pour y répondre de diverses préventions
commises dans le cadre de conclusions de marchés publics confiés à
l'association « I », alors que M. Coëme
était membre du gouvernement.
Seul M. Coëme
était concerné par l'article 103 de la Constitution, les autres inculpés étant
invités à comparaître, sur le fondement des articles 226 et 227 du code
d'instruction criminelle, en raison de la connexité entre les faits qui leur
étaient reprochés et ceux imputés à M. Coëme.
39. Par exploit d'huissier signifié le 10
novembre 1995, M. Stalport fut invité à comparaître
devant la Cour de cassation sous les préventions de faux en écritures, corruption
de fonctionnaire et escroquerie commises dans le cadre de conclusions de
marchés publics auxquels il avait été associé en qualité de chef de cabinet du ministre M.,
lequel n'avait pas été renvoyé devant la Cour de cassation par la Chambre des représentants.
Dans la citation, les faits qui lui étaient reprochés étaient précisés comme
suit :
« A. les premier
(Coëme), deuxième (Javeau), troisième (V.), quatrième
(Hermanus), cinquième (Stalport),
sixième (H.) et septième (Mazy)
étant fonctionnaire ou officier
public ou coauteur d'un fonctionnaire ou officier public,
avec une intention frauduleuse ou
à dessein de nuire, en rédigeant des actes de son ministère, dénaturé leur
substance ou leurs circonstances, soit en écrivant des conventions autres que
celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant
comme vrais des faits qui ne l'étaient pas, pour notamment :
(...)
3) Les deuxième
(Javeau) et cinquième (Stalport)
le cinquième étant chef de
cabinet du ministre de la Région bruxelloise, dans l'intention frauduleuse de
permettre l'attribution d'un marché en contournant les règles et procédures
relatives aux marchés publics et plus spécialement dans l'intention d'éluder le
contrôle de l'Inspection des Finances, avoir substitué ou fait substituer à une
convention ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'Inspection des
Finances, trois conventions datées du 15 juin 1989 chacune d'un
montant inférieur au seuil d'intervention de l'Inspection des Finances mais
ayant ensemble le même objet que celle qui avait été rejetée, en l'espèce,
notamment, une étude portant sur les petites et moyennes entreprises ;
(contrats IN B 040, B 050 et B
060 – voir notamment : RE, T. IV, p. 13 à 19 et annexes 100 à 111 : C
5, f 2 p. 179 : C 12, f 5, p. 2 et 4). »
40. Le 18 janvier 1996, les conseils de
divers prévenus adressèrent à la Cour de cassation une demande de remise de
l'affaire à une audience ultérieure, faisant valoir qu'il leur était impossible
malgré tous leurs efforts d'assurer correctement la préparation de la défense
de leurs clients.
41. Dès l'ouverture de l'audience du 5
février 1996, le premier président de la Cour de cassation annonça que
l'instruction se ferait conformément aux dispositions de l'article 190 du code
d'instruction criminelle.
L'audience fut consacrée à une
demande de report des débats formulée par plusieurs prévenus afin de disposer
du temps nécessaire pour assurer leur défense dans le respect de leurs droits.
Ces personnes déposèrent des conclusions à cette fin. Par un arrêt
interlocutoire du 6 février 1996, la Cour de cassation estima que ces prévenus
avaient disposé du temps nécessaire à la préparation de leur défense aux plans
tant pénal que civil.
42. A l'audience du 6 février 1996, M. Coëme déposa des premières conclusions relatives à
l'absence d'une loi d'exécution de l'article 103 de la Constitution, malgré la
volonté expresse affichée par le Congrès national. Cette carence législative avait
fait perdurer la disposition, conçue comme transitoire, adoptée par le Congrès
national en vue de combler le vide juridique : l'article 134, alinéa 1er,
de la Constitution devenu ultérieurement la disposition transitoire de
l'article 103.
Il releva d'abord que, si la
modification constitutionnelle du 5 mai 1993 avait remplacé les mots « en
caractérisant le délit et en déterminant la peine » contenus dans la
disposition transitoire de l'article 103 de la Constitution par les mots
« dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines
qu'elles prévoient », cette modification constitutionnelle ne pouvait
avoir d'effet rétroactif pour les préventions mises à sa charge relatives à des
faits se situant entre le 29 mars 1981 et le 30 novembre 1990, à peine de
violer notamment l'article 7 § 1 de la Convention.
Il ajouta que si la disposition
transitoire donnait à la Cour de cassation un pouvoir discrétionnaire pour
juger les ministres accusés par la Chambre des représentants en ce qui concerne
leur responsabilité et les peines à infliger, la disposition ne conférait ni à
la Cour de cassation ni à la Chambre des représentants un pouvoir analogue
concernant le mode de procéder contre eux. En conséquence, la Cour de cassation
avait fixé elle-même, d'autorité, les règles de procédure applicables, au
mépris du principe de la légalité de la procédure du tribunal.
43. Lors de l'audience du 6 février 1996,
M. Coëme déposa des deuxièmes conclusions relatives à
la procédure suivie par la commission spéciale de la Chambre des représentants
et à la saisine de la Cour de cassation.
44. A l'audience du 7 février 1996, M. Stalport déposa des conclusions selon lesquelles aucune
disposition de droit belge ne permettait son renvoi direct devant la Cour de
cassation. Dans de nouvelles conclusions, il exposait en outre qu'il n'existait
aucune connexité entre l'infraction à sa charge et celle à charge de M. Coëme. Il ajoutait que, si la Cour de cassation devait
estimer le contraire, elle devrait alors saisir la Cour d'arbitrage d'une
question préjudicielle relative à la violation des principes d'égalité et de
non-discrimination de dispositions légales déférant à la Cour de cassation un
prévenu n'ayant pas la qualité de ministre. Il invitait donc la Cour à se
déclarer incompétente pour le juger à défaut de connexité ou, subsidiairement,
de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante :
« Les articles 226 et 227 du
Code d'instruction criminelle en tant qu'ils ont pour effet de déférer à la
Cour de cassation, statuant au fond, le jugement d'un prévenu qui n'a pas la
qualité de ministre, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution
combinés avec les articles 12, 13 et 147 de la Constitution ? »
45. A l'audience du 8 février 1996, M. Coëme déposa des troisièmes conclusions dans lesquelles il
demandait à la Cour de cassation de surseoir à statuer sur le fondement des
réquisitions du ministère public jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait statué
sur la question préjudicielle suivante :
« L'allongement du délai de
prescription de l'action publique résultant de l'article 21 de la loi du
17 avril 1978 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, tel
qu'il a été modifié par l'article 25 de la loi du 24 décembre 1993, en tant
qu'il s'appliquerait à toutes les actions publiques nées avant son entrée en
vigueur et non encore prescrites à cette date, et instaure des délais plus
longs, crée-t-il une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la
Constitution, par rapport à la situation de ceux qui connaissent, en fonction
de la date à laquelle les faits ont été commis, le délai de prescription du
susdit article 21 ancien ? »
46. Au début de l'audience du 12 février
1996, le premier président donna lecture de l'arrêt interlocutoire par lequel
la Cour de cassation se déclarait régulièrement saisie et compétente et disait
n'y avoir pas lieu à poser à la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles
proposées par les prévenus à propos de la connexité. La Cour de cassation
motiva son arrêt en indiquant que : « la disposition transitoire de
l'article 103 de la Constitution est (...) d'application aussi bien pour les
faits postérieurs à la modification constitutionnelle du 5 mai 1993 que pour
les faits antérieurs à celle-ci. » La Cour de cassation ajouta que le
pouvoir discrétionnaire qui lui était reconnu était limité puisqu'elle était
obligée de suivre certaines normes de procédure et elle ajouta ces
attendus :
« Attendu que, tenue de
juger, la Cour doit se conformer quant au mode de procéder, aux dispositions
d'application directe dans l'ordre juridique interne, contenues dans la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et
dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la
Constitution, aux règles du Code judiciaire, aux dispositions communes
applicables à toutes les procédures pénales et aux principes généraux du droit
;
Attendu qu'en donnant à la Cour
le pouvoir de juger les ministres « dans les cas visés par les lois
pénales », le Constituant s'est référé nécessairement, quant au mode de
procédure, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir au
Code d'instruction criminelle, pour autant qu'il soit compatible avec les
dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant chambres
réunies.
Attendu que, dans cette mesure,
la Cour applique les formes prescrites par le Livre II, Titre premier,
Chapitre II, du Code d'instruction criminelle intitulé « Des tribunaux
correctionnels » ;
Que, légales, accessibles et
prévisibles, ces règles garantissent le plein exercice des droits de la défense
et un procès équitable ;
Qu'en appliquant des règles
existantes, la Cour ne fait pas œuvre de législateur. »
47. La Cour de cassation se prononça en
ces termes sur la connexité et les questions préjudicielles qui s'y
rapportaient :
« De la connexité :
Attendu que les dispositions des articles
226 et 227 du code d'instruction criminelle ne sont pas l'expression d'un
principe général du droit, mais constituent une règle qui est commune et
applicable à toute procédure pénale ;
Attendu que la connexité ne doit
pas nécessairement avoir été constatée au préalable par une juridiction
d'instruction ;
Que le juge du fond, saisi par un
renvoi ou par une citation directe réguliers, apprécie lui-même l'existence de
la connexité et, partant, l'étendue de sa saisine et de sa compétence quant aux
infractions connexes ;
Attendu que la connexité a pour
effet que tous les coauteurs ou complices d'infractions connexes sont jugés
ensemble par la même juridiction ; qu'il s'ensuit que lorsqu'il y a
connexité entre des faits délictueux reprochés à un ministre et des faits mis à
charge d'autres justiciables, la compétence attribuée par la Constitution à la
Cour de cassation emporte l'attribution de toute la poursuite à cette
juridiction qui est de l'ordre le plus élevé ;
Attendu que l'article 147 de la
Constitution délimite les pouvoirs de la Cour quand celle-ci statue sur les
pourvois en cassation ;
Que les pouvoirs de la Cour pour
juger les ministres emportent, par l'effet de la connexité, ceux de juger
d'autres justiciables dont elle est, en cette circonstance, à l'exclusion de
tout autre, le juge que la loi leur assigne conformément à l'article 13 de la
Constitution ;
Attendu que les règles de la
connexité, qui sont d'application générale, n'entraînent pas de distinction
arbitraire dans le traitement des personnes poursuivies, au sens de l'article
14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Attendu que, pour le surplus, la
Cour aura à apprécier, lors de l'examen du fond, s'il existe un lien de
connexité entre les infractions mentionnées dans la citation, qu'il convient à
cet égard de lier l'incident au fond ;
(...)
De la discrimination et des
questions préjudicielles :
Attendu que les prévenus
allèguent que dans la mesure où ils seraient attraits devant la Cour en vertu
des règles de la connexité, cette situation créerait une discrimination
prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution ;
Qu'ils demandent que soient
posées à la Cour d'arbitrage des questions préjudicielles tendant à ce qu'elle
dise si les articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, en tant
qu'ils ont pour effet de déférer à la cour de cassation statuant au fond le
jugement d'un prévenu qui n'a pas la qualité de ministre, violent les articles
10 et 11 de la Constitution ; que le prévenu Stalport
formule la même question en se référant aux mêmes articles de la Constitution
combinés avec les articles 12, 13 et 147 de celle-ci ;
Qu'en outre, le prévenu Javeau
demande que soit posée à la Cour d'arbitrage la question relative à un conflit
entre les articles 10 et 11 de la Constitution et les articles 226, 227, 479 et
501, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, tandis que les prévenus V., Hermanus et Mazy demandent que
soit posée la question relative au conflit entre les articles 10 et 11 précités
et les articles 226, 227, 307, 501, alinéa 2, 526, 540 du Code d'instruction
criminelle, et 30, 31, 566, 753, 856, 1053, 1084 et 1135 du Code judiciaire
« en tant qu'ils consacreraient des principes généraux du droit qui
permettraient à la Cour de cassation de connaître des poursuites » ;
Attendu qu'à supposer que la
privation de la possibilité de se défendre devant les juridictions
d'instruction, et la privation d'un double degré de juridiction, ainsi que d'un
recours en cassation constituent une violation des articles 10 et 11 de la
Constitution, ceux-ci seraient violés, non par les articles visés dans les
conclusions, mais par l'article 103 de la Constitution, conférant compétence à
la Cour de cassation pour juger les ministres dans les conditions que cette
disposition constitutionnelle détermine ;
Attendu que l'article 26 § 1er,
3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose que
cette Cour statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions
relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visés à
l'article 134 de la Constitution, des articles 10, 11 et 24 de
celle-ci ;
Attendu que les demandes des
prévenus ne rentrent pas dans le champ d'application dudit article 26. »
48. Après le prononcé de cet arrêt, un des
conseils des prévenus, s'exprimant au nom de l'ensemble de la défense, fit
remarquer que la Cour de cassation fixait elle-même les règles de procédure
applicables et exprima ses plus nettes réserves en se référant à l'article 6 de
la Convention. Il demanda également si elle envisageait de faire procéder,
conformément à l'alinéa 2 de l'article 190 du code d'instruction criminelle, à
la lecture par le greffier des 30 000 pages qui constituaient le dossier,
en expliquant que si l'on faisait référence aux usages du tribunal
correctionnel, il ne convenait pas d'en appliquer certains points et pas
d'autres. La Cour de cassation ne donna pas suite à cette demande.
49. Au cours de l'audience du 12 février
1996, le procureur général présenta ensuite un exposé de l'affaire, qui se
poursuivit le 13 février 1996. Au début de son exposé, il s'exprima notamment
en ces termes :
« J'examinerai les faits mis
à charge de M. Coëme ainsi que les faits et
préventions mis à charge de M. Javeau et de V. mais, en ce qui concerne ces
deux derniers prévenus, dans la mesure uniquement où ces faits et préventions
sont étroitement liés à ceux qui sont reprochés à M. Coëme.
M. le premier avocat général
quant à lui vous entretiendra des autres faits et préventions mis à charge de
M. Javeau et de V. ainsi que ceux reprochés à M. Hermanus. »
50. Selon MM. Javeau et Stalport, le premier président de la Cour de cassation
aurait, à un moment donné, interrompu l'exposé du premier avocat général en lui
rappelant qu'il ne s'agissait pas, à ce stade des débats, d'un réquisitoire.
51. Le 16 février 1996, la Cour de
cassation commença l'interrogatoire des accusés et prévenus. Elle entendit
également les parties quant à l'établissement d'un calendrier pour la poursuite
de ses travaux et l'ordre du déroulement des débats. A cette occasion, le
ministère public proposa d'entendre la défense avant le réquisitoire. Après
délibérations, le premier président déclara que la Cour de cassation avait fixé
« la poursuite des débats
dans l'ordre ci-après :
1. poursuite de
l'interrogatoire des accusés et prévenus,
2. plaidoirie de la
partie civile,
3. réquisitoire du
ministère public,
4. intervention de la
défense,
5. répliques
éventuelles ».
52. Le 20 février 1996, M. Stalport fut entendu, en même temps que M. Javeau, à
propos des faits qui lui étaient reprochés.
Le procès-verbal de l'audience du
20 février porte les mentions suivantes :
« A l'audience publique du
20 février 1996 de la Cour de cassation, siégeant chambres réunies, en la salle
de ses audiences solennelles, où étaient présents et siégeaient :
Le premier président Stranard, le président D'Haenens,
le président de section Marchal, les conseillers Ghislain, Rappe
et Charlier, le président de section Baeté-Swinnen, les conseillers Willems, Lahousse,
Jeanmart, Verheyden, Verougstraete,
Forrier, Boes, D'Hont, Waûters, Dhaeyer, Bourgeois et Huybrechts ;
le procureur général baron J. Velu, le premier avocat général du Jardin, le
greffier en chef Vander Zwalmen, assisté du greffier Sluys et du greffier délégué Van Geem,
(...)
Le prévenu Stalport
déclare : J'ai été entendu pour la première et dernière fois le 16 mars
1994, dans le cadre d'une procédure mettant en cause [le ministre] M. ; on
m'a dit que j'étais entendu comme témoin, et que je ne devais pas être
confronté ; à aucun moment, je n'ai eu l'occasion de faire valoir mes
moyens. Je confirme les déclarations que j'ai faites à l'occasion de cette
audition.
(...)
Question à Stalport :
Est-il exact qu'à la réception de
ce projet vous avez transmis sans autre formalité le projet à l'administration
pour examen et qu'après avis favorable de celle-ci vous avez soumis le dossier
à l'inspecteur des finances le 23 mai 1989 ?
Réponse de Stalport :
Oui, le projet faisait partie
d'un ensemble soumis à l'administration qui portait sur une somme globale de 20
millions. C'est ce moment [montant] qui a causé l'avis défavorable, aussi en
raison des divergences entre les avis de l'administration et l'inspection des
finances.
(...)
Question à Stalport :
Quel est, selon vous, le motif
pour lequel ont été signées le 15 juin 1989, en dépit de l'avis
négatif de l'inspection des finances, trois conventions qui font l'objet de la
prévention et qui ont exactement, pour l'ensemble, le même objet, chacune étant
toutefois limitée au montant de 1 200 000 francs ?
Réponse de Stalport :
Après le refus j'ai interrogé le
ministre. Il m'a confirmé l'opportunité politique de poursuivre. J'ai cherché
une solution moins chère. Quelques semaines plus tard mes collaborateurs m'ont
présenté un nouveau projet.
Question à Javeau :
Cela ne démontre-t-il pas que le
[prix] de départ de 4 800 000 frs était surévalué ?
Réponse de Javeau :
Non, Stalport
a bien répondu, on a modifié le projet.
Question à Stalport :
La procédure en vigueur,
n'imposait-elle pas au ministre en présence du refus de visa de l'inspecteur
des finances de recourir à l'arbitrage du ministre du budget et dans
l'hypothèse où celui-ci aurait également émis un avis négatif d'user de la
possibilité de porter l'affaire devant le Conseil des ministres qui aurait
tranché en dernier ressort ?
Réponse de Stalport :
M. était également ministre du budget.
On a voulu se lancer dans un projet beaucoup plus limité, on a fait une
pré-étude. J'estime que la solution du saucissonnage n'a pas été adoptée pour
échapper au contrôle des finances. Si on avait suivi les procédures
administratives, le projet n'aurait pas pu être initié. Ma fonction de chef de
cabinet m'imposait de faire en sorte que les choses aillent vite. Si on n'a pas
suivi la procédure classique, il y a toutefois eu un contrôle des finances.
(...)
Question à Stalport :
Qui a décidé au niveau du cabinet
de passer outre à l'avis négatif de l'inspecteur des finances et de scinder la
convention de manière à ne pas être lié par l'avis en question ?
Réponse de Stalport :
La décision de poursuivre a été
prise par le ministre, la solution ayant consisté à réduire la portée du projet
initial. Quel que soit le montant engagé, l'inspection des finances avait un
pouvoir de contrôle et d'avis. Même si la convention était limitée au point de
vue financier, elle restait correcte au niveau de la transparence.
(...)
Question à Stalport :
Vous avez déclaré en substance
(p. 9540) que vous étiez agacé par la lourdeur et l'immobilisme de l'inspection
des finances et qu'au sein de votre cabinet, il vous a été conseillé d'agir
autrement à savoir de scinder le contrat en trois afin que les montants soient
inférieurs au montant de 1 250 000 francs, seuil d'intervention
obligatoire de l'inspecteur des finances et vous avez ajouté que malgré cette
façon d'opérer vous aviez à nouveau soumis le projet scindé à l'inspecteur des
finances qui cette fois a rendu un avis favorable et que la scission en trois
du projet avait amené une réduction significative de 25 % du coût du volume
global. Confirmez-vous cette appréciation de votre comportement ?
Réponse de Stalport :
Oui, car la procédure de
l'inspection des finances durait un certain temps ; on voulait travailler
vite et on est revenu à une autre procédure, ayant toutefois un visa de
l'inspection des finances, plus rapide, mais qui maintenait le contrôle ;
je disposais de peu de temps et il fallait trouver une solution en ayant
recours à une procédure plus rapide, celle du visa sur le bulletin
d'ordonnancement. Je savais qu'il fallait rendre compte au ministre : j'ai
insisté pour que l'inspection des finances appose sa signature dans chaque
dossier et cela a été fait même pour ceux où ce n'était pas obligatoire.
Question à Stalport :
Avez-vous eu connaissance de la
note adressée à C. ministre de l'Exécutif de la Région de Bruxelles Capitale le
11 septembre 1989 par L., Inspecteur général des finances (p. 9270) et
concluant au caractère tout à fait contestable de la poursuite de l'exécution
des trois conventions et au blocage des paiements de toutes factures par la
Région même en présence de factures régulièrement établies d'un point de vue
formel ?
Réponse de Stalport :
J'ai eu connaissance a posteriori
des reproches de L. Je ne sais pas si L. ne connaissait qu'une seule
convention. Dans les reproches, je pense qu'il fait référence à trois
conventions de 1,5 million. Il était donc au courant qu'il y avait trois
conventions.
Sur interpellation Javeau
déclare : le saucissonnage répondait à des contingences réelles.
S.I. du premier avocat
général : L'administration a réceptionné trois conventions et n'a effectué
qu'un seul engagement croyant qu'il s'agissait de trois exemplaires d'une seule
convention. Stalport se souvient-il de cette
équivoque qui s'est répétée pour les trois conventions ?
Réponse de Stalport :
On m'aurait signalé l'erreur mais
je n'étais plus là depuis le 18 juin 1989. »
53. Le 4 mars 1996, M. Stalport
déposa de nouvelles conclusions selon lesquelles il n'existait aucune connexité
entre les faits retenus à sa charge et ceux à charge de M. Coëme
et qu'il y avait donc lieu de le renvoyer devant son juge naturel, le tribunal
correctionnel.
54. Au cours des débats, M. Hermanus demanda, pour sa part, à la Cour de cassation de
poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage concernant la
prescription de l'action publique. Il demandait qu'à défaut la Cour de
cassation constatât la prescription de l'action publique à son égard. Il
souleva en outre qu'il n'existait aucun lien de connexité entre les faits qui
lui étaient reprochés et ceux reprochés à M. Coëme.
Il fit aussi valoir un dépassement du « délai raisonnable » pour
l'examen de sa cause. Sur le fond, il soutenait qu'il avait agi sans intention
délictueuse.
55. La Cour de cassation rendit son arrêt
le 5 avril 1996. Elle décida d'abord qu'il existait un lien de connexité avec
les faits reprochés à M. Coëme et ceux imputés
aux autres prévenus en se prononçant comme suit :
« Attendu qu'au sens des
articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, la connexité est le lien
qui existe entre deux ou plusieurs infractions et dont la nature est telle
qu'il commande, en vue d'une bonne administration de la justice et sous réserve
du respect des droits de la défense, que les causes soient jugées ensemble et
par le même juge, celui-ci pouvant ainsi apprécier la matérialité des faits
sous tous leurs aspects, la régularité des preuves et la culpabilité de chacune
des personnes poursuivies ;
Attendu que l'accusé et les
prévenus sont poursuivis simultanément pour des faits qui ont été révélés par la
même instruction ; que ces faits font partie d'un système géré par Camille
Javeau, plaçant l'association « I » à la conjonction des intérêts financiers de
la recherche scientifique et des intérêts personnels de ses dirigeants et de
tiers ; que de l'aveu de Camille Javeau, ce système consistait à rechercher la
conclusion de conventions avec les pouvoirs publics portant sur des études à
réaliser par l'association « I. » ou par l'institut [...], en
accompagnant les contrats d'avantages destinés à des hommes politiques dont le
pouvoir de décision, l'influence ou l'avenir présumé devaient assurer
l'efficacité et la continuité dudit système ;
Que tous les faits mis à charge
de l'accusé et des prévenus s'inscrivent dans ce système en manière telle qu'il
existe entre ces faits un lien justifiant l'application des articles 226 et 227
du Code d'instruction criminelle ;
Attendu qu'à supposer que cette
application ait pu entraîner, en l'espèce, tous les inconvénients et
désavantages dont les prévenus se plaignent, elle n'a pas entravé le plein
exercice de leur droit de contester la recevabilité des poursuites et le
bien-fondé des préventions mises à leur charge, de faire valoir tous leurs
moyens de défense et de présenter à la Cour toutes demandes qu'ils auraient estimées
utiles au jugement de leur cause. »
56. La Cour de cassation refusa en outre
de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle concernant la
prescription en exposant :
« Attendu que Guy Coëme soutient en conclusions que l'allongement du délai de
prescription « en tant qu'il s'appliquerait à toutes les actions publiques
nées avant son entrée en vigueur et non encore prescrites à cette date, et
instaure des délais plus longs, crée une discrimination contraire aux articles 10
et 11 de la Constitution, par rapport à la situation de ceux qui connaissent,
en fonction de la date à laquelle les faits ont été commis, le délai de
prescription de l'article 21 ancien » ;
Que Jean-Louis Mazy soutient que la loi établissant le nouveau délai de
prescription s'applique à toute action née avant sa date d'entrée en vigueur et
non encore prescrite à cette date, et que, partant, l'extinction de l'action
publique par prescription dépend de la date des actes interruptifs ; qu'il
en déduit qu'en l'espèce l'application des articles 25 et 26 de la
loi-programme du 24 décembre 1993 crée une discrimination prohibée par les
articles 10 et 11 de la Constitution ;
Que Merry
Hermanus soutient également que « seule la date
des actes interruptifs de prescription dicte en ce qui le concerne
l'application de la loi nouvelle ou le maintien de l'application de la loi
ancienne » ;
Attendu que l'accusé et les
prévenus précités demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, que la
Cour pose à la cour d'arbitrage une question préjudicielle relative à un
conflit existant, selon eux, entre les articles 10 et 11 de la Constitution et
l'article 25 de la loi du 24 décembre 1993 allongeant les délais de
prescription ;
Qu'il appert de ces conclusions
que l'inégalité de traitement dont ils se plaignent résulte, selon les
intéressés eux-mêmes, uniquement de la date à laquelle des actes d'instruction
ou de poursuite ont été accomplis et de l'effet de tels actes sur le cours de
la prescription, mais non des dispositions de l'article 25 de la loi du 24
décembre 1993 ;
Qu'ainsi ils critiquent non une
distinction que créerait cette loi, mais les effets découlant nécessairement de
toute application de la loi de procédure pénale dans le temps ;
Attendu que les questions soulevées
ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 26 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la cour d'arbitrage et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de
les poser ; »
57. La Cour de cassation constata par ailleurs
que l'action publique n'était pas prescrite à l'égard de MM. Coëme et Hermanus, en
s'expliquant comme suit :
« Attendu qu'une loi
nouvelle a, en matière de procédure pénale, un effet immédiat de sorte qu'elle
s'applique à toutes les actions publiques nées avant la date de son entrée en
vigueur et non encore prescrites à cette date en vertu de la loi
ancienne ;
Que les délits non prescrits le
31 décembre 1993 le seront, sauf cause de suspension de la
prescription, à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir des faits,
éventuellement prolongé d'un nouveau délai de cinq ans à partir d'un acte
interruptif régulièrement accompli avant l'expiration du premier délai de cinq
ans ;
Attendu que la prescription de
l'action publique, étant l'extinction par l'écoulement d'un certain temps du
pouvoir de poursuivre un prévenu, dictée par l'intérêt de la société, les lois
de prescription ne touchent pas au fond du droit ; que lorsqu'elles allongent
le délai de prescription, elles n'ont pas pour effet d'aggraver la peine
applicable au moment où l'infraction a été perpétrée ni de réprimer une action
ou une omission qui, au moment où elle a été commise, n'était pas punissable ;
que les articles 7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés Fondamentales et 15 du Pacte International relatif aux droits civils
et politiques ne leur sont pas applicables ;
Attendu que c'est à la date du
jugement qu'il y a lieu de se placer pour apprécier en définitive la
prescription de l'action publique et que la nature de l'infraction se détermine
non d'après la peine applicable, mais d'après la peine appliquée ; que dès
l'origine la prescription de l'action publique relative à un fait constituant
en principe un crime peut être influencée par la peine appliquée ; que dans
l'hypothèse où la Cour, après avoir déclaré établis les faits de faux et
d'usage de faux, admettrait des circonstances atténuantes, dénaturant ainsi ces
crimes et leur imprimant le caractère de délit, le délai de prescription de ces
infractions serait celui des délits, c'est-à-dire de cinq ans ;
Attendu que, si plusieurs faits
délictueux sont l'exécution successive d'une même résolution criminelle et ne
constituent ainsi qu'un seul délit, celui-ci n'est entièrement consommé et la
prescription de l'action publique ne commence à courir, à l'égard de l'ensemble
des faits qu'à partir du dernier de ceux-ci, à condition, toutefois, que chaque
fait délictueux antérieur ne soit pas séparé du fait délictueux ultérieur par
un laps de temps plus long que le délai de prescription applicable, sauf
interruption ou suspension de la prescription ;
(...)
Attendu que les faits reprochés à
l'accusé et au prévenu se situent :
– pour G. Coëme entre le 29 mars 1981 et le 1er décembre
1989, le dernier fait datant du 30 novembre 1989 ;
(...)
– pour M. Hermanus entre le 1er décembre 1987 et le 1er
mars 1988, le dernier fait datant du 29 février 1988 ;
(...)
Attendu que ces faits, à les
supposer établis, constituent l'exécution d'une même résolution
délictueuse ; que, pour chacun des intéressés, la prescription de l'action
publique ne commence à courir, à l'égard de l'ensemble des faits qui les
concernent, qu'à partir du dernier de ceux-ci, qui en l'espèce n'est pas séparé
des autres par un laps de temps plus long que le délai de prescription en
vigueur ;
Attendu que la loi du 24 décembre
1993 portant de trois à cinq ans le délai de prescription de l'action publique
relatif aux délits et, par conséquent, aux crimes correctionnalisés, est
applicable à l'accusé et aux prévenus, la prescription de trois ans n'étant pas
atteinte lors de l'entrée en vigueur de ladite loi et ayant été valablement
interrompue en ce qui concerne l'accusé et les prévenus, le 22 février 1991 par
le procès-verbal no 480 (p. 14690) du Comité supérieur de contrôle,
acte d'instruction accompli pendant l'ancien délai de trois ans ;
(...)
Qu'en conséquence, le délai
originaire de prescription de cinq ans a pris cours :
– à l'égard de G. Coëme le 30 novembre 1989 ;
(...)
– à l'égard de M. Hermanus le 29 février 1988 ;
Attendu que ce délai a été
valablement interrompu le 10 juin 1992 par le procès-verbal no 2337
du Comité supérieur de contrôle ;
Qu'il s'ensuit que l'action
publique n'est prescrite pour aucun des faits visés par la citation. »
58. La Cour de cassation déclara établis
la plupart des faits reprochés à M. Coëme et
condamna ce requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans, avec sursis à
l'exécution pendant une période de cinq ans, et à une amende de 1 000 BEF,
portée à 60 000 BEF. Elle lui interdit également d'exercer tous les droits
énumérés à l'article 31 du code pénal pour un terme de cinq ans et le condamna
solidairement avec un autre prévenu à payer à la partie civile, l'association
« I », les sommes de 476 000 BEF, 31 970 BEF et 42 070
BEF.
59. La Cour de cassation déclara établies
les préventions retenues à charge de M. Mazy et le
condamna à une peine d'emprisonnement de neuf mois, avec sursis à l'exécution
pendant une période de trois ans, et à une amende de 500 BEF, portée à
30 000 BEF.
60. La Cour de cassation condamna M. Stalport à une peine d'emprisonnement de six mois, avec
sursis à l'exécution pendant une période d'un an, et à une amende de 26 BEF,
portée à 1 560 BEF, après avoir déclaré établie la prévention retenue à sa
charge en se fondant sur les constatations suivantes :
« Attendu que le 30 mai
1989, l'inspection des Finances a émis un avis défavorable (p. 18684) sur
un projet de convention par laquelle l'association « I » s'engageait
à effectuer, pour la Région bruxelloise « une pré-étude auprès de toutes
les entreprises bruxelloises », le coût global de l'étude s'élevant à
4 800 000 francs hors TVA (p. 18689 à 18694) ;
Attendu que le 15 juin 1989 ont
été signées par M. représentant la Région bruxelloise et Camille Javeau
représentant l'association « I », trois conventions, chacune d'un
coût forfaitaire de 1 200 000 francs (p. 18699 à 18710) ;
Que par ces conventions,
l'association « I » s'engageait à effectuer une
« pré-étude » :
a) « auprès des
PME à vocation de sous-traitance » (1ère convention)
b) « auprès de
toutes les entreprises aidées par la Région bruxelloise » (2ème
convention)
c) « auprès des
PME à vocation à l'exportation » (3ème convention)
Que le 15 juin 1989, jour de la
conclusion des conventions, celles-ci ont été transmises, sous la signature du
ministre, à l'administration (p. 18681) ; que le 30 juin 1989,
l'inspection des Finances a visé le bulletin d'engagement pour une des trois
conventions sans émettre d'observation (p. 18680) ;
Attendu qu'il ressort de la
comparaison du projet de convention initiale et des trois conventions nouvelles
que la circonstance que l'objet et le prix de la convention initiale ont été
réduits dans les trois conventions nouvelles n'empêche qu'il s'agit toujours du
même concept et but initial, c'est-à-dire du même marché ;
Attendu qu'il ressort des
déclarations de Jean-Louis Stalport (p. 9540)[2] et de
Camille Javeau (p. 2905)[3] que le
but de la scission était d'éluder l'avis obligatoire de l'inspecteur des
Finances ;
Que l'avis de l'inspecteur des
Finances auquel Jean-Louis Stalport fait allusion est
la signature pour visa requise pour l'engagement de la dépense, apposée le 30
juin 1989, postérieure à la passation du marché et ne révèle rien quant à la
volonté de transparence alléguée par le prévenu (p. 1304) ;
Attendu que ni la circonstance
que, si le marché n'avait pas été scindé, sa passation aurait de toute façon
été autorisée, ni celle que les trois conventions auraient été soumises à
l'avis non obligatoire de l'inspecteur des Finances, ne sauraient justifier la
scission artificielle du marché ;
Attendu que l'intention
frauduleuse que la prévention requiert ne doit exister que dans le chef de
l'auteur de l'infraction ;
Qu'à l'égard des coauteurs, il
suffit qu'ils aient apporté à son exécution une aide nécessaire ou qu'ils
l'aient directement provoquée, qu'ils aient eu une connaissance positive des
éléments constituant le fait principal et qu'ils aient eu la volonté de
s'associer de la façon prévue par la loi à la réalisation de
l'infraction ;
Que dans l'intention frauduleuse
de satisfaire la sollicitation de Camille Javeau, agréée par le ministre M.
Jean-Louis Stalport a apporté l'aide nécessaire à la
réalisation du but poursuivi dans le temps imparti ; (...) »
61. La Cour de cassation déclara ensuite
établies les préventions retenues à charge de M. Hermanus
et le condamna à une peine d'emprisonnement d'un an, avec sursis à l'exécution
pendant une période de cinq ans, et à une amende de 500 BEF, portée à
30 000 BEF. Elle lui interdit également d'exercer tous les droits énumérés
à l'article 31 du code pénal pour un terme de cinq ans.
62. La Cour de cassation estima que M. Hermanus avait été jugé dans un délai raisonnable, en se
fondant sur les considérations suivantes :
« Attendu qu'il ressort du
dossier :
– que le
7 août 1989, le comité supérieur de contrôle a transmis le
procès-verbal initial au procureur du Roi à Bruxelles (p. 1120 à 1094) ;
– que le réquisitoire
de mise à l'instruction à charge de Camille Javeau et de qui il appartiendra a
été tracé le 25 août 1989 (p. 1085) ;
– que de très nombreux
procès-verbaux ont dû être dressés en raison des multiples auditions et devoirs
rendus nécessaires par la nature des faits reprochés aux prévenus ;
– que la nature des
faits a exigé la désignation, le 20 octobre 1989, d'un expert
judiciaire (p. 283) avec une mission impliquant le dépouillement et l'analyse
de milliers de pièces et de données informatiques ; qu'à cet égard, il convient
d'observer qu'il existait entre les écritures comptables de l'association
« I » et de l'institut [...] une interpénétration compliquant la
tâche de l'expert ; qu'après avoir déposé une note préliminaire le 26 décembre
1989 (p. 358 à 337), une analyse des comptes bancaires de Camille Javeau le 26
novembre 1990 (p. 373 à 367), une note de réponse aux observations de Camille
Javeau le 6 décembre 1990 (p. 460 à 440), une note sur la convention Communauté
française D/100 du 24 septembre 1991 (p. 664 à 659), l'expert a déposé
successivement les différentes parties de son rapport les 29 décembre
1993, 7 janvier 1994, 21 janvier 1994, 4 février 1994, 3 mars 1994 et 22 mars
1994 (p. 18.256 à 18.157, 17.939 à 17.769, 19.406 à 19.156, 18.909 à 18.811,
17.285 à 17.228, 20.576 à 20.464) ;
– que pendant le temps
durant lequel l'expert remplissait sa mission et postérieurement, l'instruction
s'est poursuivie sans désemparer, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux et des
inventaires ;
– que les devoirs
ainsi réalisés révèlent que l'enchevêtrement des faits exigeait la vérification
des déclarations des nombreuses personnes concernées et la confrontation des
éléments recueillis, avant que le ministère public soit en mesure de prendre
ses réquisitions ;
– que dès le 30 juin
1994, le dossier a été communiqué au président de la Chambre des Représentants
par le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles du fait que paraissaient
résulter du dossier des indices d'infractions notamment à charge de Guy Coëme, P. M. et W. C., commises alors qu'ils exerçaient des
fonctions ministérielles et que le dernier était encore ministre à la date
d'envoi du dossier (p. 26.645 à 26.572) ;
Qu'en sa séance plénière du 14
juillet 1994, la Chambre des Représentants a mis Guy Coëme
en accusation et l'a renvoyé devant la Cour de cassation ;
Que dès le 21 juillet 1994, sur
les réquisitions du procureur général, le premier président de la Cour a désigné
le conseiller F. en qualité de magistrat instructeur en la présente cause avec
mission de compléter et de poursuivre l'instruction des faits en étroite
collaboration avec le juge d'instruction V.E. qui, en l'état, restait saisi des
mêmes faits en tant qu'auraient existé des indices d'infractions à charge de
personnes autres que Guy Coëme ;
Que le 9 mai 1995, le conseiller
instructeur a communiqué son dossier au procureur général près la Cour de
cassation ;
Qu'à la demande formulée le 15
juin 1995 par le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, le
Conseil de la Région de Bruxelles-capitale, en sa séance du 10 juillet
1995, a autorisé les poursuites contre le conseiller régional Merry Hermanus « par
l'instruction de la cause devant une chambre correctionnelle du tribunal de
première instance de Bruxelles » ; que le juge d'instruction V. E.
ayant été dessaisi par ordonnance du 22 septembre 1995 de la chambre du
conseil, le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale, en sa séance du 18
octobre 1995, a décidé, sur la demande du 25 septembre 1995 du procureur
général près la Cour de cassation, d'autoriser les poursuites à charge de Merry Hermanus devant cette
Cour ;
Que le réquisitoire aux fins de
citer à l'audience du 5 février 1996 a été signé le 8 novembre 1995 ;
Attendu qu'en raison du lien de
connexité pouvant exister entre les faits reprochés à l'accusé et aux prévenus,
le sort de chacun ne pouvait, au regard du règlement de la procédure, être
dissocié de celui des autres ;
Attendu que la Cour ne constate
aucune lenteur dans l'exercice des poursuites ; (...) »
63. M. Javeau fut condamné à une peine
d'emprisonnement de deux ans, avec sursis à l'exécution pour la moitié de cette
peine, et à une amende de 500 BEF, portée à 30 000 BEF.
64. A la suite de sa condamnation, M. Stalport a dû démissionner des fonctions d'administrateur
qu'il exerçait dans diverses sociétés anonymes de droit belge, en application
de l'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 1996. La décision
d'interdiction d'exercer les droits énumérés à l'article 31 du code pénal
privait, pour sa part, M. Hermanus de toutes ses
fonctions, à savoir celles de conseiller régional, d'échevin, de secrétaire
général du ministère de la Communauté française et de président de la SDRB.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La
Constitution
65. Les dispositions pertinentes de la
Constitution coordonnée du 17 février 1994 sont les suivantes :
Article 12
« La liberté individuelle
est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et
dans la forme qu'elle prescrit. (...) »
Article 13
« Nul ne peut être distrait,
contre son gré, du juge que la loi lui assigne. »
Article 59
« Sauf le cas de flagrant
délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de
la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une
cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont
il fait partie.
(...)
La détention d'un membre de l'une
ou de l'autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est
suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le
requiert. »
Article 120
« Tout membre d'un Conseil [régional
ou communautaire], bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et
59. »
Article 147
« Il y a pour la Belgique
une Cour de cassation.
Cette Cour ne connaît pas du fond
des affaires, sauf le jugement des ministres et des membres des Gouvernements
de communauté et de région. »
B. Les
dispositions constitutionnelles applicables au moment des faits, mais depuis lors modifiées
66. L'article 103, alinéa 1er,
de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 (ancien article 90 de la
Constitution du 7 février 1831), disposait :
« La Chambre des
représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la
Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce
qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie
lésée et aux crimes et délits que les ministres auraient commis hors l'exercice
de leurs fonctions. »
67. L'article 103, alinéa 2, de la
Constitution coordonnée du 17 février 1994 (ancien article 134 de la
Constitution du 7 février 1831) précisait quant à lui :
« La loi détermine les cas
de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder
contre eux, soit sur l'accusation admise par la Chambre des Représentants, soit
sur la poursuite des parties lésées. »
La Constitution du 7 février 1831
comportait un article 139 qui prévoyait, notamment, qu'il était
« nécessaire de pourvoir par des lois séparées, et dans le plus court
délai possible, aux objets suivants : (...) 5° La responsabilité des
ministres et autres agents du pouvoir ». Cet article fut abrogé le 14 juin
1971.
68. La loi du 12 juin 1998 portant
modification de la Constitution a remplacé l'article 103 de la Constitution par
une disposition nouvelle qui énonce que « les ministres sont jugés
exclusivement par la cour d'appel », aussi bien « pour les
infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions »
que « pour les infractions qu'ils auraient commises en dehors de
l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant
l'exercice de leurs fonctions » (article 103, alinéa 1er).
Par ailleurs, le nouveau texte
précise aussi que « la loi détermine le mode de procéder contre eux, tant
lors des poursuites que lors du jugement » (article 103, alinéa 2).
69. Il s'agit désormais de la loi spéciale
du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres (ainsi que de la
loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des
gouvernements de communautés ou de régions). « La cour d'appel de
Bruxelles est seule compétente pour juger un ministre pour des infractions
qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions », tandis que « pour
le jugement d'un ministre pendant l'exercice de ses fonctions, pour des
infractions qu'il aurait commises en dehors de l'exercice de ses fonctions, les
cours d'appel du lieu de l'infraction, celle de la résidence du prévenu ou
celle du lieu où il a été trouvé, sont également compétentes » (article 1er).
La loi règle le déroulement des poursuites et de l'instruction, la procédure
devant la cour d'appel et les modalités du pourvoi en cassation. Le titre VI de
la loi prévoit deux dispositions particulières parmi lesquelles l'article 29
qui dispose expressément :
« Les coauteurs et les
complices de l'infraction pour laquelle le ministre est poursuivi et les auteurs
d'infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le
ministre. »
C. La
disposition transitoire
70. Dans l'attente d'une loi de procédure
et pour éviter que la justice pénale ne soit paralysée à l'égard des ministres
pendant le temps nécessaire à l'adoption de la loi, le Congrès national avait
adopté, en 1831, une disposition transitoire afin de régler les compétences de
la Chambre des représentants et de la Cour de cassation.
Dans sa version originaire, l'ancien
article 134 de la Constitution, qui est devenu ultérieurement la disposition
transitoire de l'article 103, était formulé dans les termes suivants :
« Jusqu'à ce qu'il y soit
pourvu par la loi, la Chambre des Représentants aura un pouvoir discrétionnaire
pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, en
caractérisant le délit et en déterminant la peine. »
71. Dans le tome II des Novelles de 1935 consacré aux
« Lois politiques et administratives », il est exposé que cette
disposition visait, d'une part, la responsabilité ordinaire des ministres et,
d'autre part, une responsabilité particulière à leur fonction. On pouvait
notamment y lire (nos 723 à 725, p. 236) :
« Lorsqu'il s'agit de faits
prévus par le Code pénal, les peines de ce code sont applicables. Lorsqu'au
contraire, il s'agit de faits sur lesquels le Code pénal garde le silence,
provisoirement et en attendant qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre des
Représentants a un pouvoir discrétionnaire pour accuser les ministres et la
Cour de cassation pour les juger en caractérisant le délit et en déterminant la
peine. »
72. Dans sa mercuriale du 1er
septembre 1976 (Journal des Tribunaux,
1976, spécialement pp. 653-654, nos 4 et 5, ainsi que pp. 658-659, no
19), M. le procureur général Delange soulignait
qu'en vertu de la disposition transitoire de l'article 103 (à l'époque 90) de
la Constitution, la responsabilité pénale des ministres se trouvait engagée
pour toutes les infractions prévues par la loi pénale, la Cour de cassation
n'ayant aucun pouvoir discrétionnaire sur ce point (tout au plus pouvait-elle
ajouter des incriminations et des peines mais aucunement retrancher quoi que ce
soit à la responsabilité pénale ordinaire des ministres). Il y relevait
également que « quant à la procédure devant la Cour de cassation, il
semble bien qu'à défaut de loi, les règles du droit commun en matière
criminelle devraient s'appliquer par analogie » (p. 669).
73. Lors de la modification
constitutionnelle du 5 mai 1993, la disposition transitoire de l'article 103 de
la Constitution a été modifiée comme suit :
« Jusqu'à ce qu'il y soit
pourvu par la loi visée à l'alinéa 2, la Chambre des Représentants aura un
pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour
le juger dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines
qu'elles prévoient. »
74. Le législateur n'étant cependant
jamais intervenu autrement que par voie temporaire, cette disposition
transitoire fut en vigueur jusqu'à la modification constitutionnelle de 1998
(paragraphe 68 ci-dessus).
D. Les
lois d'application de l'ancien article 103 de la Constitution
75. Différentes lois d'application de
l'ancien article 103 de la Constitution ont été adoptées. Il s'agissait de lois
de circonstance et temporaires.
76. La première de ces lois a été adoptée
à la suite d'un duel qui opposa, en 1865, un membre de la Chambre des
représentants et le ministre de la Guerre. L'un et l'autre avaient fait usage
de leur arme. Comme ces faits étaient constitutifs d'une infraction pénale, le
procureur général près la Cour de cassation entendait engager des poursuites.
L'un des deux antagonistes étant ministre, il revenait à la Chambre des
représentants de le mettre en accusation et une demande fut formulée en ce
sens. Cependant la Chambre des représentants n'a accédé à cette demande que
moyennant l'adoption préalable d'une loi.
77. Dans le rapport fait au nom de la
commission spéciale nommée par la Chambre pour examiner les questions de droit
constitutionnel soulevées par ce duel, M. Delcour
commenta notamment en ces termes le projet de loi déposé :
« Notre commission,
messieurs, a été également d'avis que la Cour de cassation est compétente pour
statuer sur les faits de complicité ou les délits connexes qui pourraient être
imputés à d'autres personnes qu'au ministre poursuivi. Elle s'est référée aux
principes généraux du droit.
En effet, il ne serait pas
rationnel, dit M. Dalloz, que le tribunal d'exception qui, par le grand nombre
de juges dont il est composé, par son rang dans la hiérarchie judiciaire, par
la solennité de ses formes, présente aux accusés plus de garanties que les
tribunaux ordinaires, ne fût pas compétent pour statuer sur les faits de
complicité ou sur les délits connexes. C'est ce qui a lieu déjà dans le cas de
l'article 479 du code d'instruction criminelle. Lorsque le magistrat inculpé a
des complices dans lesquels ne se rencontre pas le même caractère public, ce
n'est pas le magistrat qui les suit devant le tribunal correctionnel, ce sont
les complices qui suivent le magistrat devant la juridiction supérieure.
(...)
Il est sans doute de l'intérêt
général que le ministre coupable d'un crime ou délit soit livré aux tribunaux,
car, comme je l'ai dit plus haut, personne ne peut prétendre à l'impunité en
Belgique. Mais, à côté de cet intérêt général vient se placer un autre intérêt
public non moins respectable, celui de la complète liberté du ministre pour
l'administration de la chose publique à un moment donné. C'est la Chambre des
Représentants qui est juge de ce dernier intérêt, devant lequel le premier
paraît devoir céder dans certaines circonstances. Je suppose que le ministre de
la Guerre ait commis un délit : la situation du pays est critique, lui
seul peut pourvoir convenablement à sa défense. Ne faut-il pas, dans une
situation aussi grave, que la Chambre des Représentants puisse faire céder
l'intérêt de la justice devant cet autre intérêt public plus puissant encore,
l'intérêt de la défense de l'Etat et du salut public ?
(...)
Quant à la Cour de cassation,
elle observera les formes prescrites par le code d'instruction, selon le caractère
de l'infraction qui lui sera déférée : s'agit-il d'un délit, elle se
conformera aux dispositions existantes en matière de délits ; s'agit-il d'un
crime, aux dispositions du code qui régissent les cours d'assises ; dans ce
dernier cas, la cour jugeant sans intervention du jury, il est clair que les
dispositions du code d'instruction criminelle relatives à cette partie de la
procédure ne pourront recevoir d'application. »
78. La loi intitulée « Loi relative aux
délits commis par les ministres hors de l'exercice de leurs fonctions »
fut adoptée le 19 juin 1865. Elle disposait notamment :
Article premier
« Les crimes et délits
commis par un ministre hors de l'exercice de ses fonctions sont déférés à la Cour
de cassation, chambres réunies. (...) »
Article 7
« La Cour de cassation
observe les formes prescrites par le code d'instruction criminelle.
(...) »
Article 9
« Les contraventions
commises par les ministres sont jugées par les tribunaux et dans les formes
ordinaires. »
Article 10
« La présente loi sera
obligatoire le lendemain de sa publication et n'aura d'effet que pour le terme
d'une année (...) »
79. C'est conformément aux dispositions de
cette loi que le ministre de la Guerre et le membre de la Chambre des
représentants furent traduits devant la Cour de cassation, jugés et condamnés
par celle-ci. Les parties pertinentes de l'arrêt du 12 juillet 1865 se lisent
comme suit :
« Considérant que
l'indivisibilité de la procédure est une conséquence nécessaire de
l'indivisibilité du délit et qu'elle emporte l'attribution de toute la
poursuite au juge de l'ordre le plus élevé, compétent à l'égard de l'un des
prévenus ;
Considérant que ce principe
d'ordre public, universellement admis en jurisprudence, avait été consacré par
une loi publiée en Belgique, celle du 24 messidor an IV, réglant le mode de
procéder contre les complices, soit d'un représentant du peuple, soit d'un
membre du directoire exécutif, accusé par le pouvoir législatif et traduit
devant la haute cour de justice ; que depuis il a été de nouveau confirmé
législativement par l'application que le code d'instruction criminelle en a
faite en son art. 501 ;
Considérant que le lieutenant
général baron C., ministre de la Guerre, devant, en exécution de la loi du 19
juin dernier, être jugé par la Cour de cassation, celle-ci se trouve, d'après
ce qui est reconnu ci-dessus, légalement saisie de la poursuite dirigée simultanément contre le représentant D., coprévenu ;
(...)
Par ces motifs, déclare les deux
prévenus coupables du délit de duel sans blessures et le premier prévenu
coupable du délit de provocation de ce duel. »
80. Le 3 avril 1995, le législateur
fédéral a voté une deuxième loi portant exécution temporaire et partielle de
l'article 103 de la Constitution. Cette loi portait uniquement sur les actes
d'instruction qui pouvaient être ordonnés par la Chambre des représentants et
sa durée était limitée à neuf semaines.
Dans son avis rendu le 23 mars
1995 sur le projet de loi qui devait aboutir à cette loi, la section de
législation du Conseil d'Etat se prononça comme suit :
« La loi proposée utilise de
façon très partielle cette large habilitation qui doit pourtant conduire le
législateur à déterminer tant les infractions que peuvent commettre les
ministres que les sanctions qui peuvent leur être infligées ou encore la
procédure qui peut être mise en œuvre à leur encontre, tant en amont qu'en aval
de l'acte d'accusation proprement dit. Cette manière de légiférer est de nature
à susciter des difficultés en raison de l'incertitude qu'elle peut, par
exemple, laisser planer sur la suite qui serait donnée aux procédures engagées
dans de telles conditions. »
81. Le 17 décembre 1996, le législateur a
adopté une troisième loi portant exécution temporaire et partielle de l'article
103 de la Constitution et qui concernait les ministres fédéraux. Elle
autorisait la Chambre des représentants à ordonner que des actes d'instruction
soient accomplis à l'égard d'un ministre et elle en déterminait les conditions
ainsi que les modalités d'exécution. La loi spéciale du 28 février 1997
concernait les ministres communautaires et régionaux. Ces deux lois resteront
en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998.
E. Les
questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage
82. En vertu de l'article 26 § 1 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989, la Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel,
par voie d'arrêt, sur les questions relatives, d'une part, à la violation par
une loi, un décret ou une règle visés à l'article 26 bis (134) de la Constitution, des règles qui sont établies par la
Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences
respectives de l'Etat, des communautés et des régions, d'autre part, à tout
conflit entre décrets ou entre règles visés à l'article 26 bis (134) de la Constitution émanant de législateurs distincts et,
enfin, à la violation par une loi, un décret ou une règle visés à l'article 26 bis de la Constitution, des articles 6,
6 bis et 17 de la Constitution. Les
articles 6 et 6 bis de la
Constitution, devenus les articles 10 et 11 en vertu de la modification du
17 février 1994, sont ceux qui reconnaissent le principe de l'égalité
des Belges devant la loi ainsi que la jouissance sans discrimination des droits
et libertés reconnus.
83. En vertu de l'article 26 § 2 de la
même loi, lorsqu'une question préjudicielle est soulevée devant une
juridiction, celle-ci doit en principe demander à la Cour d'arbitrage de
statuer sur cette question. Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue lorsque
l'action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne
faisant pas elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle. De
même, n'y est pas tenue non plus la juridiction dont la décision est
susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou
encore de recours en annulation devant le Conseil d'Etat soit lorsque la Cour
d'arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours qui a le même objet,
soit lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas
indispensable pour rendre sa décision, soit encore si la loi, le décret ou la
règle visés à l'article 26 bis (134) ne
viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés à son
paragraphe 1.
84. Dans les travaux préparatoires de la
loi spéciale du 6 janvier 1989, le ministre de la Justice a justifié le
caractère obligatoire de la question préjudicielle par la nécessité d'éviter
tout risque d'arbitraire dans les appréciations que les juridictions pourraient
porter à cet égard.
F. Le
code d'instruction criminelle
85. L'article 21, alinéa 1er, de
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure
pénale prévoyait que :
« L'action publique sera
prescrite après dix ans, trois ans ou six mois à compter du jour où
l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un
délit, ou une contravention. »
86. L'article 25 de la loi-programme du 24
décembre 1993 a modifié cette disposition qui se lit actuellement comme
suit :
« L'action publique sera
prescrite après dix ans, cinq ans ou six mois à compter du jour où l'infraction
a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit, ou une
contravention. »
87. Dans les travaux préparatoires de la
loi-programme, on peut lire, à propos de l'article 25 :
« Le nouveau délai
s'applique à un délai en cours, sans aucune rétroactivité. Tel est également
l'avis du ministre.
(...)
3ème cas : les faits ont été
commis le 1er janvier 1992 et un acte interruptif est intervenu le
15 décembre 1993. Etant donné que l'article 22 n'a jamais été modifié, on peut
se poser la question de savoir si les faits seront prescrits au 15 décembre
1996 ou au 15 décembre 1998. (...)
Le rapporteur considère que le
délai de trois ans qui a commencé le 15 décembre 1993 devient au 1er
janvier 1994, cinq ans. La prescription intervient dès lors le 15 décembre
1998 au lieu du 15 décembre 1996. Le nouveau délai s'applique à un délai en
cours sans aucune rétroactivité. Telle est également l'opinion du ministre.
(Doc. Parl. Ch., S.O. 1993-1994, no
1211/8, p. 11). »
88. La circulaire no 2/94 du 10
janvier 1994 du procureur général près la cour d'appel de Mons, portant sur ce
point, comporte notamment ces mots :
« Il s'ensuit que, dans
l'hypothèse où un acte interruptif intervient avant que la prescription de
l'action publique ne soit atteinte, le délai de prescription est prorogé de
cinq ans à partir du dernier acte interruptif utile. »
89. L'article 22 de la loi du 17 avril
1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, qui n'a pas
été modifié par la loi du 24 décembre 1993, est rédigé comme suit :
« La prescription de
l'action publique ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de
poursuite faits dans le délai déterminé par l'article précédent.
Ces actes font courir un nouveau
délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas
impliquées. »
90. L'article 190, alinéa 2, du code
d'instruction criminelle dispose ce qui suit en ce qui concerne le déroulement
de l'instruction d'audience devant le tribunal correctionnel :
« Le Procureur du Roi, la
partie civile ou son défenseur, exposeront l'affaire ; les procès-verbaux
ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier ; les
témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu et les reproches proposés
et jugés ; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront
représentées aux témoins et aux parties ; le prévenu sera interrogé ;
le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur
défense ; le procureur du Roi résumera l'affaire et donnera ses
conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit
pourront répliquer. »
91. La connexité trouve son fondement dans
les articles 226 et 227 du code d'instruction criminelle.
L'article 226 dispose que la cour
d'appel « statuera, par un seul et même arrêt, sur les délits connexes
dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle ».
Pour sa part, l'article 227
se lit ainsi :
« Les délits sont connexes,
soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies,
soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différents
temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre
elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les
moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer
l'exécution ou pour en assurer l'impunité. »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION, PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC LES
ARTICLES 13 ET 14
92. Invoquant l'article 6 de la Convention
les requérants prétendent avoir subi à maints égards, pendant les poursuites
pénales engagées contre eux, un déni de procès équitable et des atteintes aux
droits de la défense. Ceux-ci auraient aussi porté atteinte aux articles 13 et
14 de la Convention.
Les
dispositions pertinentes de l'article 6 de la Convention se lisent ainsi :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit
notamment à :
(...)
b) disposer du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
93. Les exigences des paragraphes 2 et 3
b) de l'article 6 représentent des éléments de la notion générale de procès
équitable consacrée par le paragraphe 1 (voir, parmi d'autres, les arrêts Van Geyseghem c.
Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I, et Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A no
277-A, p. 13, § 29). La Cour estime qu'il est approprié d'examiner les griefs à
la lumière du paragraphe 1 de l'article 6, en le combinant au besoin avec ses
autres paragraphes et les autres dispositions de la Convention qui se lisent
comme suit :
Article 13 – Droit à un recours effectif
« Toute personne dont les
droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à
l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles. »
Article 14 – Interdiction de discrimination
« La jouissance des droits
et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. L'absence
de loi d'application
94. Les requérants soutiennent que leur
jugement par la Cour de cassation, en l'absence d'une loi d'application de
l'article 103 de la Constitution, a porté atteinte à l'article 6 §§ 1, 2 et 3
b) de la Convention.
MM. Mazy,
Stalport, Hermanus et
Javeau ajoutent que la décision de joindre les poursuites en raison de
l'existence d'un lien de connexité constitue une violation de l'article 6 § 1
de la Convention et une discrimination contraire à l'article 14.
95. La Cour examinera successivement la
situation de M. Coëme et celle des autres requérants.
1. La
situation de M. Coëme
96. Comme les autres requérants, M. Coëme relève que les règles régissant la procédure qui
devait être suivie par la Cour de cassation n'étaient prévues ni par la loi ni
par la Constitution. Il en déduit que la Cour de cassation a dès lors été en
même temps législateur et juge, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il explique que toute autorité juridictionnelle doit être soumise à des formes
destinées à garantir aux justiciables la haute valeur de la sentence du juge et
à assurer les droits de la défense, ce que la Chambre des représentants avait
bien compris en 1865. L'absence de loi réglant la procédure a amené, en
l'espèce, la Cour de cassation à créer une procédure ad hoc, comblant les lacunes du législateur. En édictant elle-même
les règles de procédure applicables, fût-ce par référence, la Cour de cassation
a manifestement méconnu le principe de la séparation des pouvoirs de création
et d'application de la loi pénale. Même si, par exclusion, la procédure suivie
par la Cour de cassation ne pouvait être que celle prévue en matière
correctionnelle, cette circonstance ne suffit pas à rencontrer l'exigence d'une
procédure accessible et prévisible.
Selon M. Coëme,
cette circonstance a aussi porté atteinte à l'article 6 § 2 de la Convention,
dans la mesure où cette disposition prévoirait le principe « nullum judicium sine lege ».
97. Le Gouvernement expose que l'on ne
saurait déduire que la procédure devant la Cour de cassation n'était pas
définie par le droit national du seul fait que la procédure à suivre pour le
jugement des ministres n'était prévue ni par la Constitution ni par une loi
d'application. La procédure à suivre était celle existant pour la procédure
correctionnelle ordinaire, ce qui était parfaitement prévisible compte tenu des
enseignements de la jurisprudence et de la doctrine, ainsi que de la
circonstance que les trois autres procédures – celles prévues respectivement
pour la cour d'assises, les juridictions de la jeunesse et les juridictions
militaires – n'étaient à l'évidence pas applicables. La Cour de cassation n'a
donc ni fait œuvre de législateur ad hoc
ni dépassé les limites d'une interprétation raisonnable du droit existant en
appliquant la procédure correctionnelle ordinaire, moyennant quelques
adaptations rendues nécessaires par l'exigence de la Constitution de voir cette
cour siéger chambres réunies.
98. La Cour rappelle, tout d'abord, que le
but de la Convention « consiste à protéger des droits non pas théoriques
ou illusoires, mais concrets et effectifs ; la remarque vaut spécialement pour
[les droits] de la défense eu égard au rôle éminent que le droit à un procès
équitable, dont ils dérivent, joue dans une société démocratique » (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no
37, pp. 15-16, § 33). Selon la jurisprudence, l'introduction du terme
« établi par la loi » dans l'article 6 de la Convention « a pour
objet d'éviter que l'organisation du système judiciaire (...) ne soit laissée à
la discrétion de l'Exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie
par une loi du Parlement » (Zand c. Autriche,
requête no 7360/76, rapport de la Commission du 12 octobre 1978,
Décisions et rapports (DR) 15, pp. 70, 97). Dans des pays de droit
codifié, l'organisation du système judiciaire ne saurait pas davantage être
laissée à la discrétion des autorités judiciaires, ce qui n'exclut cependant
pas de leur reconnaître un certain pouvoir d'interprétation de la législation
nationale en la matière.
99. Un tribunal « se caractérise au
sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de
normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant
de sa compétence » (arrêt Belilos c. Suisse du
29 avril 1988, série A no 132, p. 29, § 64). Il doit aussi remplir
un ensemble d'autres conditions telles que l'indépendance et la durée du mandat
de ses membres, ainsi que l'impartialité et l'existence de garanties offertes
par la procédure. Il ne fait nul doute que la Cour de cassation, qui était en
droit belge la seule juridiction compétente pour juger M. Coëme,
constituait un « tribunal établi par la loi » (voir, mutatis mutandis, Prosa
et autres c. Danemark, requête no 20005/92, décision de la
Commission du 27 juin 1996, non publiée).
100. La Cour relève qu'aucune loi
d'application de l'article 103 de la Constitution n'était en vigueur le jour où
les requérants furent appelés à se présenter devant la Cour de cassation pour
répondre des infractions qui leur étaient reprochées (paragraphes 75, 80 et 81
ci-dessus). Or le paragraphe 2 de l'article 103 invitait le législateur à
régler les modalités de la procédure devant la Cour de cassation et l'article
139 de la Constitution du 7 février 1831 insistait sur la nécessité de le faire
dans le plus court délai. Cependant, M. Coëme,
assisté des conseils de ses avocats, ne se trouvait pas dans une situation d'ignorance
absolue des règles de procédure qui trouveraient application dans ce procès. Il
ne pouvait ignorer que la procédure correctionnelle ordinaire serait
probablement suivie, sur le fondement de l'examen de la doctrine et de la
jurisprudence, même si cette dernière était limitée à l'arrêt de la Cour de
cassation du 12 juillet 1865 (paragraphe 79 ci-dessus). Il pouvait aussi avoir
égard à l'article 7 de la loi du 19 juin 1865, même s'il ne s'agissait que
d'une loi de circonstance. Telle est d'ailleurs la conclusion à laquelle le
procureur général de la Cour de cassation serait lui-même arrivé et qu'il
aurait communiquée aux conseils de certains des requérants lors de l'entretien
du 3 novembre 1995. Dès l'ouverture de l'audience du 5 février 1996 (paragraphe
41 ci-dessus), le premier président de la Cour de cassation a lui-même confirmé
que la procédure correctionnelle ordinaire serait suivie, en précisant que
l'instruction se ferait conformément aux prescriptions de l'article 190 du code
d'instruction criminelle.
101. Le Gouvernement a cependant reconnu
que la procédure correctionnelle ordinaire ne pouvait être adoptée telle quelle
par la Cour de cassation siégeant chambres réunies. En effet, dans son arrêt
interlocutoire du 12 février 1996 (paragraphe 46 ci-dessus), la Cour de
cassation estima que les règles régissant la procédure correctionnelle
ordinaire ne seraient appliquées que pour autant qu'elles soient compatibles
« avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation
siégeant chambres réunies ». Il en résulte que les parties n'ont pas pu
connaître à l'avance toutes les modalités de la procédure qui serait suivie.
Elles ne pouvaient pas prévoir de quelle manière la Cour de cassation serait
amenée à amender ou à modifier les dispositions qui organisent le déroulement
normal d'un procès criminel, telles qu'elles sont établies par le législateur
belge.
En ce faisant, la Cour de
cassation a introduit un élément d'incertitude en ne spécifiant pas quelles
étaient les règles visées par la restriction adoptée. Même dans l'hypothèse où
la Cour de cassation n'aurait pas fait usage de la possibilité qu'elle s'était
ménagée d'apporter certaines modifications aux règles régissant la procédure
correctionnelle ordinaire, la tâche de la défense devenait singulièrement
difficile faute de savoir, au préalable, si une règle donnée allait ou non
trouver application dans le cours du procès.
102. La Cour rappelle que le principe de la
légalité du droit de la procédure pénale est un principe général de droit. Il
fait pendant à la légalité du droit pénal et est consacré par l'adage « nullum judicium sine lege ». Ce principe impose, sur le plan
substantiel, certaines exigences relatives au déroulement de la procédure, en
vue d'assurer la garantie du procès équitable qui implique le respect de
l'égalité des armes. Celle-ci comporte l'obligation d'offrir à chaque partie
une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la
placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire
(voir, parmi d'autres, l'arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 238, § 53). Elle rappelle aussi
que la réglementation de la procédure vise, d'abord, à protéger la personne
poursuivie contre des risques d'abus de pouvoir et que c'est donc la défense
qui est la plus susceptible de pâtir des lacunes et imprécisions de pareille
réglementation.
103. Par conséquent, la Cour estime que
l'incertitude qui a existé en raison de l'absence de règles de procédure
préalablement établies plaçait le requérant dans une situation de net
désavantage par rapport au ministère public, ce qui a privé M. Coëme d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de
la Convention.
104. Dans ces conditions, la Cour n'estime
pas nécessaire de statuer sur la violation alléguée des paragraphes 2 et 3 b) de
cette disposition, les arguments avancés sur ce point coïncidant, en substance,
avec ceux examinés sous le paragraphe 1.
2. La
situation des autres requérants
105. MM. Mazy, Stalport, Hermanus et Javeau
allèguent, en outre, que la décision de joindre les poursuites en raison de
l'existence d'un lien de connexité les a distraits, contre leur gré, du juge
que la loi leur assigne, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention, ce qui
constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention combiné
avec son article 6 § 1.
Les requérants rappellent que ni
la Constitution ni la loi ne donnent compétence à la Cour de cassation pour
connaître des poursuites contre des personnes autres qu'un ministre. Leur juge
naturel était le tribunal correctionnel, ce qui ressort tant du texte même de
l'article 103 de la Constitution que de celui de son article 13, lu isolément
ou combiné avec son article 147. La décision de la Cour de cassation portant
sur la prétendue connexité, insuffisamment motivée, constitue un traitement
exorbitant du droit commun et a porté atteinte à leurs droits de la défense en
les privant, sans justification raisonnable, d'un ensemble de garanties
substantielles dont aurait bénéficié tout autre prévenu et dont M. Coëme, jugé en même temps qu'eux, aurait partiellement
bénéficié dans le cadre de l'examen par la Chambre des représentants.
106. En ce qui concerne la connexité, le
Gouvernement souligne que les règles de la connexité énoncées par les articles
226 et 227 du code d'instruction criminelle sont applicables en toutes matières
répressives. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes et constantes à cet
égard. Or MM. Coëme et Javeau étaient poursuivis
comme coauteurs ou complices de certaines infractions et les autres requérants
pour diverses infractions commises dans le cadre des activités de l'association
« I ». Même si la jonction ne s'imposait pas au juge, elle était,
dans la présente affaire, soit amplement justifiée pour éviter le risque de
décisions contradictoires, soit souhaitable pour des raisons de cohérence,
d'économie de procès, bref de bonne administration de la justice. Il s'agissait
d'un choix on ne peut plus raisonnable et rationnel, permettant de mieux
mesurer et cerner le comportement délictueux des différents inculpés, et les
requérants ne sauraient se plaindre de ce que la compétence de la Cour de
cassation pour les juger n'aurait pas été prévue par la loi ni prévisible.
107. Rappelant que l'organisation du
système judiciaire ainsi que la compétence en matière répressive ne peuvent
être laissées à l'appréciation du pouvoir judiciaire, la Cour constate que
c'est l'article 103 de la Constitution qui prévoyait, jusqu'à la réforme de
1998 (paragraphes 68 et 69 ci-dessus), à titre exceptionnel, le jugement des
ministres par la Cour de cassation. Aucune disposition, cependant, ne prévoyait
la possibilité d'étendre la juridiction de cette dernière à des inculpés autres
que des ministres pour des infractions connexes à celles pour lesquelles les
ministres étaient poursuivis (voir, a
contrario, Crociani et autres c. Italie, requêtes
nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79 (jointes), décision de
la Commission du 18 décembre 1980, DR 22, pp. 147, 178-179). La nécessité de
l'existence de pareille disposition apparaît d'autant plus que, aujourd'hui, la
question semble désormais tranchée par l'article 29, alinéa 1er,
de la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des
ministres qui dispose que « les coauteurs et les complices de l'infraction
pour laquelle le ministre est poursuivi et les auteurs d'infractions connexes
sont poursuivis et jugés en même temps que le ministre » (paragraphe 69
ci-dessus).
Il est vrai, comme le soutient le
Gouvernement, que l'application des règles de la connexité, prévue en Belgique
par les articles 226 et 227 du code d'instruction criminelle, pouvait être
envisagée eu égard aux enseignements de la doctrine et de la jurisprudence et,
en particulier, de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1865, encore
que ce dernier soit intervenu en matière de duel et que l'arrêt précise que
« le duel est un fait complexe indivisible » et que
« l'indivisibilité de la procédure est une conséquence nécessaire de
l'indivisibilité du délit » (paragraphe 79 ci‑dessus).
Ces indications ne permettent pas de considérer, en l'espèce, que la connexité
était « prévue par la loi », d'autant que la Cour de cassation,
autorité jurisprudentielle suprême en Belgique, a elle-même décidé, à défaut de
saisir la Cour d'arbitrage, que le fait d'inviter à comparaître devant elle des
personnes qui n'avaient jamais exercé de fonctions ministérielles résultait de
l'article 103 de la Constitution plutôt que des dispositions du code
d'instruction criminelle ou du code judiciaire (paragraphe 47 ci‑dessus).
108. Dans la mesure où la connexité n'était
pas prévue par la loi, la Cour estime que la Cour de cassation n'était pas un
tribunal « établi par la loi » au sens de l'article 6 pour examiner
les poursuites contre ces quatre autres requérants. Eu égard à cette
conclusion, la Cour estime inutile de statuer sur la violation alléguée de
l'article 14, les arguments avancés sur ce point coïncidant, en substance, avec
ceux examinés sous l'article 6.
109. En ce qui concerne le grief de ces
quatre requérants tiré de l'absence de loi de procédure et de l'incertitude qui
en est résultée, la Cour, compte tenu de la
conclusion adoptée ci-avant, n'estime pas nécessaire de se prononcer sur ce
point.
110. En conclusion, la Cour constate qu'il
y a eu, dans le chef de M. Coëme et des autres
requérants, violation de l'article 6 § 1.
B. Les
questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage
111. MM. Mazy, Stalport, Hermanus et Javeau
soutiennent que le refus de la Cour de cassation de poser à la Cour d'arbitrage
des questions préjudicielles sur la connexité et l'allongement du délai de
prescription est entaché d'arbitraire et porte atteinte aux articles 6 § 1 et
13 de la Convention. Le grief formulé en substance par M. Coëme
se limite à la question préjudicielle portant sur la prescription.
112. Pour les requérants, l'article 26 § 2
de la loi spéciale du 6 janvier 1989 obligeait la Cour de cassation à poser à
la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles proposées, dont le caractère
sérieux ne pouvait être mis en cause. Cette obligation tend expressément à
garantir le monopole dont dispose la Cour d'arbitrage en matière
d'interprétation constitutionnelle et à éviter tout risque d'arbitraire dans
les appréciations que la juridiction saisie pourrait porter à cet égard. Le
caractère arbitraire du refus de poser les questions préjudicielles ressort également
des contradictions flagrantes qui apparaissent dans les arrêts de la Cour de
cassation et les écrits de son procureur général sur lesquels cette cour s'est
fondée. Les requérants ajoutent que leurs demandes constituaient manifestement
l'exercice d'un recours au sens de l'article 13 de la Convention puisqu'elles
visaient précisément à soumettre à une instance qualifiée à cet effet l'examen
de violations de droits et libertés reconnus par la Convention (articles 6 et
14), ainsi que par la Constitution belge.
113. Le Gouvernement explique pour sa part
que lorsque le droit national prévoit un système de questions préjudicielles,
il est raisonnable et logique que le juge saisi d'une demande en ce sens
examine s'il est tenu de poser la question proposée. Il est conforme au
fonctionnement de tous les mécanismes de question préjudicielle que le juge
vérifie s'il peut ou doit poser une telle question. Dans le système belge, le
juge vérifiera notamment si la violation alléguée des articles 10 et 11 de la
Constitution résulte bien d'une norme qui peut être soumise à l'examen de la
Cour d'arbitrage en vertu de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Les griefs des
requérants portent sur l'interprétation à donner à l'article 26 § 2 de la loi spéciale
sur la Cour d'arbitrage. Ce faisant, ils demandent à la Cour de réexaminer un
point qui ne relève que du droit national, ce qui n'est pas de sa compétence.
Or, même si elle fut contestée, la décision de la Cour de cassation de ne pas
poser les questions préjudicielles demandées est raisonnable et ne traduit
aucun arbitraire, de sorte qu'elle ne saurait porter atteinte à l'article 6 de
la Convention. Elle ne saurait pas non plus porter atteinte à son article 13,
le mécanisme des questions préjudicielles ne pouvant être considéré comme une
voie de recours.
114. La Cour observe, tout d'abord, que la
Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à ce qu'une affaire soit
renvoyée, à titre préjudiciel, par une juridiction nationale devant une autre
instance nationale ou internationale. Elle rappelle aussi sa jurisprudence
selon laquelle un « droit à un tribunal », dont le droit d'accès
constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations
implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un
recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat,
lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir, parmi
d'autres, l'arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne
du 19 décembre 1997, Recueil
1997-VIII, p. 2955, § 33). Le droit de saisir un tribunal par voie de
question préjudicielle ne peut pas non plus être absolu, même lorsqu'une
législation réserve un domaine juridique à la seule appréciation d'un tribunal
et prévoit pour les autres juridictions l'obligation de lui soumettre, sans
réserve, toutes les questions qui s'y rapportent. Comme le soutient le
Gouvernement, il est conforme au fonctionnement de pareil mécanisme que le juge
vérifie s'il peut ou doit poser une question préjudicielle, en s'assurant que
celle-ci doit être résolue pour permettre de trancher le litige dont il est
appelé à connaître. Cela étant, il n'est pas exclu que, dans certaines
circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale, appelée à se
prononcer en dernière instance, puisse porter atteinte au principe de l'équité
de la procédure, tel qu'énoncé à l'article 6 § 1 de la Convention, en
particulier lorsqu'un tel refus apparaît comme entaché d'arbitraire (Dotta c. Italie (déc.), no 38399/97,
7 septembre 1999, non publiée ; Predil Anstalt S.A. c. Italie (déc.), no
31993/96, 8 juin 1999, non publiée).
115. La Cour estime que tel n'est pas le cas
dans la présente affaire. En effet, la Cour de cassation a pris en compte les
griefs des requérants relatifs à l'application des règles de la connexité et de
la loi du 24 décembre 1993 ainsi que leur demande de voir poser des questions
préjudicielles à la Cour d'arbitrage. Elle s'est ensuite prononcée par des
décisions suffisamment motivées et qui n'apparaissent pas entachées
d'arbitraire. La Cour rappelle, en outre, que l'interprétation de la
législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et
notamment aux cours et tribunaux (voir arrêts Brualla
Gómez de la Torre précité, p. 2955, § 31, et Edificaciones
March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33).
116. En conclusion, la Cour estime que le
refus de poser des questions préjudicielles n'a pas porté atteinte à l'article
6 § 1.
117. Vu cette décision relative à l'article
6 § 1, la Cour juge inutile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 13
de la Convention. Les exigences de cette disposition sont en effet moins
strictes que celles de l'article 6 § 1 et elles sont, en l'espèce, absorbées
par celles-ci (voir, entre autres, l'arrêt Pudas c.
Suède du 27 octobre 1987, série A no 125-A, p. 17, § 43, et
l'arrêt Hentrich c. France du 22 septembre 1994,
série A no 296-A, p. 24, § 65).
C. Un
tribunal indépendant et impartial
118. MM. Mazy et Stalport soutiennent que la Cour de cassation ne saurait
être considérée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article
6 § 1 de la Convention, en se référant notamment au rôle habituellement dévolu
au ministère public près la Cour de cassation et à son rôle dans la conduite de
la présente affaire. Ils constatent, tout d'abord, que le procureur général
près la Cour de cassation a tenu une réunion le 3 novembre 1995. Au cours
de cette réunion, il a notamment porté à la connaissance des participants que
la procédure se déroulerait selon les règles ordinaires du code d'instruction criminelle,
ce qui fut confirmé lors de la première audience tenue par la Cour de
cassation. Cela signifie que le procureur général avait, au préalable, tout au
moins été mis au courant du choix de la procédure par la Cour de cassation.
Rappelant, ensuite, la mission traditionnellement dévolue au ministère public
près la Cour de cassation – que la Cour a pu apprécier lors de son examen des
affaires Delcourt, Borgers, Vermeulen et Van Orshoven (arrêts Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970,
série A no 11 ; Borgers c. Belgique du 30
octobre 1991, série A no 214-B ; Vermeulen c. Belgique du 20 février
1996, Recueil 1996‑I, et Van Orshoven c. Belgique du 25 juin 1997, Recueil 1997-III) – et notamment la pratique traditionnelle de
participation du parquet à la rédaction des arrêts de la cour, ils relèvent que
la confusion des rôles respectivement dévolus à la Cour de cassation et à son
parquet est particulièrement frappante. Le Gouvernement serait bien en peine de
justifier que des mesures quelconques ont été prises afin d'établir une
nécessaire distance entre la Cour de cassation et son ministère public qui
agissait, en l'espèce, comme partie poursuivante. Ils relèvent au contraire que
les représentants du ministère public avaient, lors des audiences, pris place sur
l'estrade au même niveau que la cour et qu'ils entraient dans la salle
d'audience et la quittaient en compagnie des conseillers de la Cour de
cassation. Ils estiment également symptomatique le fait que les noms des
personnes composant cette haute juridiction et les représentants de son parquet
étaient repris dans un même paragraphe dans les procès-verbaux d'audience
(paragraphe 52 ci-dessus) et que l'arrêt de cette cour constitue quasiment une
reproduction du réquisitoire.
119. En ce qui concerne l'indépendance et
l'impartialité de la Cour de cassation, le Gouvernement soutient que les
requérants n'apportent aucune preuve d'éléments ou d'événements concrets à
l'appui de leur thèse. Celle-ci se réfère à une « pratique traditionnelle »
de participation du parquet à la rédaction des arrêts de la Cour de cassation
qui a pris fin le jour même des arrêts Borgers (en
matière pénale) et Vermeulen (en matière civile). Le Gouvernement relève, tout
d'abord, que la Cour de cassation n'était pas encore constituée le 3 novembre
1995 : les dix-neuf magistrats (quinze effectifs et quatre suppléants)
n'ont été désignés que quelques semaines avant la première audience du 5
février 1996. Il était donc matériellement impossible que le ministère public
soit informé de la procédure choisie par une juridiction non encore constituée.
Il est toutefois évident que la procédure mentionnée par le procureur général
était la seule possible et prévisible. Le Gouvernement signale également que
les deux magistrats du parquet ne siégeaient pas au même banc que la Cour de
cassation elle-même, mais avaient un siège distinct, qui faisait face à celui
des deux greffiers et qui était plus proche de la barre des avocats que du banc
de la cour. Tout au long des débats et du délibéré, ces deux magistrats se sont
d'ailleurs abstenus de tout contact avec la cour en dehors des audiences.
Enfin, la Cour de cassation a manifesté à plusieurs reprises son indépendance
vis-à-vis du parquet. Le 12 février 1996, elle a notamment invité celui-ci,
selon MM. Javeau et Stalport eux-mêmes, à ramener ses
propos à un exposé de l'affaire sans en faire un réquisitoire (paragraphe 50
ci-dessus) et elle n'a pas suivi la suggestion du parquet d'entendre la défense
avant le réquisitoire (paragraphe 51 ci-dessus). La convergence de l'arrêt avec
les réquisitions ne saurait créer un doute légitime quant à l'impartialité de
la Cour de cassation.
120. La Cour rappelle que, pour établir si
un tribunal peut passer pour « indépendant » aux fins de l'article 6
§ 1, il faut notamment prendre en compte l'existence d'une protection contre
les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a apparence ou non
d'indépendance (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Findlay c. Royaume-Uni
du 25 février 1997, Recueil 1997-I,
p. 281, § 73, et Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1571, § 65). La Cour
relève à cet égard que les constatations de l'arrêt Delcourt au sujet de
l'indépendance de la Cour de cassation et de son parquet conservent leur
entière validité (arrêt Delcourt précité, pp. 17-19, §§ 32-38).
121. L'impartialité au sens de l'article 6
§ 1 s'apprécie, quant à elle, selon une double démarche : la première
consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel juge, en
telle occasion ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties
suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir entre autres, mutatis mutandis, l'arrêt Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1030-1031, § 58).
Seule la seconde démarche est pertinente en l'espèce. Toutefois, en la matière,
même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance
que les tribunaux, dans une société démocratique, se doivent d'inspirer aux
justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (voir, entre autres, les
arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A
no 154, p. 21, § 48, et Pullar c.
Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil
1996-III, p. 794, § 38). Pour se prononcer sur l'existence d'une raison
légitime de craindre dans le chef d'une juridiction un défaut d'indépendance ou
d'impartialité, le point de vue de l'accusé entre en ligne de compte mais sans
pour autant jouer un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si
les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées
(voir, mutatis mutandis, les arrêts
précités Hauschildt et Gautrin
et autres, ibidem).
122. La Cour a donc pour tâche d'examiner
si les requérants avaient objectivement un motif légitime de craindre un manque
d'indépendance et d'impartialité de la part de la cour qui les jugeait. A cet
égard, la Cour n'aperçoit pas de circonstance de nature à justifier les
appréhensions que les intéressés fondent sur le fait que le procureur général
aurait, lors de la réunion du 3 novembre 1995, précisé la procédure qui serait
suivie. Il apparaît effectivement que cette information aurait été fournie à un
moment où les magistrats qui furent appelés à siéger dans l'affaire n'avaient
pas encore été désignés et n'avaient pas encore pu se pencher sur la question
qui se posait à cet égard du fait de la carence du législateur. Par ailleurs,
aucune circonstance ne justifie les appréhensions de l'existence de certains
liens de sujétion ou de dépendance de la Cour de cassation à son ministère
public que les requérants déduisent des autres éléments qu'ils ont mentionnés.
De l'avis de la Cour, les deux circonstances présentées par le Gouvernement à
l'appui de sa thèse de l'autonomie de la Cour de cassation à l'égard du
parquet, et, en particulier, l'assertion de MM. Javeau et Stalport
relative à l'intervention du premier président lors de l'exposé de l'affaire
par le ministère public, sont de nature à ôter tout fondement légitime aux
doutes que les requérants ont pu éprouver à cet égard.
123. En conclusion, les requérants ne
pouvaient légitimement éprouver des doutes quant à l'indépendance et l'impartialité
de la Cour de cassation.
D. L'audition
de M. Stalport, le 16 mars 1994
124. M. Stalport
s'est aussi plaint d'avoir été condamné sur le fondement de ses déclarations du
16 mars 1994, ce qui l'aurait privé des garanties d'un procès équitable. Il
expose n'avoir été entendu sur les faits qui lui furent reprochés que lors de
son audition du 16 mars 1994, intervenue dans le cadre de la procédure qui
devait être instruite à charge du ministre M. Entendu en qualité de témoin, il
ne fut pas informé qu'il avait le droit de ne pas répondre aux questions qui
lui étaient posées. Il ne fut jamais entendu en qualité d'inculpé après que le
procureur général près la Cour de cassation eut engagé des poursuites à sa
charge. Enfin, la Cour de cassation a expressément retenu certaines de ses
déclarations faites le 16 mars 1994 comme étant constitutives d'un aveu, en
s'exprimant notamment comme suit lors de son examen de la prévention mise à sa
charge : « Attendu qu'il ressort des déclarations de Jean-Louis Stalport (...) que le but de la scission était d'éluder
l'avis obligatoire de l'inspecteur des Finances. » Il rappelle que dans
l'affaire John Murray (arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil 1996-I, p. 49, § 45), la Cour a
considéré que « le droit de se taire lors d'un interrogatoire de police et
le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes
internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès
équitable consacrée par l'article 6 ».
125. Selon le Gouvernement, rien n'établit
que M. Stalport ait, à un quelconque moment, été
contraint – ou ait pu croire être contraint – de participer à sa propre
incrimination. C'est un officier de police qui a procédé à son audition, le 16
mars 1994, et celle-ci s'est effectuée sans prestation de serment. M. Stalport, dont la condamnation ne repose pas uniquement sur
ses déclarations, n'a donc pas été empêché de faire usage de son droit au
silence, de se défendre utilement ou de demander des devoirs complémentaires
d'instruction, ce que M. Javeau a obtenu de la Cour de cassation. De l'avis du
Gouvernement, la véritable portée du principe dit de
« non-auto-incrimination » est d'empêcher que quelqu'un soit obligé
de dire la vérité sous serment, en tant que participant à l'œuvre de la justice
et sous peine de sanction en cas de fausse déclaration, pour voir utiliser
ensuite contre lui ses propres déclarations et se voir accuser d'infraction.
126. La Cour rappelle que le droit de ne
pas témoigner contre soi-même, c'est-à-dire le droit de se taire et de ne pas
contribuer à sa propre incrimination, est au cœur de la notion de procès
équitable (arrêts John Murray, loc. cit., et Funke c. France du
25 février 1993, série A no 256-A, p. 22, § 44 ; voir aussi Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2064-2065, §§ 68 et
71).
127. La Cour relève que le grief de M. Stalport porte essentiellement sur l'usage, dans la procédure
pénale dirigée contre lui, de ses déclarations recueillies le 16 mars 1994. La
Cour doit donc rechercher si l'emploi que l'accusation a fait de celles-ci a
porté une atteinte injustifiable au droit de ne pas s'incriminer soi-même. Elle
doit examiner cette question à la lumière de toutes les circonstances de la
cause.
128. Analysant la prévention relative aux
trois conventions signées le 15 juin 1989, la Cour de cassation a estimé,
dans son arrêt du 5 avril 1996, qu'il ressortait des déclarations de MM. Stalport et Javeau que le but de la scission de la
convention initiale, pour laquelle l'inspection des Finances avait émis un avis
défavorable, était d'éluder l'avis obligatoire de l'inspecteur des Finances
(paragraphe 60 ci-dessus). A l'examen des déclarations visées par la Cour de
cassation, il apparaît que celle-ci a dû fonder cette déduction sur les propos
de M. Javeau rapportés dans le procès-verbal de son audition du 8 juin 1993
(paragraphe 21 ci-dessus) et non sur un aveu qui ressortirait du procès-verbal
de l'audition du requérant du 16 mars 1994 (paragraphe 27 ci-dessus). Ce
dernier a, en effet, toujours affirmé, tant lors de cette audition que lors de
son interrogatoire du 20 février 1996 (paragraphe 52 ci-dessus), que la
décision de scinder la convention initiale n'avait pas pour but d'échapper au
contrôle du ministère des Finances. Dans ces conditions, on ne saurait
considérer que la Cour de cassation a recouru, pour établir la culpabilité de
M. Stalport, à des éléments de preuve obtenus de sa
part au mépris de sa volonté, par la contrainte ou des pressions.
129. En conséquence, la Cour n'estime pas
que le caractère équitable de la procédure ait été compromis par l'utilisation
d'éléments de preuve obtenus par la contrainte.
130. Partant, il n'y a pas eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention.
E. Le
délai raisonnable
131. M. Hermanus
soutient que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il expose
que sa situation a été affectée dès l'arrestation de M. Javeau en 1989, la
presse ayant mis en doute sa probité, ce qui l'a amené à déposer plainte pour
diffamation entre les mains du juge d'instruction, le 28 août 1989. Or la Cour
de cassation, qui siégeait en premier et dernier ressort, ne s'est prononcée
que six ans et demi plus tard. Le requérant relève que les faits mis à sa
charge, connus du juge d'instruction depuis l'origine, sont à ce point simples
et peu complexes que l'arrêt du 5 avril 1996 ne leur consacre qu'une demi-page.
En outre, les actes d'instruction le concernant sont peu nombreux. Il en est
particulièrement ainsi de l'expertise judiciaire, qui consacre la majeure
partie de ses développements à des circonstances de fait qui ne furent pas
retenues contre lui. La complexité alléguée des poursuites ne résulte que de la
volonté des autorités d'établir un « système » unissant toutes les
personnes poursuivies. La connexité n'est justifiée par les nécessités de
l'administration de la justice que sous la condition de respecter les droits de
la défense. Or un examen séparé des faits mis à sa charge aurait pu intervenir
déjà en 1994, sinon avant, et celui-ci n'empêchait nullement de soutenir que
les faits le concernant relevait d'un prétendu système.
132. Le Gouvernement souligne que le
requérant ne met pas en cause l'attitude des autorités judiciaires, ce qu'il ne
pourrait d'ailleurs faire. En se référant aux considérations développées sur ce
point par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 avril 1996, il constate que
malgré la complexité de l'affaire, les autorités judiciaires ont posé des actes
d'instruction sans désemparer, parallèlement à l'accomplissement d'un rapport
d'expertise particulièrement ardu. Les reproches du requérant visent
essentiellement l'application de la règle de la connexité, qui se justifiait
raisonnablement compte tenu de l'implication étroite de M. Hermanus
dans le système délictueux mis en place. Or le rôle central de l'association
« I » et de M. Javeau dans le système de financement d'activités
politiques impliquait nécessairement le regroupement de tous les faits et donc
de tous les inculpés qui avaient été en rapport avec ceux-ci.
1. Période
à prendre en considération
133. De l'avis de la Cour, la période à
considérer a débuté le 28 août 1991, date à laquelle une perquisition fut
effectuée au domicile de M. Hermanus et à ses
bureaux (paragraphe 19 ci-dessus). Elle rappelle qu'en matière pénale le
« délai raisonnable » de l'article 6 § 1 commence dès l'instant où
une personne se trouve « accusée » ; il peut s'agir d'une date
antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de
l'arrestation, de l'inculpation ou de l'ouverture de l'enquête préliminaire.
L'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut se définir
« comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du
reproche d'avoir accompli une infraction pénale », ce qui renvoie aussi à
l'idée de « répercussions importantes sur la situation » du suspect
(arrêt Hozee c. Pays-Bas du 22 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1100, § 43 ;
arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982,
série A no 51, p. 33, § 73). Si la campagne de presse dont fait état
le requérant ne peut être assimilée à pareille « notification », tel
est bien le cas des perquisitions effectuées le 28 août 1991 (Neubeck c. Allemagne, requête no 9132/80,
rapport de la Commission du 12 décembre 1983, DR 41, p. 13).
134. Par ailleurs, nul ne conteste que la
période à prendre en considération a pris fin le 5 avril 1996, jour du prononcé
de l'arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 55 ci-dessus).
135. Elle est donc de quatre ans, sept mois
et huit jours.
2. Caractère
raisonnable de la durée de la procédure
136. Le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard
aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la
complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], no
25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (no
2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV,
p. 1083, § 35).
137. La Cour constate, tout d'abord, que
l'affaire était complexe. Les autorités judiciaires étaient saisies d'une
multiplicité de faits matériels. Cette circonstance et la nature même des préventions
nécessitaient de la part des personnes qui instruisaient l'affaire un long
travail de reconstitution des faits, de rassemblement des preuves et de
détermination, pour chacune des personnes paraissant impliquées, des faits et
des préventions mis à leur charge. Tout cela explique l'ampleur du dossier,
ampleur que MM. Mazy, Stalport
et Javeau ont eux-mêmes mise en évidence dans leurs écrits devant la Cour. En
outre, l'affaire soulevait de délicates questions de droit qui, avant de se
poser aux requérants puis à la Cour de cassation, ont dû recevoir une réponse
de la part des autorités judiciaires belges. Enfin, les fonctions exercées par
certaines des personnes soupçonnées, dont M. Hermanus
lui-même, impliquaient de la part des autorités de poursuite la saisine
d'organes du pouvoir législatif aux fins de recevoir
« l'autorisation » de poursuivre ou de les voir statuer sur un
éventuel renvoi en jugement.
138. Quant au comportement de M. Hermanus, aucun délai ne lui apparaît imputable.
139. L'examen de l'affaire à la lumière des
observations des parties n'a permis de relever aucune période d'inactivité
imputable aux autorités judiciaires nationales. Le requérant ne met d'ailleurs
pas en cause la conduite de l'affaire par ces autorités, mais conteste leur
décision d'examiner les faits mis à sa charge conjointement avec ceux mis à
charge d'autres personnes, invoquant la connexité. Dans l'exercice de leur
pouvoir discrétionnaire, les autorités judiciaires prirent sans conteste le
risque de retarder le renvoi en jugement de M. Hermanus.
Toutefois, la circonstance que les faits reprochés à M. Javeau et aux autres
prévenus avaient été révélés par la même instruction et l'interdépendance des
accusations, relevées par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 avril 1996
(paragraphe 55 ci-dessus), pouvaient raisonnablement imposer de ne pas
disjoindre les préventions à charge du requérant du reste du dossier de
l'instruction.
140. L'article 6 « prescrit la
célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus
général, d'une bonne administration de la justice » (arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre 1992, série A no
235-D, pp. 82-83, § 39). Dans les circonstances de la cause, le comportement
des autorités judiciaires se révèle compatible avec le juste équilibre à
ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale.
141. Partant, il n'y a pas eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
II. SUR LA VIOLATION
ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
142. MM. Coëme et
Hermanus font valoir que l'application de la loi
nouvelle sur la prescription a emporté violation de l'article 7 de la Convention,
ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut
être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article
ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable
d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées. »
143. Les requérants affirment que le
principe de l'application immédiate de la nouvelle loi sur la prescription et
la volonté expresse du législateur imposaient à la Cour de cassation de
constater que la prescription de l'action publique, en ce qui les concernait,
était acquise le 22 février 1996, soit cinq ans après le fait interruptif
survenu le 22 février 1991. Or, par son arrêt du 5 avril 1996, la cour a
fait revivre et a prolongé un délai qui était échu, ce qui n'est pas possible,
en considérant qu'un délai originaire de cinq ans avait pris cours le 30
novembre 1989 vis-à-vis de M. Coëme et le 29 février
1988 à l'égard de M. Hermanus. Elle a en outre
interrompu une deuxième fois le délai de prescription, ce que pourtant
l'article 22 du code d'instruction criminelle ne permet pas, en prenant en
considération la date du 10 juin 1992. Les requérants en concluent que la Cour
de cassation a effectivement appliqué rétroactivement l'article 25 de la loi du
24 décembre 1993. Cela a porté atteinte à l'article 7 de la Convention, dans la
mesure où la détermination de la période pendant laquelle un fait peut être
puni concourt certainement autant à la notion de « peine » que la
mesure infligée en vertu de la loi à titre de sanction. L'article 7 consacre en
effet le principe de la prévisibilité de l'infraction et de la peine, ce qui
englobe la prévisibilité de la répression.
144. Le Gouvernement combat ces
allégations. Il fait valoir que l'interprétation extensive de l'article 7 faite
par les requérants n'est pas compatible avec son texte. L'article 7 comporte
certes l'interdiction de la rétroactivité mais cette interdiction ne concerne que
les incriminations et les peines, et ne s'applique donc pas aux règles de
procédure, notamment à la prescription. Suivre l'interprétation des requérants
constituerait un grave obstacle à la possibilité pour les Etats d'assurer les
adaptations nécessaires des procédures répressives et de tenir compte des
surcharges des juridictions. A titre subsidiaire, le Gouvernement soulève que,
même s'il fallait considérer que l'article 7 concerne également la prescription
en matière pénale, il aurait pour seule portée d'empêcher que, une fois
acquise, la prescription de l'action publique soit remise en question. C'est
seulement dans un tel cas qu'il y aurait rétroactivité : la loi nouvelle
devrait en effet « remonter dans le temps » par rapport à son entrée
en vigueur pour pouvoir mettre à néant une prescription acquise. Or rien de
tout cela ne s'est produit en l'espèce. Le 31 décembre 1993, date de l'entrée
en vigueur de la loi nouvelle, la prescription n'était pas acquise selon les
règles anciennement applicables et la Cour de cassation a appliqué à partir des
faits litigieux le nouveau délai de prescription prévu par la loi du 24
décembre 1993. Il faut en effet relever que la prescription concerne non les
faits mais la seule action publique. Elle relève des règles de procédure pour
lesquelles une nouvelle loi produit immédiatement ses effets sur toutes les
procédures en cours.
145. La Cour rappelle que, conformément à
sa jurisprudence, l'article 7 consacre notamment le principe de la légalité des
délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege). S'il interdit en particulier d'étendre le champ
d'application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne
constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la
loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, par exemple par
analogie. Il s'ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les
peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le
justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au
besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels
actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
La notion de « droit »
(« law »)
utilisée à l'article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans
d'autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d'origine tant
législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives,
entre autres celles de l'accessibilité et de la prévisibilité (arrêts Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V, p. 1627, § 29, et S.W. et C.R. c. Royaume-Uni
du 22 novembre 1995, série A no 335-B et 335-C, pp. 41-42, § 35, et
pp. 68-69, § 33, respectivement). La tâche qui incombe à la Cour est donc de
s'assurer que, au moment où un accusé a commis l'acte qui a donné lieu aux
poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant
l'acte punissable et que la peine imposée n'a pas excédé les limites fixées par
cette disposition (Murphy c. Royaume-Uni, requête no 4681/70,
décision de la Commission des 3 et 4 octobre 1972, Recueil de décisions 43, p.
1). La notion de « peine » possédant une portée autonome, la Cour
doit, pour rendre efficace la protection offerte par l'article 7, demeurer libre
d'aller au-delà des apparences et apprécier elle-même si une mesure
particulière s'analyse au fond en une « peine » au sens de cette
clause (arrêt Welch c. Royaume-Uni du 9 février 1995,
série A no 307-A, p. 13, § 27). Si le texte de la Convention
est le point de départ de cette appréciation, la Cour peut être amenée à se
fonder sur d'autres éléments dont les travaux préparatoires. Eu égard au but de
la Convention qui est de protéger des droits concrets et effectifs, elle pourra
aussi prendre en considération le respect d'un équilibre entre l'intérêt
général et les droits fondamentaux de l'individu ainsi que les conceptions
prévalant de nos jours dans les Etats démocratiques (voir, notamment, l'arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no
32, pp. 14-16, § 26, et l'arrêt Guzzardi c. Italie du
6 novembre 1980, série A no 39, pp. 34-35, § 95).
146. La prescription peut se définir comme
le droit accordé par la loi à l'auteur d'une infraction de ne plus être poursuivi
ni jugé après l'écoulement d'un certain délai depuis la réalisation des faits.
Les délais de prescription, qui sont un trait commun aux systèmes juridiques
des Etats contractants, ont plusieurs finalités, parmi lesquelles garantir la
sécurité juridique en fixant un terme aux actions et empêcher une atteinte aux
droits de la défense qui pourraient être compromis si les tribunaux étaient
appelés à se prononcer sur le fondement d'éléments de preuve qui seraient
incomplets en raison du temps écoulé (arrêt Stubbings
et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1502-1503, § 51).
147. La Cour constate que, dans son arrêt
du 5 avril 1996, la Cour de cassation a notamment déclaré établis, à l'égard de
MM. Coëme et Hermanus, des
faits de faux et d'usage de faux, qualifiés de crime par le code pénal. En
admettant des circonstances atténuantes, elle a toutefois imprimé à ces faits,
comme aux autres faits qu'elle a déclarés établis, le caractère de délit. En
droit belge, la qualification de l'infraction se détermine non d'après la peine
applicable, mais d'après la peine appliquée. C'est donc à la date du jugement
qu'il y a lieu de se placer pour fixer, en définitive, le délai de prescription
de l'action publique. Dans ces conditions, la Cour de cassation a pris en
compte le délai de prescription en matière de délit. Ensuite, en faisant une
application immédiate de la loi du 24 décembre 1993, la cour a estimé, après
avoir constaté que les faits déclarés établis n'étaient pas prescrits à la date
de l'entrée en vigueur de la loi, que le délai de prescription était de cinq
ans à partir des faits, éventuellement prolongé d'un nouveau délai de cinq ans
à partir d'un acte interruptif régulièrement accompli avant l'expiration du
premier délai de cinq ans (paragraphe 57 ci-dessus).
148. La Cour note que la solution adoptée
par la Cour de cassation se fonde sur sa jurisprudence selon laquelle les lois modifiant
les règles de prescription sont désormais considérées, en Belgique, comme des
lois de compétence et de procédure. Dès lors, elle s'inspire du principe
généralement reconnu selon lequel, sauf dispositions expresses en sens
contraire, les lois de procédure s'appliquent immédiatement aux procédures en
cours (arrêt Brualla Gómez de la Torre précité, p.
2956, § 35).
149. La prolongation du délai de
prescription introduit par la loi du 24 décembre 1993 et son application
immédiate par la Cour de cassation ont, certes, eu pour effet d'étendre le
délai durant lequel les faits pouvaient être poursuivis et ont été défavorables
pour les requérants, en déjouant notamment leurs attentes. Pareille situation
n'entraîne cependant pas une atteinte aux droits garantis par l'article 7 car
on ne peut interpréter cette disposition comme empêchant, par l'effet de
l'application immédiate d'une loi de procédure, un allongement des délais de
prescription lorsque les faits reprochés n'ont jamais été prescrits.
La question d'une éventuelle
atteinte à l'article 7 par une disposition qui aurait pour effet de faire
renaître la possibilité de sanctionner des faits devenus non punissables par
l'effet d'une prescription acquise est étrangère au cas d'espèce et ne doit
donc pas être examinée dans la présente affaire, même si, comme le soutient M. Hermanus, la Cour de cassation aurait, en ce qui le
concerne, reconnu un effet interruptif à un acte qui n'avait pas cet effet au
moment où il avait été posé.
150. La Cour constate que les requérants,
qui ne pouvaient ignorer que les faits reprochés étaient susceptibles d'engager
leur responsabilité pénale, ont été condamnés pour des actes pour lesquels
l'action publique n'a jamais été éteinte par prescription. Ces actes
constituaient des infractions au moment où ils ont été commis et les peines
infligées ne sont pas plus fortes que celles qui étaient applicables au moment
des faits. Les requérants n'ont pas non plus subi, du fait de la loi du 24
décembre 1993, un préjudice plus grand que celui auquel ils étaient exposés à
l'époque où les infractions furent commises (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Welch précité,
p. 14, § 34).
151. Partant, les droits des intéressés au titre
de l'article 7 de la Convention n'ont pas été enfreints.
III. sur l'application de l'article 41 de la
Convention
152. Aux termes de l'article 41 de la
Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y
a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de
la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a
lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. M.
Coëme
153. M. Coëme
affirme que le préjudice matériel résultant des violations alléguées de la
Convention s'élève à 22 660 749 francs belges (BEF), soit
20 544 024 BEF de pertes de revenus liées à ses activités de député,
de bourgmestre et de conseiller communal et à ses mandats au sein de trois
sociétés qu'il ne put exercer entre mai 1996 et décembre 1998 ou juin 1999, et
2 116 725 BEF représentant le montant des amendes, confiscations et
condamnations civiles prononcées, ainsi que les frais de l'action publique et
les frais d'enregistrement. Il demande également à la Cour de prendre en compte
certains avantages résultant du mandat de député, sans cependant les chiffrer.
Il expose que le lien de causalité entre le dommage et la violation de la
Convention est incontestable puisqu'il n'aurait pas pu être condamné si les
garanties contenues dans la Convention avaient été respectées. Il ne fait
aucune demande au titre du préjudice moral.
154. Selon le Gouvernement, le requérant
n'a pas dûment prouvé l'existence d'un préjudice matériel.
155. La Cour n'aperçoit pas de lien de
causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et le dommage
matériel. Elle ne peut en effet spéculer sur ce qu'aurait été l'issue d'une
procédure conforme à l'article 6 § 1. Partant, elle rejette les
prétentions du requérant à ce titre (voir, en dernier lieu, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 73, CEDH 1999-II, et Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2660, § 63).
Elle estime par ailleurs qu'en l'absence de demande sur ce point, il n'y a pas
lieu d'accorder de somme au requérant au titre du dommage moral.
2. M.
Mazy
156. M. Mazy
affirme avoir subi, du fait des violations alléguées de la Convention, un
important préjudice matériel et moral. Il précise que son préjudice matériel
s'élève à 7 369 768 BEF, soit 6 722 000 BEF de pertes de
revenus liées à son mandat d'administrateur-directeur au sein d'une société
qu'il ne put poursuivre du fait de sa condamnation et 647 768 BEF
représentant le montant des amendes, confiscations et transactions avec les
parties civiles à la suite de la condamnation prononcée, ainsi que les frais de
l'action publique et les frais d'enregistrement. Il ne détermine par contre pas
son préjudice moral.
157. Le Gouvernement estime que ce
requérant n'a pas dûment prouvé l'existence d'un préjudice matériel. Il soutient
par ailleurs que le préjudice moral que M. Mazy
prétend avoir subi n'est pas suffisamment précisé.
158. En l'absence de lien de causalité
entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et le dommage matériel,
la Cour rejette les prétentions du requérant à ce titre (paragraphe 155
ci-dessus). En revanche, elle estime que M. Mazy
a subi un tort moral certain du fait des violations qu'elle a constatées. Vu
son ampleur, le simple constat de ces violations ne saurait le compenser.
Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour décide d'octroyer, en
équité, la somme de 300 000 BEF à ce titre.
3. Les
héritières de M. Stalport
159. L'épouse et les filles de M. Stalport estiment que le préjudice matériel subi par leur
mari et père s'élève à 68 680 BEF, soit le montant de l'amende et les
frais de l'action publique qu'il a dû régler à la suite de sa condamnation.
Elles font aussi remarquer qu'il n'a pu poursuivre ses mandats d'administrateur
de diverses sociétés, vu la peine qui lui fut infligée. Elles exposent que la
comparution du requérant devant la Cour de cassation a été éprouvante, que
cette juridiction n'avait pas compétence pour juger l'intéressé et que la
procédure suivie n'était pas régulière. En effet, le caractère exceptionnel du
procès, qui a duré plus de cinq mois, et sa forte médiatisation ont réduit la
confiance qu'avaient en lui ses relations et ont fait obstacle à l'exercice
normal et serein de ses activités d'administrateur général, outre les atteintes
portées à son honneur et à celui de ses proches. Les épreuves qu'il a
traversées et sa condamnation ne sont pas étrangères à la dégradation de son
état de santé. L'épouse et les filles de M. Stalport
demandent en conséquence l'octroi d'une satisfaction équitable en rapport avec
ces dommages matériel et moral. Elles invitent la Cour à la fixer en équité.
160. Le Gouvernement fait valoir que
l'existence d'un préjudice matériel dans le chef de ce requérant n'a pas été
dûment prouvée. Relevant que seul le préjudice moral subi par M. Stalport peut être pris en compte, le Gouvernement constate
d'abord que ce dommage n'a pas été chiffré, ce qui ne lui permettait pas de se
défendre utilement. Il soutient par ailleurs que les atteintes à l'honneur et à
la vie professionnelle, à supposer que cette dernière soit distincte du
préjudice matériel allégué, résultent non des prétendues violations de la
Convention, mais de l'existence des poursuites et de la condamnation. Enfin, la
médiatisation résulte de la qualité des personnes poursuivies et de la nature
des faits reprochés.
161. En l'absence de lien de causalité
entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et le dommage matériel,
la Cour rejette les prétentions faites à ce titre (paragraphe 155 ci-dessus).
En revanche, elle estime que M. Stalport a subi
un tort moral certain du fait des violations qu'elle a constatées (paragraphe
158 ci-dessus). Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour décide
d'octroyer, en équité, la somme de 300 000 BEF à ce titre.
4. M.
Hermanus
162. M. Hermanus
affirme avoir subi un important préjudice matériel en raison de frais résultant
de l'arrêt du 5 avril 1996 lui-même et de la perte de rémunérations liées aux
activités professionnelles qu'il n'a pu poursuivre à la suite de l'interdiction
d'exercer, pour un terme de cinq ans, les droits énumérés à l'article 31 du
code pénal. Il relève que, du fait de cette interdiction, il a perdu l'ensemble
des activités qui constituaient sa vie professionnelle (secrétaire général du
ministère de la Communauté française, conseiller au Conseil de la région de
Bruxelles-capitale, échevin, président de la SDRB et administrateur d'une
société) qui lui avaient procuré, en 1995, des revenus annuels de
8 679 619 BEF. Les amendes, frais de l'action publique et frais de
photocopie représentent, pour leur part, une somme de 211 240 BEF. Il
expose qu'il a en outre subi un préjudice moral considérable résultant de la
perte, au moins temporaire, des fonctions qu'il occupait, du fait de la
médiatisation intense du procès et d'attaques de ses adversaires politiques.
163. Le Gouvernement conteste l'existence
d'un préjudice matériel dûment prouvée. Il en fait de même du préjudice moral,
non chiffré, en se référant aux considérations développées quant à l'atteinte à
la vie professionnelle et à la médiatisation à propos du dommage moral
prétendument subi par M. Stalport.
164. En l'absence de lien de causalité
entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et le dommage matériel,
la Cour rejette les prétentions du requérant à ce titre (paragraphe 155
ci-dessus). En revanche, elle estime que celui-ci a subi un tort moral certain,
que le simple constat des violations ne saurait compenser (paragraphe 158
ci-dessus). Dans les circonstances de la cause, la Cour décide d'octroyer, en
équité, la somme de 300 000 BEF à ce titre.
5. M.
Javeau
165. M. Javeau chiffre les divers
préjudices matériels résultant des violations alléguées de la Convention à
19 000 000 BEF pour les pertes de revenus, 7 613 927 BEF
pour les amendes, contributions, indemnités, confiscations, condamnations civiles,
frais de l'action publique et frais d'enregistrement pour lesquels il avait au
25 mai 1999 effectivement payé une somme de 1 559 749 BEF,
606 745 BEF pour sa quote-part d'une condamnation civile prononcée à la
suite d'une action engagée sur le fondement de l'arrêt de condamnation du 5
avril 1996, 182 307 BEF pour les frais de copie et photocopie du dossier
répressif et les frais de citation de témoins, et 421 075 BEF pour des
honoraires de comptable et expert fiscal, auxquels s'ajoute un montant de
39 654 441 BEF représentant les sommes dues au 25 mai 1999 du fait
d'un redressement fiscal auquel il a été procédé dès l'origine des poursuites.
Il fait aussi état d'un préjudice moral incommensurable, dont l'évaluation ne
peut être faite qu'ex aequo et bono et dont il laisse l'appréciation à la Cour. Il
expose notamment qu'il a été socialement « assassiné » du seul fait
de son jugement par la Cour de cassation où il a été jugé dans des conditions
médiatiques, psychologiques et publiques inhabituelles.
166. Le Gouvernement conteste l'existence
d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral (d'ailleurs non chiffré) dûment
prouvée, en se référant notamment aux considérations développées quant à la
médiatisation à propos du dommage moral prétendument subi par M. Stalport.
167. En l'absence de lien de causalité
entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et le dommage matériel,
la Cour rejette les prétentions du requérant à ce titre (paragraphe 155
ci-dessus). En revanche, elle estime que celui-ci a subi un tort moral certain,
que le simple constat des violations ne saurait compenser (paragraphe 158
ci-dessus). Dans les circonstances de la cause, la Cour décide d'octroyer, en
équité, la somme de 300 000 BEF à ce titre.
B. Frais
et dépens
1. M.
Coëme
168. L'intéressé sollicite le remboursement
de la somme de 1 222 580 BEF pour les frais exposés devant la
commission spéciale de la Chambre des représentants et la Cour de cassation, et
la somme de 229 510 BEF pour frais et dépens devant la Cour et la
Commission, soit un total de 1 452 090 BEF.
169. Le Gouvernement estime qu'à défaut de
démontrer que les montants réclamés pour les frais devant la commission spéciale
de la Chambre des représentants et la Cour de cassation auraient été exposés
pour prévenir ou corriger les violations alléguées de la Convention, la demande
doit être rejetée sur ce point. Il met aussi en cause certains frais et dépens
réclamés pour la procédure devant les organes de la Convention et, notamment,
des frais réclamés au titre de la comparution à l'audience du 2 mars 1999,
atteignant un montant global de 1 381,60 francs français (FRF). A son
estime, ces frais sont totalement indépendants des moyens mis en œuvre pour
assurer le respect des garanties conférées par la Convention. D'autres frais
réclamés à ce titre, plus précisément des montants de 1 200 FRF et
17 250 BEF et les sommes représentant les frais de déplacement, sont
exagérés. Quant aux autres sommes réclamées, il s'en remet à la sagesse de la
Cour.
170. Lorsque la Cour constate une violation
de la Convention, elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement
de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux
qu'il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire
corriger par celles-ci la violation (voir notamment l'arrêt Hertel c. Suisse du
25 août 1998, Recueil 1998-VI, p.
2334, § 63). En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas exposé de
tels frais et dépens devant la commission spéciale de la Chambre des
représentants. Partant, il y a lieu d'écarter la demande sur ce point. En
revanche, les incertitudes constatées en ce qui concerne les règles régissant
la procédure devant être suivie par la Cour de cassation ont certainement
entraîné, pour le requérant, certains frais complémentaires au cours de cette
instance. La Cour estime raisonnable de lui octroyer 200 000 BEF à ce
titre. M. Coëme est également habilité à demander le
paiement des frais et dépens se rapportant aux procédures devant la Commission
et la Cour, y compris pour la rédaction d'une note sur le règlement amiable
faite sur le fondement de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Du chef de ces
procédures, la Cour, statuant en équité sur la base des éléments en sa
possession, lui accorde 200 000 BEF.
2. M.
Mazy
171. Ce requérant sollicite le paiement de
460 190 BEF pour ses frais et dépens devant les organes de la Convention
et de 1 000 000 BEF pour les frais et honoraires devant la Cour de
cassation.
172. Le Gouvernement reconnaît que certains
montants réclamés par le requérant peuvent, à tout le moins partiellement,
concerner des moyens mis en œuvre par le requérant pour faire respecter la
Convention devant les juridictions nationales. Le requérant est cependant resté
en défaut de démontrer pareille relation pour l'essentiel des frais qu'il
prétend avoir engagés devant la Cour de cassation. Dans sa note sur la
satisfaction équitable du 29 juillet 1999, le Gouvernement a également soutenu
que le requérant n'était pas en mesure de demander le remboursement des frais
et dépens engagés devant les organes de la Convention faute de prouver qu'il
les avait réellement engagés, puisqu'il n'avait fourni qu'une évaluation de
ceux-ci.
173. En se référant aux considérations
développées lors de l'examen de la demande de M. Coëme
(paragraphe 170 ci-dessus), la Cour estime que le requérant a nécessairement dû
supporter certains frais complémentaires au cours de l'instance devant la Cour
de cassation au vu des lacunes constatées en ce qui concerne la connexité et
les règles régissant la procédure. Statuant en équité comme le veut l'article
41 de la Convention, la Cour lui alloue la somme de 300 000 BEF pour frais
et dépens devant la Cour de cassation et la somme de 460 000 BEF pour ses
frais de représentation devant la Commission puis la Cour, que le requérant a
démontré avoir engagés en produisant une note d'honoraires (voir, notamment,
l'arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no
66, p. 14, § 36).
3. Les
héritières de M. Stalport
174. L'épouse et les filles de M. Stalport demandent le paiement de 687 040 BEF
pour ses frais et dépens devant les organes de la Convention et de 872 600
BEF pour les frais et honoraires devant la Cour de cassation.
175. Le Gouvernement reconnaît que certains
montants réclamés par le requérant peuvent, à tout le moins partiellement,
concerner les moyens mis en œuvre par le requérant pour faire respecter la
Convention devant les juridictions nationales. Les héritières de M. Stalport sont cependant restées en défaut de démontrer
pareille relation pour une partie substantielle des frais qu'elles prétendent
avoir été engagés devant la Cour de cassation. Dans sa note sur la satisfaction
équitable du 29 juillet 1999, le Gouvernement a également soutenu qu'elles
n'étaient fondées à demander que le remboursement de 400 000 BEF au titre
des frais et dépens engagés devant les organes de la Convention faute de
prouver qu'il avait effectivement engagé le reste de la somme postulée. Il fait
aussi valoir que le manque de précision de la demande et des pièces
justificatives ne permet pas d'apprécier tant l'objet que le bien-fondé et le
caractère raisonnable des sommes réclamées.
176. En se référant aux considérations
développées lors de l'examen de la demande de M. Mazy
(paragraphe 173 ci-dessus) et statuant en équité comme le veut l'article 41 de
la Convention, la Cour alloue la somme de 300 000 BEF pour les frais et
dépens de M. Stalport devant la Cour de cassation et
la somme de 460 000 BEF pour les frais et dépens devant la Commission puis
la Cour, pour lesquels une note d'honoraires a été produite.
4. M.
Hermanus
177. L'intéressé sollicite le remboursement
de la somme de 264 480 BEF pour les frais et honoraires exposés pour
la procédure devant le Conseil de la région de Bruxelles-capitale, de la somme
de 1 250 000 BEF pour l'instance devant la Cour de cassation et
la somme de 497 547 BEF pour frais et dépens devant la Cour et la
Commission, soit un total de 2 012 027 BEF.
178. Le Gouvernement estime qu'à défaut de
démontrer que les montants réclamés pour les frais devant le Conseil de la
région de Bruxelles-capitale et la Cour de cassation auraient été exposés pour
prévenir ou corriger les violations alléguées de la Convention, la demande doit
être rejetée sur ce point. En ce qui concerne les frais et dépens pour la
procédure devant les organes de la Convention, il relève que certaines
diligences reprises dans une note d'honoraires du 3 janvier 1997 y sont totalement
étrangères. Quant aux autres sommes réclamées, il s'en remet à la sagesse de la
Cour.
179. En se référant aux considérations
développées lors de l'examen des demandes de MM. Coëme
et Mazy (paragraphes 170 et 173 ci-dessus) et statuant
en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour écarte la
demande relative à la procédure devant le Conseil de la région de
Bruxelles-capitale et alloue à M. Hermanus la somme
de 300 000 BEF pour frais et dépens devant la Cour de cassation. Après
avoir pris en compte l'argument du Gouvernement selon lequel certains frais
seraient étrangers à la procédure devant les organes de la Convention, elle
octroie la somme de 460 000 BEF pour ceux engagés devant la
Commission puis la Cour.
5. M.
Javeau
180. M. Javeau demande le remboursement de
1 119 270 BEF pour frais et honoraires devant la Cour de cassation et
573 973 BEF pour frais et dépens devant les organes de la Convention, dont
23 973 BEF représentent les frais de comparution à l'audience du 2 mars
1999.
181. Le Gouvernement estime qu'à défaut de
démontrer que les montants réclamés pour les frais devant la Cour de cassation
et les honoraires des quatre conseils l'ayant assisté devant cette juridiction
auraient été exposés pour prévenir ou corriger les violations alléguées de la
Convention, la demande doit être rejetée sur ce point. Il en va de même des
frais et honoraires de ses trois conseils dans la procédure à Strasbourg, dans
la mesure où les états et honoraires de ces avocats présentent exclusivement un
décompte global, ne précisent nullement les prestations auxquelles ils se
rapportent et ne distinguent pas entre les frais et honoraires. En ce qui
concerne les frais liés à la comparution du 2 mars 1999, ils ne sont pas
contestés.
182. En se référant aux considérations
développées lors de l'examen de la demande de M. Mazy
(paragraphe 173 ci-dessus) et statuant en équité comme le veut l'article 41 de
la Convention, la Cour alloue à M. Javeau la somme de 300 000 BEF et la
somme de 460 000 BEF, pour respectivement les frais et dépens devant la
Cour de cassation et ceux engagés pour sa représentation devant la Commission
puis la Cour.
C. Intérêts
moratoires
183. Selon les informations dont la Cour
dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Belgique à la date d'adoption du
présent arrêt est de 7 % l'an.
Par ces motifs, la Cour
1. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention à l'égard de M. Coëme,
en ce que l'absence de loi d'application régissant la procédure d'examen du
bien-fondé des poursuites dirigées contre les ministres en application de
l'article 103 de la Constitution l'a privé d'un procès équitable ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner
les griefs tirés à ce propos des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la
Convention ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où la Cour de cassation n'était
pas un tribunal « établi par la loi » au sens de l'article 6 pour
examiner les poursuites contre MM. Mazy, Stalport, Hermanus et
Javeau ;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner le
grief tiré à ce propos de l'article 14 de la Convention ;
5. Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner
le grief de MM. Mazy, Stalport,
Hermanus et Javeau tiré de l'absence de loi de
procédure prise en application de l'article 103 de la Constitution ;
6. Dit, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du refus de la Cour
de cassation de soumettre à la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles
relatives à la connexité et à l'allongement du délai de prescription ;
7. Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner
le grief tiré de l'article 13 de la Convention à propos du refus de soumettre à
la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles ;
8. Dit, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne
l'allégation que la Cour de cassation ne constituerait pas un tribunal
indépendant et impartial ;
9. Dit, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l'audition de
M. Stalport ;
10. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure
d'examen des poursuites dirigées contre M. Hermanus ;
11. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 7 de la Convention ;
12. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser
dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt est devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention 300 000 BEF (trois cent mille
francs belges), pour le dommage moral, à M. Mazy, à
M. Hermanus et à M. Javeau, ainsi qu'aux héritières
de M. Stalport ;
13. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser
dans le même délai de trois mois, pour frais et dépens, 400 000 BEF
(quatre cent mille francs belges) à M. Coëme et
760 000 BEF (sept cent soixante mille francs belges) à M. Mazy, à M. Hermanus et à M.
Javeau, ainsi qu'aux héritières de M. Stalport ;
14. Dit, à l'unanimité, que ces montants seront à majorer
d'un intérêt simple de 7 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et
jusqu'au versement ;
15. Rejette, à l'unanimité, les demandes de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à
Strasbourg, le 22 juin 2000.
Erik Fribergh Christos
Rozakis
Greffier Président
Au présent
arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74
§ 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante
de M. Conforti ;
– opinion en partie
concordante et en partie dissidente de M. Baka.
– opinion en partie
dissidente de M. Lorenzen, à laquelle se rallie
M. Rozakis ;
C.L.R.
E.F.
Opinion CONCORDAnte DE M. le juge
CONFORTI
La seule partie de l'arrêt sur
laquelle je ne suis pas d'accord avec la majorité est le raisonnement qui a
conduit celle-ci à distinguer la position de M. Coëme
de celle des autres requérants.
A mon avis, l'élément essentiel
qui emporte violation de l'article 6 de la Convention dans cette affaire, en ce
qui concerne tant la procédure appliquée à M. Coëme
que l'application du principe de la connexité aux autres requérants, est
l'absence, lors du déroulement du procès devant la Cour de cassation, d'une loi
d'application de l'article 103 de la Constitution.
Il est vrai que, en ce qui
concerne M. Coëme, l'article 103 prévoyait déjà la
compétence de la Cour de cassation. Il est vrai aussi que, compte tenu de la
doctrine et des communications faites par le procureur général aux conseils de
certains des requérants, ceux-ci pouvaient s'attendre à ce que la procédure
criminelle ordinaire leur fût appliquée. Toutefois, dans un pays de droit
codifié comme la Belgique – où les règles de procédure relèvent essentiellement
de la compétence du législateur et où, depuis plus d'un siècle et demi, le
Constituant invite le législateur à adopter des règles à suivre pour la mise en
accusation et le jugement des ministres – on ne peut conclure que la procédure
était prévue par la loi. Dire que, pour M. Coëme, il
s'agissait simplement d'une question d'égalité des armes et d'équité de la
procédure, c'est banaliser l'aspect le plus important de l'affaire.
Qu'il soit clair que je n'entends
pas par là que, en tant que telle, la Cour de cassation de Belgique, à laquelle
je porte tout mon respect, n'est pas un tribunal établi par la loi. Il est
évident que la condition « établi par la loi », imposée par l'article
6 § 1 de la Convention, n'est pas remplie si, bien que le tribunal soit
légalement constitué, les règles de procédure à appliquer dans un cas d'espèce
ne sont pas prévues par la loi, comme notre Cour l'a constaté à propos de la
connexité.
J'estime pour conclure que, pas
plus que les autres requérants jugés en vertu du principe de connexité, M. Coëme n'a été jugé par un tribunal établi par la loi au
sens de l'article 6.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE
ET EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA
(Traduction)
Je souscris entièrement à
l'opinion concordante de M. Conforti selon laquelle
les règles procédurales devant être appliquées par la Cour de cassation en
Belgique n'étaient pas établies en l'espèce. J'estime aussi que, du fait de ce
défaut procédural, M. Coëme n'a pas été jugé par un
tribunal établi par la loi au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Sa
position à cet égard ne se distinguait pas de celle des autres requérants.
Je fais toutefois également
mienne l'opinion dissidente de M. Lorenzen, rejoint
par M. Rozakis. Si la Cour juge qu'un tribunal
national ne peut être réputé établi par la loi, au sens de l'article 6 § 1,
soit parce qu'il n'était pas légalement constitué, soit – comme c'est le cas en
l'espèce – parce que sa procédure n'était pas établie, ce constat dispense
d'examiner plus avant les autres griefs tirés de l'article 6 § 1. C'est la
raison pour laquelle j'ai voté contre la majorité sur les points 6, 8 et 9 du
dispositif de l'arrêt.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE
DE M. LE JUGE LORENZEN, à LAQUELLE SE RALLIE M. LE
JUGE ROZAKIS
(Traduction)
Je souscris au constat de la
majorité figurant au paragraphe 108 de l'arrêt : la connexité n'étant pas
prévue par la loi, la Cour de cassation n'était pas un tribunal « établi
par la loi » au sens de l'article 6 de la Convention pour examiner les
poursuites contre M. Mazy, M. Stalport,
M. Hermanus et M. Javeau.
La Cour a jugé dans un certain
nombre d'arrêts que si une violation de l'article 6 § 1 est constatée au motif
qu'un tribunal n'était pas indépendant et impartial, il ne s'impose pas
d'examiner d'autres griefs tirés de l'article 6 relativement à la procédure
suivie devant le tribunal en question (voir, par exemple, les arrêts Findlay c.
Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil
des arrêts et décisions 1997-I, pp. 282-283, § 80, et Incal
c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil
1998-IV, p. 1573, § 74).
Cette jurisprudence s'applique a fortiori, d'après moi, aux situations
où une violation de l'article 6 § 1 est constatée au motif que le tribunal ne
remplissait pas les conditions pour être réputé « établi par la
loi ». En conséquence, j'estime qu'il n'était pas nécessaire d'examiner
les allégations de violation de l'article 6 § 1 figurant sous les sections I.
B. (questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage), I. C. (question de savoir
si la Cour de cassation était un tribunal indépendant et impartial) et I. D.
(question de savoir si l'utilisation comme preuve de l'audition de M. Stalport du 16 mars 1994 a enfreint le droit de ce dernier
à un procès équitable). Le grief de M. Hermanus
relatif à la durée de la procédure soulève d'autre part une question non
couverte par le constat selon lequel la Cour de cassation ne pouvait être
considérée comme « établie par la loi » en l'espèce. Toutefois, pour
les motifs exprimés dans l'arrêt, j'estime également qu'il n'y a pas eu violation
de l'article 6 § 1 à cet égard.
[1]. Note du greffe : la décision de la
Cour est disponible au greffe.